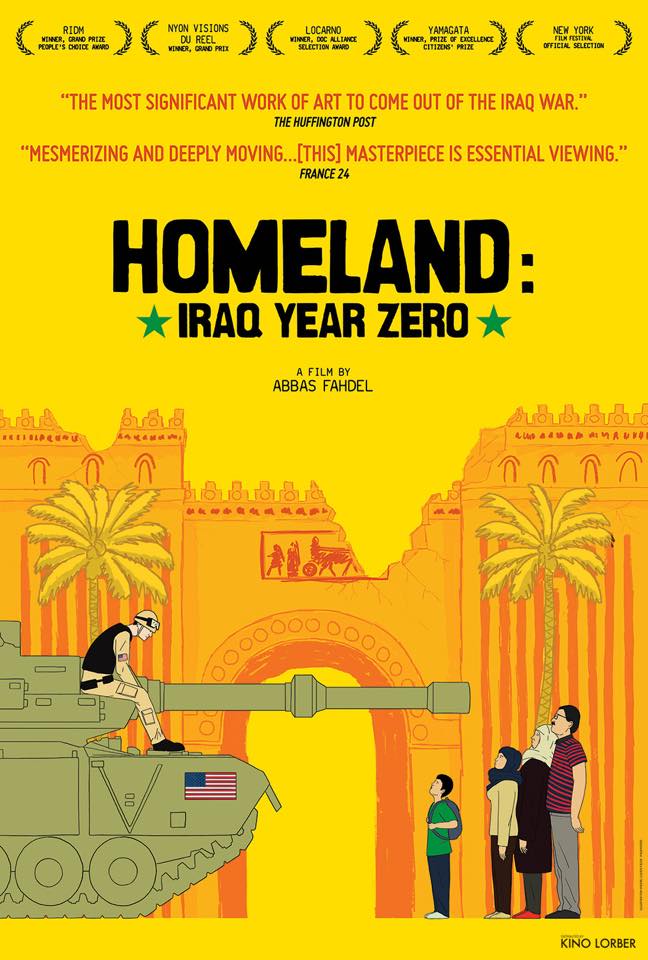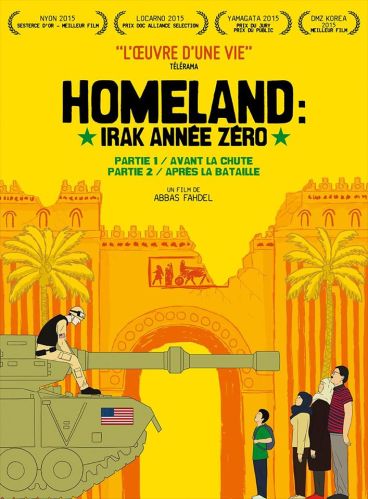
L’affiche française de Homeland
Film documentaire en deux parties, écrit et réalisé par Abbas Fahdel (Irak, 2015)
Sujet : chroniques de la vie quotidienne en Irak pendant une année, avant et après l’invasion américaine.
Première partie : BEFORE THE FALL (durée : 2h40) :
Pendant plusieurs mois, le réalisateur a filmé un groupe d’Irakiens, pour la plupart des membres de sa famille, dans leur attente de la guerre. Cette première partie du film se termine avec le début des frappes américaines sur Bagdad.
Seconde partie : AFTER THE BATTLE (durée : 2h54) :
Les Américains viennent d’envahir l’Irak et le film nous en révèle les conséquences sur la vie quotidienne des personnages. Le film se termine avec la mort violente de l’un des personnages principaux: Haidar, le neveu du cinéaste, âgé de douze ans.
Homeland (Iraq Year Zero), a documentary film written and directed by Abbas Fahdel (Iraq, 2015)
Synopsis : Chronicles of everyday life in Iraq before and after the U.S. invasion.
Part I: BEFORE THE FALL (duration: 2h40m) :
For several months, the director filmed a group of Iraqis, mostly members of his family, in their expectation of the war. This first part of the film ends with the start of U.S. strikes on Baghdad.
Part II: AFTER THE BATTLE (duration: 2h54m) :
Americans invades Iraq and the film shows the consequences of this invasion on the everyday life of the characters. The film ends with the violent death of one of the main characters: the nephew of the filmmaker, twelve years old boy Haidar.
Press Reviews / في الصحافة
_________________________________________________________________

Lussas: « Homeland », une famille et la guerre en Irak
«Homeland», le film d’une guerre
Iraque Ano Zero_ Como destruir um país – Carta Maior

Festivales_ Crítica de Homeland (Iraq Year Zero), de Abbas Fahdel – Otros Cines
NYFF 2015_ Abbas Fahdel Interview _ Brooklyn Magazine
No Place Like Homeland _ Jeffrey Ruoff
Etats généraux du documentaire, 2015 – Débordements
BALLAST Abbas Fahdel _ « En Irak, encore dix ans de chaos »
Hors champ – Homeland (Irak année zéro) de Abbas Fahdel – Tënk
Lineup Announced for NYFF53 Spotlight on Documentary
30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 2015 (14)_ HOMELAND_ IRAQ YEAR ZERO_ EL OTRO ES EL CINE « CON LOS OJOS ABIERTOS
Homeland_ Iraq Year Zero _ Terra natal _ Iraque ano zero _ CachoeiraDoc
———————————
Terra Natal: Iraque Ano Zero (Homeland: Iraq Year Zero, Iraque/França, 2015) CachoeiraDoc – Parte VI
Entretien_ Abbas Fahdel [critikat] 
Hors-Champ: Entretien avec Abbas Fahdel à propos de son film Homeland
![]()
Festival_ 27es États généraux du film documentaire de Lussas [critikat]
Locarno: Iraqi-French director Abbas Fahdel’s ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ Scoops Doc Alliance Selection Award – Variety
“Homeland”, Sesterce d’or au festival Visions du réel – Télévision – Télérama
« Homeland (Iraq Year Zero) », un documentaire hors normes primé à Nyon – Le Blog documentaire

Film Review_ ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ _ The Post
L’autre visage de la guerre en Irak – LeTemps
Un film-fleuve sur l’Irak primé d’or à Visions du Réel – 24heures
Visions du réel_ l’Irak et la Syrie à l’honneur

Cobertura 4º “Olhar de Cinema”
OLHAR DE CINEMA : HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) DE ABBAS FAHDEL
السينما الواقعية تشخّص أوجاع المجتمعات العربية – SWI swissinfo


“Homeland : Iraq Year Zero” en bonne compagnie parmi les films de tous les temps les mieux notés par la presse! Source AlloCiné

« Homeland : Irak année zéro » : Bagdad, ville ouverte
LE MONDE | 09.02.2016 à 06h49 Par Mathieu Macheret

Tout au long de l’année 1991, le critique Serge Daney consacre, dans ses colonnes de Libération et d’ailleurs, de nombreux articles à la couverture médiatique, plus précisément télévisuelle, de la guerre du Golfe. « Ce qui a frappé tout le monde face à ce télé-Irak bombardé, écrit-il alors, c’est la disparition des images », car, précise-t-il plus loin, « nous entrons dans une période où l’image n’existe plus que du point de vue du pouvoir, c’est-à-dire d’un champ sans contrechamp ».
Ce contrechamp eût été, selon l’auteur, de montrer, non pas « le fantasme de la guerre en direct », ni ces visuels robotiques de missiles pleuvant sur les toits de Bagdad, mais la vie de tous les jours et ses lieux, intérieurs et extérieurs, foyers, rues, « boîtes de nuit », pour attester que l’« autre », le peuple irakien, avait bien un visage, et pas forcément celui de Saddam Hussein.
Abbas Fahdel, Franco-Irakien installé en France depuis ses 18 ans, qui fut l’élève de Daney à l’université, a pris son invective au sérieux. Douze ans plus tard, en février 2003, alors que la coalition menée par les Etats-Unis s’apprête à lancer une nouvelle offensive contre l’Irak, sous le prétexte de dénicher des « armes de destruction massive », le cinéaste revient au pays avec une caméra légère et se met à filmer les membres de sa famille. Partout, tout le temps, et à travers eux ce quotidien irakien, dont nous savions si peu de chose, qui faisait jusqu’alors tant défaut.
Lire l’entretien : Abbas Fahdel : « Je me sens comme un survivant »
Deux mois après l’assaut américain qu’il a vécu depuis la France, Fahdel reprend le tournage, retrouve les mêmes personnes, les mêmes lieux, ébranlés par un choc terrible dont il est encore difficile de prendre la mesure. Le film qu’il tire des cent vingt heures de rushes accumulées, grande fresque qui nous parvient près de dix ans après les faits, est découpé en deux parties, selon la chronologie du tournage : un « avant » et un « après » ce point aveugle qu’est la guerre.
Résignation angoissée
La première partie, « Avant la chute », nous accueille le matin, au réveil de la famille, entre le crépitement du poêle, la chaleur du thé et la télévision qui crache un spot de propagande, où Saddam Hussein apparaît en petit père des armées. Ce qui sous-tend le volet, c’est évidemment l’imminence du conflit, qui plonge chacun dans une sorte de résignation angoissée, ravive le souvenir encore proche de l’embargo (1990-1996), qui avait si durement frappé la population, voire celui plus lointain de la longue guerre avec l’Iran (1980-1988). Alors, on creuse un puits dans le jardin, on fait des provisions de nourriture et de médicaments, on consolide les vitres avec des bandes de scotch, on joue à la guerre, mais surtout, on attend.

Un autre sentiment, très vite, prend le relais, celui que ce mode de vie, qui se perpétue malgré tout, ne disparaisse bientôt dans la déflagration de la guerre. Dans la plus pure tradition du documentaire, Fahdel recueille alors tout ce qu’il peut, sans autre intervention de sa part qu’un sous-titrage contextualisant (pas de commentaire). C’est la belle séquence du marché, où la caméra largue les amarres familiales, pour aller « collectionner » les établis, les visages, les matières, les produits, les épices, le chant élégiaque d’un mendiant aveugle. C’est aussi le merveilleux passage des vacances à Hit, dans la belle-famille, où les enfants, au soleil couchant, jouent sur les rives du Tigre, à proximité de majestueux vestiges assyriens (qu’en restera-t-il ?). Dernières heures d’une existence résiduelle dont la perte annoncée se noie dans les reflets mordorés du crépuscule.
La seconde partie, « Après la bataille », est consacrée, comme on peut s’y attendre, aux stigmates des affrontements, aux béances flagrantes qu’ils viennent de creuser dans le tissu social : bâtiments délabrés, traces d’incendies, ruines omniprésentes, quartiers résidentiels détruits. Le revers de la propagande baasiste, c’est désormais l’occupation américaine, avec les longues rangées de véhicules militaires qui sillonnent ou bloquent les rues, et les injonctions plus ou moins conciliantes des soldats. Dans les détonations éclatant à toute heure, dans la menace qui circule de gangs nés du chaos, qui tirent à vue, enlèvent femmes et enfants, se profile, comme en germe, l’origine délétère de l’organisation Etat islamique.
Homeland ne considère pas tant la famille comme refuge, mais surtout comme le point d’ancrage d’un plus large déploiement, vers le paysage social, naturel, culturel de l’Irak, assemblant, dans un montage extraordinaire, un rhizome de rencontres, de discours, d’affects, de refoulements, de craintes, d’aspirations, et même de déni (l’épisode des juifs convertis à l’islam).
Il y a là tout un héritage néoréaliste, rossellinien (si cher à Daney), comme l’indique le sous-titre du film (en référence à l’Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini, 1948). A ce titre, les images, d’apparence fragile, domestique, qui prêtent si peu le flanc à l’épate, ne sont si belles, si justes, qu’à mesure de leur anonymat, de leur dépouillement, par cette façon de ne jamais ornementer ni « griffer » le réel d’un auteurisme surplombant.
Un monde peuplé d’enfants
Mais ce qui frappe le plus, ici, c’est à quel point l’Irak que nous montre le film est un monde peuplé d’enfants. Ils semblent surgir de partout, faire du moindre tas de gravats leur terrain de jeu, et la caméra de Fahdel éprouve pour ceux-ci un véritable tropisme. Mieux, le cinéaste réserve à son neveu d’une dizaine d’années, le petit Haidar, le rôle principal d’Homeland, le laissant peu à peu devenir une sorte de guide, d’éclaireur, d’enquêteur, d’indicateur, partout où la caméra passe. Idée sublime que de confier les rênes du film, non pas à la raison adulte, ni même à une autorité certifiée, mais à un petit garçon rayonnant, enjoué, terriblement lucide.
Plus le film avance et plus il se referme sur lui comme un mausolée – puisque Haidar fut raflé par une rafale de tirs perdus (ce qu’on apprend dès la première partie). Raison pour laquelle Abbas Fahdel a mis si longtemps à affronter ces images, et qui achève de conférer à ce geste documentaire, d’une ampleur et d’une urgence inouïes, une terrassante densité émotionnelle.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2016/02/09/homeland-irak-annee-zero_4861669_3476.html#kDusdxPsMBGtX413.99

Homeland remporte le Prix La Croix du Meilleur Documentaire 2016
Le cinéaste Abbas Fahdel a reçu le 10 octobre le prix La Croix du documentaire 2016, décerné par un jury de professionnels du 7eart, de journalistes et de lecteurs.
Sorti en salle le 10 février, Homeland est une chronique familiale en deux parties, tournée en Irak en 2003, juste avant et après la chute de Saddam Hussein.
Un témoignage essentiel qui rend hommage aux « invisibles », ces populations prises dans le vent mauvais de l’Histoire.
Lancé en 2013 avec la complicité du cinéaste Raoul Peck, président de la Fémis, le prix La Croix du documentaire œuvre chaque année à la reconnaissance de ce genre cinématographique, avec une attention marquée pour les auteurs non encore identifiés par le grand public.
Après La Saga des Conti de Jérôme Palteau, Au bord du monde de Claus Drexel (2014) puis Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet (2015), le 4e prix La Croixdu documentaire devait être remis, lundi soir au cinéma Le Balzac à Paris, à Abbas Fahdel pour Homeland, Irak année zéro.
Un témoignage essentiel
Cette longue chronique en deux épisodes, Avant la chute (2h40) et Après la bataille (2h54) décrit, à l’échelle d’une famille – celle du cinéaste, vivant en France mais revenu séjourner parmi les siens –, l’attente de l’invasion de l’Irak et ses conséquences tragiques.
Présenté dans nombre de festivals à travers le monde, déjà primé au Canada, en Suisse et au Japon, ce film aussi bouleversant qu’éclairant est un témoignage essentiel qui rend hommage aux « invisibles », ces populations prises dans le vent mauvais de l’Histoire. Une de ces œuvres qui, nées dans le chaos, posent – douloureusement – les premiers fondements d’une mémoire collective.
Onze autres documentaires français, mais aussi venus de Suisse et de Belgique, avaient été sélectionnés cette année : Tout s’accélère de Gilles Vernet, Le Dernier Continent de Vincent Lapize, La Sociologue et l’Ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry, Héritages de Philippe Aractingi, J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laetitia Carton, Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Free to Run de Pierre Morath, Merci patron ! de François Ruffin, Capitaine Thomas Sankara de Christophe Cupelin, L’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel et This is My Land de Tamara Erde.
L’ensemble de ces films ont fait l’objet d’une reprise en salle, lors du premier Festival La Croix du documentaire, qui s’est tenu du 23 au 25 septembre, au Lucernaire à Paris.
La documentariste Anne Georget (Festins imaginaires…), présidente de la Société civile des auteurs multimédia (Scam, partenaire du prix depuis quatre ans) est la marraine du prix 2016, dont le jury était présidé par Guillaume Goubert, directeur de La Croix.
Deux lecteurs du journal, Caroline Lesoin (de Roubaix) et Pierre Laporte-Daube (de Grenoble) ont pris part aux débats, aux côtés d’Emmanuelle Giuliani, chef du service « culture » de La Croix, Justine Meignan (pour Images en bibliothèque, autre partenaire du prix) et Jean-Pierre Duret, ingénieur du son et réalisateur de documentaires (Se battre…).

Jeune Afrique : “ce documentaire donne ainsi à voir très exactement ce que le cinéma, mais aussi l’ensemble des médias du monde entier, tous plus ou moins embedded (“embarqués”), ne nous ont jamais montré.”

Homeland : Irak année zéro Abbas Fahdel
Entre février 2002 et avril 2003, Abbas Fahdel, exilé à Paris, revient filmer ses proches et ses amis en Irak. Après vingt ans d’absence, il y a ceux qu’il retrouve et ceux qu’il découvre, une joyeuse nuée de neveux et nièces. Parmi eux, l’espiègle Haidar, 13 ans, devient vite l’un des formidables « personnages » de ce documentaire en deux volets bâti comme une fiction. « Avant la chute » saisit l’attente d’une guerre annoncée à grands coups de semonces par l’Amérique des faucons. « Après la bataille » raconte la décomposition d’un pays libéré de son tyran, mais livré au chaos.
Le titre — et son clin d’oeil à Roberto Rossellini — l’atteste : le cinéaste, longtemps critique, connaît ses classiques, d’Ozu à Jean Rouch. A se familiariser avec les uns et les autres, à partager leur intimité (vaisselle à la bougie quand l’électricité est coupée), à les regarder se préparer à un énième conflit (creuser un puits, accumuler des provisions), on a le sentiment d’avoir enfin accès à cette simple et rare réalité : l’Irak des Irakiens. L’exilé filme, comme s’il voulait les retenir, des instants banals et fragiles. On devient vite des habitués de la maison. On apprend à aimer ses habitants, dont la joie de vivre irrigue toute la première partie. La vie sous Saddam n’est pourtant pas une partie de plaisir : le mutisme du foyer devant les chaînes officielles le prouve. Les scènes « comiques » — « J’espère qu’ils ne vont pas utiliser d’armes de destruction massive… », s’inquiètent de petits Bagdadis en guettant le premier missile américain — succèdent à de purs moments d’élégie : un vieil homme qui pleure sur une chanson d’amour, symbole d’un patrimoine bientôt englouti.
La deuxième partie débute deux semaines après la guerre. Les GI n’ont pas l’air si terribles et la famille, qui a suivi la chute du raïs depuis son refuge campagnard, reprend espoir. Sur les toits de Bagdad, les antennes satellites poussent comme des champignons, et, dans les charniers, les cadavres de la dictature commencent à faire surface. La suite, hélas, est accablante. Les libérateurs se muent en occupants paniqués. L’Irak n’est plus administré, les pillards envahissent la ville. Abbas Fahdel ne joue ni avec les siens, ni avec nos nerfs : on a su très vite que Haidar, le neveu vif-argent, ne s’en sortirait pas. Mais, quand il disparaît soudain, cette guerre lointaine devient un peu la nôtre. Homeland : Irak année zéro nous laisse avec l’impression tragique qu’un grand film de guerre a miné le film de famille. Et tout fait exploser. — Mathilde Blottière

“Homeland : Irak, année zéro” un grand voyage documentaire, intime et politique
- 10 FÉVR. 2016
- PAR OLIVIER BEUVELET
Homeland : Irak année zéro, le documentaire monumental (au sens propre) du réalisateur franco-irakien Abbas Fahdel n’est pas seulement un film à voir. C’est un film à respirer, à palper, à sentir, à laisser venir, la tête bien calée sur le haut du dossier. C’est un film avec lequel on est par le regard mais aussi avec tout son corps, parfois encombrant durant la longue durée de ce voyage documentaire. On le gratte, on le bouge, on le repositionne, mais jamais l’œil ne quitte la surface de l’écran, frontière poreuse avec l’autre monde, l’autre vérité, l’autre point de vue. Devant ce film incroyablement simple et direct, on comprend enfin ce qu’est l’Histoire vécue au revers intime des images de l’Histoire médiatisée en direct. Sans s’identifier au point de vue du filmeur, le spectateur se met à la place d’Abbas Fahdel pendant les 5 heures 34 (en deux parties) que dure le film.
C’est peut-être un peu long pour un film mais c’est si court pour un tel voyage ! Je me souviens de l’impression extraordinaire de sa performance (plus que de sa projection – trop plat) dans le grand auditorium de l’Institut du Monde Arabe lors d’une avant-première mémorable, il y a quelques semaines. J’avais eu l’impression de sortir d’un avion en pleine nuit, dans le froid parisien, après avoir vraiment découvert l’Irak. Découvert aussi qu’en Irak vivaient des irakiens qui n’étaient pas les ennemis des américains mais des hommes, des femmes, des enfants souvent pris entre le marteau de Saddam et cette enclume de Bush.
On n’a jamais filmé la guerre de cette manière, avec une telle simplicité, c’est-à-dire comme elle est vécue depuis le tapis central d’une maison où toute la famille se demande en permanence ce qui va se passer. Mais c’est ça (je pense) la guerre. C’est quand les murs de sa maison deviennent provisoires, quand les vitres sont en attente de tomber, quand son lieu de travail se transforme en cible, quand la faim attendue nous pousse à faire des provisions, quand on fait des masques à gaz avec des couches. Les jeux de guerre avec des armes de fortune occupent de plus en plus les enfants, et de manière de plus en plus réaliste au fil du film. La guerre est un monstre à apprivoiser au quotidien, c’est la possibilité de voir surgir la mort à tout moment, n’importe où. Comme nous le montrera la fin du film. Comme nous le découvrons amèrement depuis le 13 novembre. Même si nous ne sommes pas en guerre, même si nous n’en parlons pas, son imaginaire court dans le métro et les rues de Paris. Le film nous la montre sur la table de la cuisine.
La guerre n’est jamais là très vite, elle arrive, elle est devant nous. Elle est toujours invisible en soi-même, elle vient, elle est passée et tout est différent.
La première partie nous le rappelle avec une immense minutie visuelle et psychologique. La seconde nous le détaille … Et toujours avec la délicatesse qu’on sent dans les propos attentifs et simples du réalisateur, qui n’est pas là pour lui mais pour cette chose qui est le lieu de rencontre de tout : le film et ses deux parties : avant/après la bataille.
Ainsi, on fréquente son film plus qu’on ne se contente de le regarder. La distorsion du temps, sur ces deux dimensions du cycle et de l’écoulement, ouvre dans la largeur un espace où le cadre s’oublie. On est dans ce monde rendu plus proche par la familiarité du cinéaste avec les personnes filmées et la familiarité que ce parti pris nous octroie avec les lieux. La rythmique des plans à la fois tableaux composés et flux spontanés, propose au regard une pulsation de vie qui parfois se fige dans la peur ou la contemplation. Le spectateur, passager clandestin à bord du regard du filmeur, dans le scaphandre de son corps presque invisible, voyage autant qu’il est possible dans un Irak tendu puis dans un Irak brisé. On passe avec lui, sa famille et son peuple, de l’ordonnancement au chaos. Et le tragique n’est pas loin, la mort est annoncée par des cartels jaunes qui se distinguent des sous-titres et désamorcent tout effet hollywoodien. La mort n’est pas l’objet d’une spéculation narrative, elle est écrite dans le sujet même, et le savoir du monteur ne joue pas avec l’innocence du filmeur, mais vient au contraire informer l’image et le spectateur, au moment où se nouent les liens tragiques. La guerre, c’est parler avec des morts en puissance, avec des personnages de tragédie. Dans ce passage initiatique, on surnage grâce à la rigueur éthique des cadrages, jamais intrusifs mais jamais indifférents, grâce à la tension de l’écoute attentive qui transforme la vie de famille en monument historique et grâce aux mouvements brefs et précis de ce regard qui garde. Qui monte la garde auprès des siens. Un zoom et c’est l’amour, l’intérêt, la tendresse qui nous rapprochent des êtres filmés. Un Insert ou un gros plan et l’on se moule dans la construction d’un espace pictural, dont l’architectonique est en soi un défi à la destruction annoncée des bâtiments. Un plan pris par une fenêtre ou par-dessus des objets interposés, et l’on devient un observateur curieux sans être un voyeur, conscience visuelle qui vise toujours l’au-delà, le plus tard, l’après tout ça … Et tous les plans tirés des scènes de rue de son enquête en ville, auprès des commerçants, viennent répondre à notre désir de voir l’Irak tel qu’on ne nous l’a jamais montré, tel qu’on ne l’a jamais imaginé.
Ce qu’on voit en revanche, dans la seconde partie, Après la bataille, grâce à ces deux niveaux de récit : le bilan social et politique de la bataille et les effets de la guerre sur les individus, c’est que la guerre a été une arnaque, un vol, un acte de piraterie. Loin de l’imaginaire guerrier des films hollywoodiens sur l’Irak, terrain de jeu vidéo pour les marines’s ou les GI’s, Abbas Fahdel nous montre simplement des soldats américains, gamins gentils mais naïfs, assis à attendre sur leurs chars. Le pillage fait rage, les meurtres pour une voiture hors d’usage sont quotidiens, la population doit s’armer pour faire face à l’absence de protection, mais la présence américaine n’est qu’une façade hollywoodienne. Les américains vivent reclus dans des quartiers sécurisés, une seule chose semble compter pour eux : leur propre vie et le pétrole. Que le reste de l’Irak meure… on voit très bien de quel chaos sont sortis les zombies de Daesh. On comprend vite qu’on est très clairement devant une guerre mafieuse menée par un cartel texan dont le seul objectif militaire est de s’arroger des puits de pétrole. La société irakienne ne les intéresse pas, ne les concerne pas, n’existe pas. Et tout s’effondre. L’évidence de cette destruction m’a fait penser à Suite française d’Irène Némirovski, écrit dans le temps même de l’exode, qui donnait une idée précise et inédite de ce qu’est une société qui implose dans la guerre.
Avec ce film direct et affectif, Abbas Fahdel nous emmène vers un cinéma horizontal, reposant sur la relation aux sujets filmés, pris comme des sujets et jamais comme des objets, ce qui implique une caméra à l’écoute. Son objet n’est pas la réalité telle qu’on peut la filmer, mais la réalité telle qu’elle est parlée par les sujets eux-mêmes, conscients de participer au film et repérant le dispositif. C’est la grande différence avec Frederick Wiseman, William Klein, les frères Mayles qui cherchent une objectivité visuelle fondée sur une invisibilité théorique du filmeur… Ici, le filmeur se dévoile, enquête, attend, il est « avec » il n’est pas « entre ». C’est ce qui rapproche Abbas Fahdel de Jonathan Nossiter dans Résistance Naturelle ou encore d’Emad Burnat dans Cinq caméra brisées. Ce cinéma direct et naturel qui repose sur la manière dont une relation affectueuse cristallisée dans le cadrage peut servir de conducteur subjectif et éthique afin de mettre le spectateur au cœur du film, à table avec les convives et conscient de sa présence spectatorielle. C’est la richesse avant-gardiste de ces productions spontanées, nées de ces nouvelles possibilités légères de réalisation et de montage, quand elles sont entre les mains d’artisans qui savent mettre en scène leur regard pour le partager sans se mettre en avant … à tout hasard. C’est la force nouvelle des films qui ne savaient tout à fait qu’ils en seraient et finissent par inventer, grâce au soutien de distributeurs audacieux, un nouveau cinéma, dix fois plus libre et plus généreux.

Homeland : Irak année zéro, du sang et des larmes

« Homeland » : la chute de Bagdad

Le quotidien d’une famille de Bagdad en 2003 ou la grande histoire à échelle humaine. Un documentaire à la fois intime et immense.
« Homeland » dure plus de cinq heures trente, mais il possède le générique le plus court qui soit. En effet, Abbas Fahdel a assuré la réalisation, les prises de vue et le montage. Il s’agit pourtant bien d’un grand film, un témoignage exceptionnel sur une page récente de notre histoire.
Au cours de l’année 2003, Fahdel a filmé sa famille à Bagdad. L’ensemble est constitué de deux volets que sépare l’intervention militaire occidentale. « Avant la chute », la première partie, décrit le quotidien ordinaire de la petite bourgeoisie iraquienne. Une maison, des enfants qui vont à l’école et à l’université, la propagande. Et la guerre qui approche. On creuse un puits dans le jardin. On prépare du pain. On tend des couvertures devant les fenêtres pour se protéger des éclats de verre…
Dès les premières minutes, Haidar, 11 ans, aimante la caméra. Malicieux, gouailleur, il attend l’attaque, se réjouit à l’idée de ne plus aller à l’école et de se réfugier à la campagne avec ses cousins. Il a quelque chose d’un Petit Nicolas bagdadi. A cette nuance près : au bout d’un quart d’heure, un carton annonce qu’il mourra fauché par une balle après la chute du régime.
Au début de la seconde partie, « Après la bataille », les émissions à la gloire de Saddam Hussein ont été remplacées par des clips R&B. Bagdad n’est plus que ruines. Face à une armée d’occupation débordée et impuissante, le chaos a tout gagné, la rue appartient aux pilleurs et aux criminels. La vie continue tant bien que mal : on passe ses diplômes, on s’organise, on retrouve aussi des visages familiers dont le petit bouquiniste si attachant et bien sûr Haidar à peine moins insouciant.
Les guerres du Golfe nous laissent le souvenir flou de combats désincarnés : de cieux striés de lumières, d’écrans verdâtres, de génériques de CNN. Or, loin des satellites, au plus près des habitants, il y avait la caméra qu’Abbas Fahdel tenait serrée tout contre lui et tout contre les siens. Il lui aura fallu plus d’une décennie pour trouver la force de monter et partager ces images essentielles. Elles nous rendent enfin la guerre visible. Cependant, la beauté de « Homeland » tient aussi du contraste entre un pays démembré et une famille unie. Les ruines de Badgad sont les nôtres. Le sous-titre est d’ailleurs emprunté au film de Rosselini « Allemagne, année zéro ». Autre siècle, autres décombres, autre enfant et même épilogue. Aujourd’hui, Haidar aurait 24 ans.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/week-end/cinema/films/021684531410-la-chute-de-bagdad-1198922.php?30zB41hI7TzJ8zd5.99

Une nécessaire démesure
Plus de cinq heures pour Homeland : Irak année zéro,d’Abbas Fahdel (1), neuf heures pour Death in the Land of Encantos, de Lav Diaz (2) : le format du « film-fleuve » est hardi, mais approprié à l’ampleur du propos.
Abbas Fahdel livre ici « le film de sa vie ». En 2002 et 2003, ce cinéaste franco-irakien est revenu à Bagdad filmer sa famille au cours des derniers jours du régime baasiste, puis durant les premières semaines de l’occupation par la coalition militaire que dirigeaient les Etats-Unis. Mais quand, quelques jours après l’invasion de Bagdad, son neveu est victime d’une balle perdue, il renonce à monter la centaine d’heures de rushs en sa possession, où le jeune garçon était très présent. Ce n’est que dix ans plus tard qu’il se décide à les utiliser pour aboutir à ce témoignage unique, par lequel il a voulu « donner un visage aux Irakiens ». Divisé en deux parties, « Avant la chute » et « Après la bataille », son film suit d’abord le quotidien de sa famille, semblable à celui de tous les habitants de Bagdad, habitués aux privations depuis plus d’un quart de siècle, imperméables à la propagande de leur raïs, et qui se préparent au pire avec une espèce de légèreté teintée de fatalité, qu’ils stockent du pain ou qu’ils calfeutrent leurs habitations.
Dans la seconde partie, le ton change, ainsi que la géographie du film : Fahdel filme désormais hors de la maison de son frère. Se donnant le temps des rencontres, il découvre l’ampleur des destructions et les paroles de colère des Bagdadis. Les « libérateurs » sont devenus des « occupants » dans un pays dont ils ne savent pas assurer la tranquillité. Les images fixent avec acuité le début d’une décennie chaotique ; elles feront date.
Le cinéaste philippin Lav Diaz, lui, est coutumier des films hors normes. Il revendique en effet le droit de ne pas produire un cinéma conçu pour le marché. Filmant en noir et blanc, sans se soucier de qualité technique, il s’adonne à un cinéma ascétique où dominent de longs plans-séquences presque toujours sans mouvements d’appareil — « la caméra est statique parce qu’on attend que la vérité arrive ».
Death in the Land of Encantos (2007) frappe par sa radicalité absolue. Mélange de documentaire et de fiction, il propose à la fois les témoignages des rescapés du passage du typhon Durian au sud de l’île de Luçon, en 2006, et les conversations entre trois personnages, trois artistes qui s’interrogent sur leur rôle dans la société. Tous sont filmés dans les lieux dévastés par la catastrophe ; mais ce qui commence par le tragique des phénomènes naturels s’achève par le tragique du politique. Le personnage central, un poète, paiera de sa vie cette alliance mortifère, caractéristique, selon Diaz, des Philippines.
Dans cette œuvre sans concession esthétique, parfois proche de l’hypnose, Diaz entreprend de lutter contre l’oubli, « la plus grande maladie de l’homme » — l’oubli des colonisations subies par son pays et des longues années de la dictature de Ferdinand Marcos, dont le clan est toujours à l’affût. Une fois acceptée sa durée, ce cinéma de résistance n’a rien de rébarbatif. Diaz, qui le définit comme« romanesque », se présente comme un « travailleur intellectuel dont l’outil est le cinéma » (3), et s’appuie sur sa connaissance de Fedor Dostoïevski pour peupler ses films de personnages en quête des vérités de l’existence. L’œuvre qu’il construit n’est pas qu’une bataille contre les formes convenues ; c’est aussi une lutte contre tout ce qui asservit.
Philippe Person

«HOMELAND», L’IRAK EN PERTE DE RÉGIME
Un documentaire émouvant sur le quotidien d’Irakiens avant et après l’invasion américaine.
Avec les abominations commises par l’Etat islamique aujourd’hui, on a oublié celles que perpétrait Saddam Hussein quelque dix ans plus tôt. Si les premières sont menées aujourd’hui au nom du califat, les secondes le furent au nom du parti. Mais, entre le raïs et le calife, peu de différences si ce n’est que la dictature du premier, qui régna vingt-cinq ans, fut d’une cruauté extravagante et grotesque, comme en témoigne l’excellente série de la BBC The House of Saddam, irremplaçable documentaire-fiction sur la nomenklatura baasiste. Survint l’invasion américaine et Hollywood colla à l’événement avec des films, comme Green Zone, avec en arrière-plan le singulier conflit entre la CIA et le Pentagone, puis Démineurs, qui magnifie l’un des plus durs boulots au monde, et surtout American Sniper, le film de Clint Eastwood sur la vie d’un Black Seal (les commandos d’élite de l’US Navy), qui fut démoli par un pan de la critique française (dont Libé) – peut-être ne voulait-elle pas voir le conflit tel qu’il fut -, mais adulé par les reporters qui le suivirent, justement pour cette raison.
Il manquait la guerre racontée par les Irakiens à un réalisateur irakien – Abbas Fahdel. C’est chose faite avec Homeland, qui raconte, avec les yeux d’une famille aisée de Bagdad, ce que fut son quotidien pendant deux ans. Soit un documentaire de cinq heures et demie, divisé en deux parties : la première consacrée aux semaines qui ont précédé la prise de la capitale, la seconde à celles qui ont suivi. Même si, comme le dit Abbas Fahdel (que Libé avait rencontré en novembre), «l’Irak est invivable», son film est comme irradié par sa joie d’être aux côtés des siens, dans les épreuves, dans les chagrins, dans les joies – la naissance d’un enfant ou la réussite d’un examen.
Dans la première partie, on voit peu l’Irak, la caméra s’attachant à décrire l’attente interminable de la guerre au sein de la famille. D’où un certain ennui qui finit par contaminer le film même si tous les membres se révèlent des acteurs exceptionnels. La seconde partie, parce que le chaos s’installe, que les gangs apparaissent dans un Bagdad abandonné aux ténèbres en dépit de l’occupation américaine, est beaucoup plus dramatique. Et puis, la parole commence à percer les murs du silence bâtis par la dictature. Les Irakiens trouvent les mots pour dire ce que fut le défunt régime. Puis les gestes, comme ces gifles aux portraits du dictateur. «Voyez comme les Irakiens sont hypocrites ! lance une jeune étudiante. Hier, ils étaient obligés de lui écrire [pour son anniversaire, ndlr] ; maintenant, ils crachent sur lui.» S’ensuivra la montée du ressentiment à l’égard des «libérateurs» qui, multipliant les bavures et se montrant incapables de rétablir l’ordre, vont muter en occupants.
D’un bout à l’autre, le film est traversé par des moments d’une grande émotion, comme la visite de l’Office du cinéma, brûlé par les pillards qui ont détruit la mémoire du cinéma irakien. Un réalisateur ramasse une bobine et la berce comme un enfant. Dans ce geste, toute l’universalité du cinéma même sous la plus affreuse dictature : «On peut se venger d’un régime mais pourquoi se venger de la culture ?» Question, hélas, sans réponse.
Homeland : Irak année zéro documentaire d’Abbas Fahdel
http://next.liberation.fr/cinema/2016/02/09/homeland-l-irak-en-perte-de-regime_1432181

“Homeland ” : le grand docu intimiste sur la guerre d’Irak

Chronique documentaire d’une famille irakienne avant et pendant l’occupation américaine. Une somme élégiaque.
Ce documentaire fleuve de 5h34 en deux parties (Avant la chute et Aprèsla bataille) est le grand œuvre d’Abbas Fadhel. Né en Irak mais vivant en France depuis des décennies, Fadhel n’a cessé de filmer son pays d’origine (des documentaires et une fiction). Dans ce Homeland, à ne pas confondre avec une série américaine du même nom, le cinéaste retourne en Irak, une fois en 2002 et une autre en 2003, avant et après le déclenchement de la guerre par les Etats-Unis (mars 2003).
Il filme essentiellement sa famille, mais aussi, énormément, l’arrière-plan, le quartier, la ville, les rues, les universités, les commerces, les immeubles détruits (dont les impressionnants décombres des studios de cinéma). En gros, ce film c’est “la maison et le monde”. La maison, c’est plutôt la première partie, frères, neveux et nièces, etc. Home sweet home, rires, routine, insouciance, avec tout de même le spectre de la guerre qui se profile à l’horizon.
Guerre d’occupation
Le monde, c’est le second volet, où les joies et les jeux (des enfants) persistent, mais où le danger rôde partout dans Bagdad et a chamboulé le quotidien. La force et la beauté de ce home-movie, impeccable chronique de la vie quotidienne à Bagdad en temps de guerre, c’est de mêler constamment le familier et l’insignifiant à l’horreur et à la mort. Pas de bataille rangée, pas de combattants en armes – hormis bien sûr les troufions américains omniprésents qui affichent une certaine sérénité. C’est une guerre d’occupation plus que de conquête.
Le corollaire de cette présence américaine, de cette invasion accompagnée par des bombardements et des destructions, qui ont semé le chaos en Irak, c’est l’absence de règles et de garde-fous. Plus de Saddam, de parti Baas, ni de répression. La liberté de la presse règne (on est passé de 3 quotidiens à 58), et beaucoup de langues se délient sur les méfaits du dictateur déchu dont tout le monde semble content d’être débarrassé. Cela n’empêche pas la situation d’être désastreuse : problèmes d’alimentation, de travail, désorganisation, absence des institutions, et donc insécurité permanente.
Voile funèbre
L’Irak est devenu un no man’s land violent. Pillages, attaques et meurtres dus à des bandits isolés ou à diverses factions sont devenus la norme. Une inquiétude permanente et insidieuse plane tout le long de la deuxième partie, et se soldera d’ailleurs par un choc tragique. L’événement en question survenant à la toute fin nimbe ce qui a précédé (les 5 h 30) d’un voile funèbre. Le home-movie modèle est en même temps un tableau de l’enfer. Le destin d’une famille aimante et heureuse peut être brisé en une seconde par une chute de roquette ou une balle perdue. Le cinéaste prend lui-même de tels risques. Pourtant il cadre avec une étonnante sûreté, pose un regard extérieur et curieux sur la réalité de l’Irak (souvent derrière les vitres d’une auto).
Un travail double donc, subjectif et objectif à la fois, accompli avec une économie de moyens liée au budget insignifiant de ce documentaire qu’on imagine autoproduit, mais tirant le maximum de plus value esthétique de son matériau brut. Elégance du filmage et fluidité du montage. Le grand film intimiste sur la guerre d’Irak.


Homeland : Irak année zéro
Chronique familiale
Après une tournée des festivals mondiaux passée cet été par Lussas où nous l’avions rencontré, Abbas Fahdel voit enfin Homeland, Irak année zéro sortir sur les écrans français. La durée hors norme du film (près de six heures), si elle laisse au spectateur le temps de faire connaissance avec un pays et ses habitants, a de quoi inquiéter les programmateurs. Nour Films, son courageux distributeur, a fait le choix de segmenter le film en deux séances distinctes, respectant la logique interne de ses deux parties. Avant la chute et Après la bataille disent déjà à quel point le temps est la matière d’un film qui gravite autour d’un hors champ tragique, celui de la seconde guerre du Golfe, et qu’il aura fallu dix ans pour terminer.
Abbas Fahdel revient dans son pays natal qu’il a quitté depuis vingt ans. Il y il filme ses proches pendant près d’un an, de février 2002 à mars 2003. Avant le début des attaques américaines, il observe le quotidien d’une famille ordinaire sous la dictature de Saddam Hussein. Un quotidien où les jeunes adultes s’apprêtent à connaître leur deuxième guerre. Si Fahdel commence son film en nous invitant à la table de sa famille, c’est bien sûr une façon de renouer avec ceux qu’il a quittés si longtemps, tout comme d’inviter le spectateur à se sentir chez eux comme chez soi. Mais c’est aussi que, sous Saddam Hussein, il est dangereux de filmer autre chose que les conversations badines d’une famille unie. L’attente de la guerre donne au temps un air de perpétuelle hésitation. La famille du cinéaste se prépare à la guerre comme elle l’avait fait vingt ans plus tôt, creusant un puits dans son jardin ou protégeant ses fenêtres en prévision du choc des bombardements. En regardant dans un souk des statues d’artisans du passé fixés dans la simplicité de leur activité, la sœur du cinéaste remarque que c’est à cela qu’ils en reviendront, repasser les vêtements avec un fer chauffé au charbon, si le conflit est déclaré. La guerre ne se contente pas de faire balbutier l’histoire dans des situations identiques. Elle fige le temps, arrête l’évolution du pays pour le ramener à une époque du tout artisanal, transformant les hommes en paysans, quel que soit leur parcours. L’après-guerre ouvre les portes de la maison familiale pour aller sur les routes, dans les quartiers, rendre compte des ravages de la guerre et des absurdités de la présence militaire américaine. L’impression que, dans une époque comme dans l’autre, le temps s’est arrêté, est sans doute renforcée par l’écart de dix ans qui a passé entre le tournage et le montage du film, essentiellement dû à l’événement traumatique qui a empêché Fahdel de regarder ses rushes pendant une décennie. La mort de son neveu Haidar, âgé de douze ans et atteint d’une balle perdue survient dans le dernier plan.
Visite guidée dans les ruines
C’est Haidar, enfant qui grandit avec le film, qui nous guide dans les ruines de son pays paraît tout droit sorti du néoréalisme italien auquel le sous titre d’Homeland nous renvoie. Si l’on comprend la référence directe au film allemand de Rossellini, le garçon nous rappelle davantage le sourire du jeune Napolitain de Paisa que le désespoir suicidaire d’Edmund perdu dans les décombres de Berlin. Il se fait aussi cousin éloigné des personnages d’Abbas Kiarostami, lorsqu’il emboîte le pas du cinéaste pour devenir son relais à l’écran, livrant ses réflexions percutantes sur l’état de son pays ou interviewant ses habitants. Dans la violence de villes détruites et sous contrôle ennemi, on est sans cesse surpris par la vie qui résiste, comme les quelques naissances survenues dans la famille pendant la guerre en attestent. La difficulté à rentrer chez soi quand toutes les routes sont plus ou moins arbitrairement barrées par l’occupant n’empêche pas les étudiants de retourner à l’université ou les hommes d’aller travailler.
C’est encore la piste néoréaliste que suit le film lorsqu’un frère du réalisateur visite avec tristesse son ancien studio de cinéma, détruit par les bombardements. Cette scène agit comme un rappel à l’intérieur du film, des conditions de dénuement dans lesquelles s’effectue le tournage. Comme le néoréalisme italien que la destruction de Cinecittà a poussé à tourner en extérieur, Homeland, dans sa seconde partie, est presque exclusivement un film qui court les rues à la rencontre de leurs occupants. Cet homme qui comprend « qu’on se venge d’un régime, mais pas de la culture » met le doigt sur ce que Homeland a de si précieux : il invente les images d’un peuple, confisquées par celles de la propagande de Saddam Hussein, omniprésent sur les écrans de télévision, comme par la télévision occidentale qui a servi le discours d’une guerre invisible, sans corps et sans morts.
Des images, des visages
En arrivant à Paris pour y étudier le cinéma, Abbas Fahdel a suivi les cours de Serge Daney. Dans son articleRegarder (la guerre en Irak), le critique de Libération condamne le règne du visuel, flux sans regard qui nie toute existence à l’autre. À retardement, ce qui le rend encore plus touchant et tragique, Homeland semble répondre à ce que Daney appelait de ses vœux : ne pas s’en tenir aux ciels nocturnes zébrés d’éclairs sous le feu des bombardements permanents, mais chercher des visages. Ainsi est Homeland : un portrait de famille. Celle, à proprement parler, du cinéaste, seules personnes qui pouvaient accepter d’être filmées pendant la dictature. Celle, au sens plus large du peuple irakien. Alors que des témoins offrent à nos regards les portraits d’un proche assassiné injustement pendant l’occupation, ils racontent que l’armée américaine leur a interdit de porter le deuil. On comprend alors, en voyant les derniers plans de la tombe de Haidar, qui nous a servi de guide tout au long de cette chronique, que Homeland, sans jamais s’appesantir sur l’horreur et la douleur, est aussi un caveau de famille, un film mémorial du peuple irakien.
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/homeland-irak-annee-zero.html

‘Homeland, Iraq Year Zero’: Monumental film charts destruction of a nation
Latest update : 2016-02-11
A mesmerizing and deeply moving portrayal of the Iraq War as seen by Iraqis, Abbas Fahdel’s six-hour masterpiece is essential viewing for anyone hoping to understand the devastating implications of the US-led invasion.
In 1991, Iraq became a hapless party to the birth of televised warfare, as Western TV crews scrambled to get the best rooftop views of Tomahawk missiles raining down on Baghdad. The spectacle resumed, on a much larger scale, in 2003. Then came the big-budget movies. But somehow, 25 million Iraqis, a people unfortunate enough to have experienced both Saddam Hussein’s tyranny and the wrath of the Bush dynasty, were largely absent from the show.
Fahdel’s hugely rewarding documentary, which opened in French cinemas on Wednesday, is a reminder that one could watch a dozen of Hollywood’s obscene takes on the Iraq war and still have no clue as to what it meant to be at the receiving end of the war on terror. There is no “shock and awe” in his 334-minute epic, no American sniper picking off swarms of faceless insurgents – just ordinary Iraqis struggling to get along with their lives even as their world collapses.
“Homeland, Iraq Year Zero” was shot with a lightweight camera before and after the US-led invasion in 2003, while the Iraqi director, who lives in France, was staying with his family in Baghdad and the countryside. It is split into two parts, subtitled “Before the fall” and “After the battle”. The only thing Fahdel doesn’t show is the actual bombing that played night and day on Western media.
The film’s somewhat unoriginal title, juxtaposing two cinematic references, announces the director’s twin endeavor: exploring the flipside of the war on terror as he documents Iraq’s descent into chaos, with the neo-realistic poignancy of a Roberto Rossellini. As in the Italian director’s “Germany Year Zero”, much of this chaos is seen through the eyes, gestures and devastatingly lucid observations of a child.
Before the fall
We meet the filmmaker’s 11-year-old nephew Haidar and his siblings in the haven of their Baghdad home in 2002, in those anxious months when George W. Bush and his British ally Tony Blair were busy fabricating a pretext to invade Iraq. The immanence and inevitability of war pervades the movie’s first part, hanging like a cloud over Fahdel’s family as they go about their routine, drinking tea, playing games, studying for exams and gazing indifferently at Saddam Hussein’s omnipresent propaganda on TV.
War preparations – digging a water well, making dried bread, putting sellotape on windows that still bear the traces of previous conflicts – feel like a familiar drill. This is a nation steeped in war, from the devastating conflict with Iran in the 1980s to the Bush wars, passing by the “war with no name” – a reference to the brief bombing campaign former US president Bill Clinton ordered in 1998, dubbed “Monica’s War” by many Western commentators due to its concomitance with the Monica Lewinsky scandal.
Fahdel’s handheld camera bears witness to Iraq’s many layers of destruction, from ancient Assyrian ruins to children maimed by war and the crippling embargo of the 1990s. Its melancholic gaze – alternating between tender close-ups and longing shots of Iraq’s blue skies and ochre landscapes – appears to question whether, this time, the cradle of human civilization might be reduced to dust.
The director’s decision to tell the viewer, as the film unfolds, which of his relatives will eventually be killed, gives the footage a haunting quality, turning the protagonists into walking ghosts. “It’ll be a short war,” warns the extraordinarily prescient Haidar. “But intensive and destructive.”
After the battle
Part two resumes three weeks after the US-led blitzkrieg that toppled the Baathist regime. The fearsome shadow of Saddam Hussein has been replaced by ubiquitous columns of US armoured vehicles. There is a brief sense of relief as people begin to speak out against the deposed regime and dare to hope of a better future. Satellite dishes sprout on rooftops and the critical food rations are handed out for free.
But the mood sours as Iraq’s foreign occupiers prove incapable of running the country and guaranteeing basic security. With Iraq’s bureaucracy and security services disbanded, looters are free to plunder and torch people’s homes and public buildings, murdering and kidnapping as they please. Soon, the foreign invader is seen as a greater scourge than the brutal, unloved regime it toppled, and reports of American abuses draw cries of revenge.
Providing a little context but no commentary, Fahdel documents the widespread destruction wrought by the US bombing and the ensuing chaos. Guided by Haidar and his siblings, he gives a voice to the desperate folks who have lost their homes, jobs and families. It is hard not to squirm in one’s seat when the camera gazes at a throng of grinning children, each holding aloft ammunition picked up in the street and expertly naming the gun type as though it were a Lego model.
Undaunted spirit
Both a war film and a peace film, Homeland is a damning indictment of the catastrophic errors that dragged Iraq and the wider region into its present misery. It sets the stage for the rise of the Islamic State (IS) group and its bandwagon of bloodshed, hatred and destruction. It is also a deeply moving celebration of the people and culture the IS group has set about to enslave and destroy.
At a preview of his film in Paris, Fahdel said Homeland was born out of his urge to draw a portrait of Iraq before it was too late. The sense of impending destruction he felt in 2002, on the eve of the war, inspired his focus on the tiny details of life. Every shot of a scuttling cat, a drowning bee, a bustling bazaar, a date picker perched atop a palm tree, feels like a testament to a doomed world. “The film ends tragically,” he said. “But the situation now is far worse.”
But amid all the misery, there is an undaunted spirit running through the film. It survives in the wicked sense of humour of Iraqis long accustomed to corruption, oppression and war. It thrives in the unbroken enthusiasm of Haidar and his friends, able to make a game out of the slightest dirt mound. It radiates from young girls’ dogged insistence on completing their education even as their world teeters on the brink.
It took more than a decade for Fahdel to get over his family’s tragedy and look back at the 120 hours of footage he accumulated over 17 months. It would take him another two years to edit and produce the film, a task he undertook alone after production companies turned him down. He said it was his duty to complete the movie and help rebuild Iraq’s “audio-visual memory”. Those lucky enough to view this essential film will feel much the richer.

HOMELAND : IRAK ANNEE ZERO Partie 1 : Avant la chute / Partie 2 : Après la bataille Un film de Abbas Fahdel, Nour Production, 2016.
- 12 FÉVR. 2016
- PAR EMMANUEL PASQUIER
Il y a un peuple irakien. Le peuple irakien est un peuple martyr. Ces deux énoncés peuvent paraître deux banalités. Bien sûr, il y a un peuple irakien, qui en doutait ? Au cours des cinquante dernières années, il a subi trente ans de dictature, trois guerres et un embargo, son territoire fait l’objet d’une guerre civile impitoyable. Rien de nouveau à dire que c’est un peuple martyr.
Encore faut-il que ces énoncés prennent forme dans la conscience. Tout n’est pas langage. Il faut en finir avec le « linguistic turn ». Les énoncés flottent dans l’air, ils sont toujours un peu déjà là, « words, words, words », jusqu’au moment où ils trouvent, ou sont trouvés par, le juste catalyseur qui les projette dans notre conscience où ils se constituent en réalité. On dit « prendre conscience ». C’est-à-dire être saisi par le réel.
Dans sa douceur, sa fluidité, entre défilement de routes et scènes de la vie familiale, le film de Abbas Fahdel, est d’une rare violence. Quand, dans ma vie, ai-je vu un film où l’on suit un jeune garçon, tout sourire et humour, dont la présence éclaire le climat de guerre d’un sentiment que « la-vie-continue-en-dépit-de-tout », pour assister – quoique sans image explicite – à sa mort ? Non jouée, mais réelle. Heidar est mort. Le neveu du réalisateur, qui l’a suivi et guidé dans ses pérégrinations cinématographiques à Bagdad, se fait tuer d’une balle perdue de mitraillette. On avait beau être averti dès le premier volet du diptyque, on se disait qu’on avait peut-être mal lu, ou que cela resterait extérieur au film, puisque, après tout, il avait survécu à la « guerre » proprement dite. Mais non. Le film nous confronte brutalement à la mort de cet enfant – et, aussitôt, à l’impossibilité de filmer plus.
Avais-je déjà vu quelque chose d’aussi violent ? Jamais. Au point que l’on en voudrait presque au réalisateur d’avoir osé mettre cela dans un film. Fallait-il instrumentaliser la mort de son neveu pour faire œuvre malgré tout ? N’est-ce pas flirter avec le « snuff movie », quelle que soit la justesse des intentions ? Etait-il bien loyal d’utiliser ce ressort hyper-pathétique pour forcer le barrage de nos consciences ? Il faut que Fahdel nous explique que cet événement est celui qui a rendu impossible la poursuite de ce film, et impossible son montage pendant plus de dix ans, puisqu’il relate des événement de 2003, pour admettre le procédé, pour y voir un hommage, et peut-être une manière de donner un sens à l’événement, lui donner une chance d’être ressaisi autrement que dans son insupportable brutalité qui n’admet pas de représentation. Il y a quelque chose comme un « A la guerre comme à la guerre ». « Voilà ce qui s’est passé. J’ai choisi de le montrer parce que cela s’est passé ». « Cette mort est l’effet de la guerre, et si montrer cette mort peut aider à faire saisir ce qu’a été cette guerre à un public européen ou américain, alors j’ai raison de la montrer. »
Plus qu’une instrumentalisation, le film prend une valeur d’accusation : combien d’enfants morts, combien de Heidar – combien de Aylan Kurdi – faudra-t-il pour que vous nous regardiez ? Pour que vous nous voyiez tels que nous sommes – « if you prick us, do we not bleed ? » – : non pas comme une figure lointaine d’un « autre » hostile ou curieux à observer, mais comme une classe moyenne vivant dans une banlieue pavillonnaire et regardant « Mr Bean » à la télé. Une famille aspirant simplement à travailler – dans des hôpitaux, des écoles, des administrations, dans l’art ou le business – et à élever ses enfants. Non pas des fous sanguinaires ou des sauvages, ni des « damnés de la terre » comme damnés par essence, mais des gens normaux. Des occidentaux en vérité – et tant pis pour l’anthropologie : si la pensée de l’altérité doit servir d’alibi pour cautionner l’indifférence, alors choisissons l’ethnocentrisme qui rend sensible au malheur des autres.
La mort de Heidar est le traumatisme narratif par lequel le film nous frappe au cœur. Apparemment il nous faut un « shoot » de cette force pour que des images parviennent à notre conscience dans l’océan des images où nous baignons. Mais le film prend et lève parce qu’il parle de bien d’autres choses. La magie de la présence opère à travers la représentation, à mesure que nous sommes emmenés dans les lieux de Bagdad.
C’est l’anti-« Démineurs ». De son titre original The Hurt Locker, le film de Kathryn Bigelow (2008) signifie littéralement quelque chose comme : « là où on est coincé et où ça fait mal ». On pourrait le traduire par « la guéhenne ». Film entièrement centré sur les Américains, il thématise explicitement l’incapacité à communiquer avec les Irakiens, relégués au rôle de « hostiles ». Les seules tentatives pour créer des liens se soldent par de terribles échecs, que ce soit le gentil médecin qui essaye de communiquer avec la foule et s’évapore dans une explosion, ou, là encore, le petit garçon qui meurt dans les bras du sergent James (Jeremy Renner). L’armure de protection anti-explosion du démineur devient la métaphore de l’impossible relation avec le monde extérieur, comme un scaphandre dans un monde sous-marin – qui est un monde souterrain et brûlant : la guéhenne, c’est-à-dire l’Enfer.
Au-delà de son apparent réalisme, le propos allégorique du film de Bigelow est relativement clair. Or, précisément, c’est de l’allégorie qu’il faut sortir – et de la caverne aux simulacres en même temps – pour voir « le réel ». On peut toujours dire qu’un documentaire n’est pas plus « réel » qu’un film de fiction. Mais c’est faux. Un documentaire est une construction, le réel y est construit, soit. Mais toute construction n’est pas une fiction. Dans Démineurs, on voit mourir un enfant, mais il ne meurt pas vraiment. Dans Homeland, on ne voit pas mourir Heidar, mais il est vraiment mort. Le documentaire lutte contre la fiction. Le « Homeland » irakien contre le « Homeland » américain : le petit documentaire auto-produit qui essaye de montrer une vraie famille irakienne, contre la série-phare de la chaîne « Showtime », où la famille américaine se regarde en miroir déformant à travers les aventures du père de famille revenu d’Irak et converti au Mal.
Homeland, le documentaire, croît dans la conscience comme une bulle, dont la circonférence finit par se fondre dans l’espace de mes représentations du monde réel, donnant une place nouvelle à ce qui n’existait jusque-là que comme une abstraction : « les gens en Irak ».
Il est vrai que le monde mondialisé est bien exigeant avec nous. A quelle génération a-t-on demandé tant d’empathie avec tant de « gens » dans le monde ? Comme le disait quelqu’un dans le public, il faudrait voir le même film pour les Syriens, pour les Palestiniens, pour les Lybiens (bien oubliés en ce moment, l’éveil sera rude), pour tous les peuples en souffrance, à chacun de définir ses causes. On pense à Mafrouza, le documentaire-fleuve d’Emmanuelle Demoris, filmant la vie des gens qui habitaient les caves de cette nécropole en marge d’Alexandrie. Là aussi, le film faisait surgir une réalité et tendait à abolir les frontières de l’altérité – à les modifier en une altérité du prochain, plutôt qu’une altérité du lointain, créant de la communication, de la circulation entre ceux qui voient et ceux qui sont vus. Mais Mafrouza nous parlait d’un microcosme spécifique, aussi bien dans l’espace que dans le temps, puisque le site fut rasé peu après le film.
Bagdad n’est pas un microcosme. Homeland, précisément, la rend à sa dimension cosmopolitique. Il en retisse les liens avec les « gentes », au sens où l’on parle du « droit desgens » : le tissu des peuples qui couvrent la planète et forment le monde.
Signe des temps, Boussole, le roman de Mathias Enard (Actes Sud, 2015), tisse lui aussi les liens de l’Europe avec cet « Orient » dont tous les Edward Said du monde n’arrivent pas à purger l’« Occident ». Il s’agit beaucoup de la Syrie dans le roman d’Enard, et de mettre au jour toute l’histoire commune qui relie un « Orient » et un « Occident » dont la polarisation constitue en fait un système identitaire bien plus que l’opposition entre des essences culturelles hétérogènes : « Entretemps, il y avait eu Félicien David, Delacroix, Nerval, tous ceux qui visitèrent la façade de l’Orient, d’Algésiras à Istanbul, ou son arrière-cour, de l’Inde à la Cochinchine ; entretemps, cet Orient avait révolutionné l’art, les lettres et la musique, surtout la musique (…) la révolution dans la musique au XIXe et XXe siècles devait tout à l’Orient, il ne s’agissait pas de « procédés exotiques », comme on le croyait auparavant, l’exotisme avait un sens, il faisait entrer des éléments extérieurs, de l’altérité, (…) un large mouvement qui rassemble entre autres Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Bizet, Rimski-Korsakov, Debussy, Bartok, Hindemith, Schönberg, Szymanovski, des centaines de compositeurs dans toute l’Europe, sur toute l’Europe souffle le vent de l’altérité, tous ces grands hommes utilisent ce qui leur vient de l’Autre pour modifier le Soi, pour l’abâtardir, car le génie veut la bâtardise, l’utilisation de procédés extérieurs pour ébranler la dictature du chant d’église et de l’harmonie, pourquoi est-ce que je m’énerve tout seul contre mon oreiller maintenant, sans doute parce que je suis un pauvre universitaire sans succès avec sa thèse révolutionnaire dont personne ne tire aucune conséquence. » (Boussole, p. 120).
Le roman de Mathias Enard voit large. Il a une visée très ample, littérature, architecture, musique, c’est dans toute la culture qu’il piste la compénétration de mondes qui ont fini par appartenir au même monde, dans leurs différences mêmes. Il y aurait aussi à faire l’histoire de tous ceux qui ont voyagé contre le voyage, de Rimbaud à Nizan, de Levi-Strauss à Enard, pour en finir avec l’altérité, pour psychanalyser l’exotisme, pour faire advenir de la présence (ce qui n’est pas la même chose que du même) en deçà des représentations du lointain.
Donc il y a un peuple irakien. Le film construit en diptyque, présente un Avant et un Après la deuxième guerre du Golfe, entre février 2002 et avril 2003, avec une ellipse pendant la période de la guerre. Comme dans Le Désert des Tartares, le réalisateur, après avoir attendu le déclenchement d’une invasion tant annoncée, était rentré en France quelques semaines avant son déclenchement. Très traditionnel dans sa forme, adoptant sans complexe le format de la vidéo familiale, ou même touristique, parfois même de manière complaisante, le film vaut surtout par ce vis-à-vis temporel. Sans doute ne faut-il pas trop de recherche formelle quand les circonstances filmées sont si puissantes par elles-mêmes. Le contraste entre l’ordinaire et l’extraordinaire n’en est que plus poignant.
La vie quotidienne dans le premier volet est traversée de part en part d’une incroyable tension. Tout paraît prémonitoire puisque nous savons, nous spectateurs, que la guerre imaginée par les protagonistes va effectivement avoir lieu. On regarde chaque détail, chaque visage, chaque paysage, et l’on se demande ce qui, et qui, sera encore debout, après. Et il ne s’agit pas d’acteurs. Les visages des enfants dansant devant la caméra, comme dans n’importe quel film de vacances, prend la valeur très forte d’un témoignage de vie, d’une vie que l’on sait hautement menacée, et qui nous jette au visage : où sont-ils aujourd’hui, 13 ans après le film, dans l’Irak d’aujourd’hui, ces enfants qui nous font des grimaces ? Abus de pathétique ? Sans doute. Mais ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais enfants. Les filmer, les garder dans le film, ce n’est pas seulement pour nous que cela vaut, c’est pour eux aussi, pour eux d’abord peut-être. Ce film aura peut-être été leur tombeau, c’est-à-dire leur vaisseau vers notre regard. Et le cinéaste semble remplir son arche et remplir son arche, et tant pis pour ceux qui n’en peuvent plus de tous ces enfants, parce que ces images sont peut-être tout ce qu’il reste d’eux aujourd’hui.
Le deuxième volet est tout aussi étonnant. Pour des raisons inverses. La « guerre », finalement, a duré à peine un mois (20 mars-15 avril 2003). Tout le monde est encore là. Les vitres n’ont pas volé en éclat. Tout est pareil, mais tout est différent. Une deuxième fois, mais différemment de la première. On voit les gens qui se réveillent dans les décombres de trente ans de dictature impitoyable. Tout un système de vie est inversé. Les anciens baathistes sont mis au ban. Les portraits de Saddam sont arrachés des manuels scolaires. L’armée d’occupation est partout, mais l’insécurité règne. L’état de guerre hobbesien s’immisce peu à peu dans la vacance de la souveraineté, et l’on sent qu’entre les bandes armées et l’armée américaine, l’espace possible pour une vie civile ordinaire est de plus en plus restreint.
L’apparente normalité recouvre une situation absolument critique. Rétrospectivement, il est frappant de voir que les Irakiens à l’époque, en 2003, pouvaient espérer une véritable normalisation à court terme. Au bout du compte, l’invasion aurait mis fin à l’ère Saddam Hussein et permis l’avènement d’un régime républicain, rendant l’Irak au Concert des Nations. On mesure d’autant mieux l’étendue du désastre aujourd’hui. De ce point de vue, le documentaire est très lourdement à charge contre les Etats-Unis. Sans avoir besoin de l’expliciter, c’est à eux qu’il semble s’adresser en premier. Il renvoie aux Américains, abreuvés d’images de leurs propres militaires, l’image en miroir d’une famille irakienne middle-class dévastée par la guerre qu’ils ont apportée – a priori pas du tout ce qu’ils s’attendaient à voir au milieu de « Desert Storm ».
On aurait tort de croire cependant que les citoyens américains soient si peu sensibles à l’illégitimité de cette invasion – y compris hors des milieux intellectuels new-yorkais. Car il y a aussi un « autre côté » aux Etats-Unis. Dans The Other Side (Roberto Minervini, 2015), un autre documentaire, lui aussi un diptyque, consacré à des junkies de la Louisiane du Nord et à une milice paramilitaire du Texas, le discours sur la guerre en Irak n’est pas forcément celui auquel on s’attendait. Où l’on voit que le patriotisme à l’américaine ne fait pas nécessairement bon ménage avec les décisions de l’Etat fédéral, lui-même perçu comme un envahisseur. Un instructeur paramilitaire développe ainsi tout une théorie critique contre le « nation-building » à l’étranger. Il met très sérieusement en garde ses camarades contre le décret prochain de l’état d’urgence par Obama et l’invasion des Etats-Unis par les Casques bleus. D’où la nécessité d’un entraînement militaire dominical intensif. Avec une obsession : « We have to protect our families ». Le film de Fahdel, si cet instructeur le voyait, ne viendrait en rien bousculer ses représentations. Il viendrait sans doute au contraire conforter ses sentiments anti-fédéraux et l’idée que ces pères de famille texans sont, eux aussi, une sorte d’Irakiens de l’intérieur.
Emmanuel Pasquier. Février 2016.
![]()
L’Irak au cinéma : un lent cheminement vers l’image de l’autre

Depuis près d’un an qu’il fait le tour du monde, Homeland : Irak année zéro collectionne les prix en festivals, suscitant partout où il passe émotion vive et longs débats. Divisé en deux parties de près de trois heures chacune, cette chronique de la vie d’une famille irakienne pendant les semaines qui ont précédé, puis celles qui ont suivi l’invasion américaine de 2003, adopte la forme simple du cinéma direct, guidée par un point de vue humaniste, un amour des personnages, une modestie évidente face à la lame de fond dévastatrice de la guerre en marche. Le film n’en accomplit pas moins un geste décisif dont la valeur morale et la force politique se mesurent à la conviction qu’avait son auteur, Abbas Fahdel, au moment de le faire, d’agir au nom d’une impérieuse nécessité. « Je souffrais de la représentation qu’on donnait de l’Irak en Occident,confiait-il au Monde dans un entretien donné à l’occasion de la sortie du film. Je n’y retrouvais ni le pays ni les hommes. Vingt-cinq millions d’Irakiens étaient sans visage ».
Ces phrases résonnent avec les arguments que développait Serge Daney en 1991, dans la série d’articles qu’il signa, dans Libération, sur la guerre du Golfe à la télévision. « L’ennuyeux avec le film War in the Gulf, c’est qu’un des acteurs inscrits au générique n’est jamais là. Ni dans les rares images qui nous arrivent, ni dans celles dont l’absence, depuis des mois, devrait nous peser, on ne voit le peuple irakien. On parle de lui, on le plaint, on parle en son nom, mais on ne le voit pas. Comme s’il y avait trop intérêt à le faire passer le plus vite possible au rang de victime ou de martyr, ce qui est une bonne opération pour les politiques de tout bord. Car cet après-guerre dépend déjà de la façon dont les uns et les autres feront le plein des deux seules matières premières de la région : à savoir le pétrole d’un côté et le martyre de l’autre » (« L’Acteur manquant », Libération, le 18 février 1991).
Le peuple très vivant de « Homeland »
Réfugié en France depuis le début des années 1980, Abbas Fahdel a tourné Homeland auprès des siens. Lorsqu’il arrive, quelques semaines avant l’invasion, la tension est palpable. Les adultes ont en mémoire la précédente guerre du golfe, l’énergie est mobilisée par des opérations spécifiques – sécher le pain, calfeutrer les fenêtres, accumuler des réserves d’eau… – mais la guerre est encore à venir, et sa terrible dramaturgie n’a pas encore figé les postures des uns et des autres. Les personnalités ont tout loisir de s’épanouir devant la caméra, révélant au public occidental des frères humains, un peuple en vie, dont l’existence n’avait jusqu’à présent pas été figurée à l’écran.
Les médias, corsetés par les impératifs d’une propagande tentant d’empêcher l’éclosion d’un mouvement contestataire semblable à ceux qu’avaient inspirés les images de la guerre du Vietnam, ont relayé le fantasme de la guerre propre, sans morts, menée à coups de frappe chirugicale, par le biais de pools de journalistes tenus à distance du théâtre des opérations en 1991, remplacés en 2003 par le système à peine plus autonome, du journalisme embedded. Ni la télévision, ni le cinéma n’ont beaucoup montré l’Irak autrement que comme un champ de bataille.
La guerre résumée à de « terribles détails »
Par rapport à la description qu’en faisait Serge Daney, en 1991, la représentation du peuple irakien dans les médias a peu évolué de fait. Avec ses figures de mères éplorées, d’hommes hébétés, de victimes civiles érigées en martyrs, The Dreadful Details d’Eric Beaudelaire en propose une forme de synthèse. Dans ce célèbre diptyque qui provoqua des remous lors de sa présentation, en 2006, au festival de photojournalisme Visa pour l’image, dont l’aspect cinématographique souligne le caractère « mis en scène » (il a de fait été réalisé en studio, à Hollywood), le photographe articule une imagerie du champ de bataille issue de la tradition picturale classique et les clichés avec lesquels les médias représentent les conflits armés contemporains. Les victimes irakiennes y figurent ainsi au milieu d’une scène de carnage dont l’enjeu reste indéchiffrable, où les soldats américains sur le qui-vive, incapables d’identifier l’origine de la menace, apparaissent prêts à tirer sur tout ce qui bouge, tandis qu’un journaliste occidental embedded a naturellement trouvé sa place, et qu’un Irakien posté au balcon du premier étage, filme l’action avec un téléphone portable.

Battle for Haditha (2007)
Tout le storytelling de la guerre d’Irak est là, qui a structuré à des degrés divers un vaste corpus de films sur le conflit irakien. Réalisés à Hollywood dans leur grande majorité, ces oeuvres adoptent naturellement le point de vue de l’Amérique qui se donne le plus souvent, en l’occurrence, comme embedded. De Battle for Haditha de Nick Broomfield (2007) à Démineurs de Kathryn Bigelow (2008), de Green Zone de Paul Greengrass (2010) à American Sniper (2014) de Clint Eastwood, l’image secouée, captée avec une caméra qu’on dirait « embarquée », est devenue la norme de ce cinéma.
Au cinéma, héros archétypaux
et conflit illisible
Sam Mendes
Face au soldat hébété, traumatisé par l’absurdité du conflit invisible qu’était la guerre du Golfe (Jarhead, la fin de l’innocence de Sam Mendes, 2005), qui portait encore la mémoire des (anti-)héros des films sur le Vietnam, le peuple irakien est aussi invisible qu’il l’était dans le flux d’images vides que crachaient en continu les chaînes d’information pendant la guerre du Golfe.
Dyptique The Dreadful Details d’Eric Beaudelaire
Les héros américains évoluent aux confins du patriotisme et de la psychose, accros aux shoots de danger et de violence que leur procure la guerre (Démineurs etAmerican Sniper). Les Irakiens, eux, n’existent qu’en tant qu’ils représentent une menace potentielle – figures sans visage repérées via le viseur d’un fusil, kamikaze camouflé, ou repentant, femme voilée suspecte (que cache-t-elle sous sa longue robe noire ?), sniper déshumanisé (par opposition au sniper américain assailli d’affects contradictoires)…
Et rien n’interdit d’envisager les personnages du beau documentaire Of Men and War de Laurent Bécue-Renard, comme des projections de ceux de Bigelow et Eastwood – qu’il s’agisse des vétérans américains souffrant de stress post-traumatique ou des fantômes des civils qu’ils ont massacrés, ces hommes, femmes et enfants qui reviennent nuit après nuit hanter leurs cauchemars.
Ces films, comme d’autres, insistent sur le côté illisible du conflit, la nature incertaine de l’ennemi, la perte de repères aussi bien physiques que moraux à laquelle sont confrontés sur place les soldats américains, qui aboutit à faire tant de victimes parmi les civils. C’est toute l’idée de cette scène d’American Sniper, où tandis que se fendille la carapace du super-sniper interprété par Bradley Cooper, et qu’il annonce à sa femme au téléphone qu’il est prêt à rentrer, le combat se trouve progressivement enveloppé dans un gigantesque nuage de sable. D’où viennent les tirs ? Qui est l’ennemi ? Plus rien n’est clair, sinon qu’il faut tirer pour éviter de tomber soi-même.
Le cinéma ne s’est pas contenté de remettre en scène l’imagerie des médias officiels. Entre 1991 et de 2003, Internet est né, et avec lui la possibilité de faire ses propres images et de les partager. Le monumental stock d’images qui s’est soudain retrouvé à la disposition de tous a changé non seulement la manière dont on pouvait percevoir la guerre, mais sa nature même, comme en a attesté l’onde de choc provoquée par la révélation des sévices infligés aux détenus de la prison d’Abou Ghraib.
Comme le dit un des intervenants de Standard Operating Procedure (2008), un documentaire réalisé par Errol Morris sur ce sinistre épisode : « Vous pouvez tuer des gens, leur tirer dessus, leur faire exploser la tête… Tant que ce n’est pas photographié, vous ne risquez rien. Si des photos existent, en revanche, vous êtes cuits ». C’est le cœur de l’intrigue de La Vallée d’Elah (2007) de Paul Haggis, où l’aura d’un soldat américain récemment mort se désintègre – et avec elle tout l’honneur de l’armée américaine et le bien-fondé d’une guerre qui fut promue comme un combat du bien contre le mal – quand refont surface des images le montrant en Irak en train de se livrer à la torture.
Le point de vue de l’Amérique
Le rôle d’internet
Nick Broomfield
Kathryn Bigelow
Clint Eastwood
Errol Morris
Jarhead (2005)
Démineurs (2008)
American Sniper (2014)
Standard Operating Procedure (2008)
En reconstituant l’histoire d’un viol commis par des soldats américains (la même, à peu près, que celle qu’il avait mise en scène en 1989, dans le contexte vietnamien, dansOutrages) sous la forme d’un collage d’images de toute nature piochées sur Internet (télé française, informations irakiennes, images amateur filmée par les marines…), Brian de Palma redéfinit avec Redacted le cinéma comme une machine à recycler des images – et délégitime relativement, dans le même geste, toute instance productrice de discours, à commencer par la propagande américaine. Pas plus que les autres, toutefois, ce film n’a été capable de figurer le peuple irakien autrement qu’avec le visage archétypal de la victime. Contrainte par l’absence d’images documentaires, la fiction était impuissante à lui en esquisser un autre – qui fût singulier et vivant. Les six heures de Homeland, de ce point de vue, changent radicalement la donne. Elles pourraient bien inspirer de nouveaux récits, qui rendent enfin justice à l’existence du peuple irakien.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/visuel/2016/02/12/l-irak-au-cinema-un-lent-cheminement-vers-l-image-de-l-autre_4864175_3476.html#mfhLhXESdDcCs7vZ.99

“Homeland: Irak, année zéro”: chronique bouleversante d’un Irak qui bascule

Avant la guerre, après la guerre. Dans le documentaire “Homeland: Irak, année zéro”, le réalisateur irakien Abbas Fahdel raconte un moment d’Histoire au travers de la chronique douloureuse et tendre de sa propre famille, filmée avant et après l’invasion américaine de 2003.
La première partie dure de février 2002 à début mars 2003. La seconde couvre quelques mois après l’invasion américaine. La guerre à proprement parler, qui ne dura que quelques semaines, n’est pas filmée, donnant paradoxalement encore plus de force au documentaire.
“En 2002, lorsque la menace d’une guerre s’est précisée, j’ai compris que l’Irak de ma jeunesse, celui que j’avais quitté pour venir étudier le cinéma à Paris, était en passe de disparaître”, raconte dans le dossier de presse le réalisateur.
Abbas Fahdel retourne alors à Bagdad et filme sa famille au quotidien, essentiellement dans le huis clos de la maison, du jardin et de la terrasse.
Par petites touches, se dessine alors le portrait d’un Irak aujourd’hui disparu, les derniers mois d’un pays malade, sous le joug d’une dictature aussi effrayante que kitsch.
De la télévision, perpétuellement allumée, sortent les odes à la gloire de Saddam Hussein, “orgueil des Arabes” et “soleil de l’existence”. Aucun membre de la famille du réalisateur ne se risque à parler politique devant la caméra. Trop risqué.
Mais Fahdel filme un climat, une atmosphère. Le quotidien rythmé par les coupures d’eau et d’électricité, les effets de l’embargo international en vigueur depuis plus d’une décennie, les souvenirs des guerres passées, Iran/Irak, guerre du Golfe en 1991… et la crainte mêlée d’excitation de celle à venir.
Le président américain George W. Bush a placé l’Irak de Saddam sur l'”axe du mal”. Dans le salon de la famille de Fahdel, le petit écran montre des images de manifestation anti-guerre en France.
Comme toutes les familles irakiennes, celle du réalisateur se prépare. On fait des stocks de riz et de lentilles, on creuse un puits dans le jardin, des jeunes femmes hilares s’entraînent à mettre des couches de bébé sur le visage “en cas d’attaque chimique par les Américains”…
Etrangement, il y a encore beaucoup de légèreté. La guerre éclate le 23 mars, alors que le réalisateur est rentré en France. Il retourne à Bagdad quelques semaines après.
– Descente aux enfers –
Et c’est à la lente descente vers le chaos qu’assiste le spectateur dans cette deuxième partie. Cette fois-ci, Fahdel filme beaucoup en extérieur. Il accompagne ses nièces à l’université, découvre le Bagdad ravagé, tumultueux et sous occupation d’après-guerre. Convois américains. Barrages. Embouteillages monstres. Destructions.
Dans une scène poignante, il accompagne son ami Sami Kaftan, acteur irakien “aussi connu en Irak que Gérard Depardieu en France”, sur les lieux détruits des studios de cinéma de Bagdad.
“On peut se venger d’un régime, mais pourquoi se venger d’une culture? Pourquoi?”, pleure l’acteur en ramassant des monceaux de pellicules de films jonchant le sol.
Le spectateur est aussi témoin de la montée des tensions, du ressentiment anti-américain, de la peur face à l’insécurité, au chaos, aux pillages. La catastrophe apparaît inexorable à travers les scènes de la vie quotidienne, comme une nuit hallucinante de tirs secouant un quartier de Bagdad.
Restent la joie de vivre et l’espoir des jeunes neveux et nièces du réalisateur, les moments tendres d’un quotidien encore possible. “Qu’est-ce que tu es belle aujourd’hui!”, s’exclame le jeune Haidar, neveu de Fahdel et héros du film, en regardant sa soeur sur son trente-et-un pour ses examens de fac.
Et puis la tragédie irakienne fait brutalement irruption dans la famille. Haidar est tué par une balle perdue, de tireurs inconnus, un soir à Bagdad.
Après ce drame, les rushes resteront dans leur boîte pendant dix ans. Le film, dit Abbas Fahdel, est aussi “une manière de ressusciter” cet enfant.

“Homeland – Irak Année Zéro” : une projection poignante aux Rencontres Cinéma de Manosque
- 11h57 – 05 février 2016
Le film d’Abbas Fahdel, projeté jeudi à Manosque, plonge les spectateurs dans le quotidien des Irakiens en 2003.
«Ce film, c’est ma vie», précisait Abbas Fahdel aux Etats Généraux du film documentaire de Locarno qui ovationnait en août dernier la première présentation de “Homeland – Irak Année Zéro”. En effet, ce film est la longue chronique de la longue expérience de la guerre au quotidien imposée aux Irakiens par le cours de l’Histoire. Abbas Fahdel, qui vit et travaille en France depuis l’âge de 18 ans, est retourné voir sa famille en 2003 alors que l’intervention américaine se précisait. Il a filmé les siens avec le secret espoir d’aider chacun à prendre un nécessaire recul avec l’urgence quotidienne. “Homeland” retrace cette vie de tous les jours en deux volets qui constituent deux volets distincts et complémentaires.
«Avant la chute» donne à vivre ce climat troublant de l’attente de la guerre annoncée. La guerre au quotidien, les Irakiens savent ce que c’est, celle de 1991 est encore dans les mémoires. Ils savent qu’ils vont manquer d’électricité, d’eau potable, de carburant, que les vivres seront rationnés, qu’il faut consolider les maisons, qu’il sera difficile de circuler. Chacun se met alors à faire, à son niveau et à sa place, les préparatifs nécessaires : un puits est installé dans le jardin, une montagne de petits pains est mise en stock dans de grands sacs, les vitres du salon sont consolidées avec du ruban adhésif qui double celui qui reste de la dernière guerre. Toute la famille s’active avec simplicité et dans un climat d’écoute sereine qui contribue à la force du film. Le petit frère Haïdar est simplement«craquant». Pendant ce temps, la télévision déverse en continu des images à la gloire de Saddam Hussein.
«Après la bataille» témoigne d’après la défaite de l’armée irakienne du 20 mars 2003. Il n’y a plus de boussole, le pays est dévasté, les pillards sévissent, la sécurité n’est plus assurée, la population commence à s’armer, les filles ne sortent plus de peur d’être enlevées, la colère monte au rythme de la peur qui s’installe. La caméra s’embarque dans la voiture qui accompagne les enfants à l’école et à l’université. Avec le comédien et metteur en scène Sami Kaftan, on pénètre dans le désastre des studios de Bagdad où l’on prend la mesure des dégâts, on comprend en quelques images que des pans entiers de l’histoire d’un pays et d’un peuple viennent d’être effacés. Les morts ne se comptent pas. Mais la vie reste là avec la naissance de la toute petite dernière et le sourire paisible que savent garder tous les visages. Abbas Fahdel parle de “Homeland” comme d’un «Projet de Cinéma». Pour le spectateur, c’est simplement une Œuvre, une œuvre juste, vraie, prégnante, qui dit tout ce mal que les hommes savent se faire les uns aux autres mais tout l’amour et tout l’espoir dont ils sont capables. Sans artifices, sans certitudes. Un film grand et beau, qui justifie pleinement qu’on lui consacre les quelque six heures qu’il occupe.
A ne pas rater, les deux projections au Lido dans le prolongement des Rencontres Cinéma de Manosque : “Avant la chute”, lundi 8 février à 18 heures. “Après la bataille”, mardi 9 février à 18 heures.
De notre correspondante Françoise ROUGIER

« Homeland, Irak année zéro » : Abbas Fahdel filme l’histoire de son pays disparu
Le Blog documentaire partenaire d’un film événement en salles dès le 10 février ! « Homeland, Irak année zéro », monumentale fresque de plus de 5 heures, « home movie à résonance universelle » qui nous plonge en Irak, avant et après l’intervention militaire américaine. Le réalisateur Abbas Fahdel sera à Paris pour la sortie du film, et participera à une Première exceptionnelle mercredi prochain dès 17h au MK2 Beaubourg. Réservation indispensable sur Leetchi pour profiter de places à moitié prix – privilège dont vous êtes les seul(e)s bénéficiaires !… Dans l’attente, Benjamin Chevallier vous propose cet entretien réalisé il y a quelques semaines avec l’auteur du film.
Le Blog documentaire : Votre film entretient une résonance singulière avec l’actualité récente. Ces derniers mois, l’Etat français a réagi aux attaques terroristes de Paris par des bombardements sur l’Irak et la Syrie. Et ce, sans que la question des conséquences sur les populations civiles ne se pose vraiment dans le débat public. Comme si les habitants de la région faisaient partie d’une vaste abstraction médiatique. Contre cela, Homeland, Irak année zéro reflète-t-il avant tout un désir de fournir au monde une autre image de votre pays natal, incarnée et vivante ?
Abbas Fahdel : Absolument. Je vis en France depuis 20 ans, et je souffre de l’absence d’images des Irakiens. En 1991 déjà, pendant la première guerre du Golfe, on parlait de l’Irak tous les jours à la télévision, mais paradoxalement, on ne voyait jamais le vrai pays. Et en 2003, encore une fois, on ne voyait que Saddam, les armes de destruction massives, et les plans larges du ciel de Bagdad, de nuit, strié par les bombes américaines. Alors qu’évidemment, au-delà de cela, il y a 25 millions de civils irakiens, dont ma famille et mes amis. A quoi ils ressemblent ? Comment vivent-ils ? Qu’est-ce qu’ils pensent ? Tout cela, personne ne s’en souciait. Mais moi, en tant que cinéaste et en tant qu’irakien, j’ai senti le devoir de le montrer.
Et effectivement, Homeland : Irak année zéro est un excellent antidote pour désamorcer l’idéologie du choc des civilisations.
En tout cas, je serais très heureux qu’il y contribue. Dans les festivals américains qui ont montré le film, certains spectateurs sont venus s’excuser à la fin de la projection pour le mal que leur gouvernement avait pu faire à l’Irak. Ils me disaient qu’ils étaient trop jeunes, qu’ils manquaient d’informations à l’époque…. Ils étaient sous le choc, découvrant que les familles irakiennes ressemblaient en tout point aux leurs !
Et donc, évidemment, à mes yeux, la théorie de l’affrontement Occident/Orient ne tient pas debout. Elle n’est qu’un argument construit pour faire la guerre. Car il n’y a aucune différence fondamentale entre les peuples arabes en général – et irakien en particulier – et les autres. Les Irakiens sont des gens qui partagent les ambitions de tout le monde : ils veulent vivre en paix, éduquer leurs enfants, s’aimer, etc.
J’étais horrifié par la propagande dominante à l’époque de Georges Bush. Le monde entier semblait convaincu que l’Occident allait affronter l’Orient. Que c’était inévitable. Et encore aujourd’hui, il faut rester vigilant car cette idée refait souvent surface, comme après les attentats de Paris par exemple. Certains essaient de nouveau de nous faire croire que les Musulmans sont tous des terroristes. Moi, ma famille est musulmane, on la voit dans le film, et il me paraît clair qu’ils ne se lèvent pas le matin avec l’intention d’aller attaquer l’Europe.
Avec la première partie du film, on devient le témoin des derniers instants d’un Irak sur le point de changer irrémédiablement. Et il n’est pas commun de voir un documentaire parvenir à capter si fidèlement la fin d’une époque, l’Histoire en marche, l’avènement du passé … Existe-t-il encore aujourd’hui des vestiges de cet autre temps ?
Il y a toujours des Irakiens qui essaient de vivre sur place. Mais l’Irak que j’ai filmé n’existe plus. D’abord, géographiquement, le pays a éclaté. Le Nord – le Kurdistan – est indépendant. L’Est se retrouve sous le contrôle de Daesh (y compris la ville de Hit, où j’ai beaucoup filmé). Il n’y a que Bagdad et le Sud qui soient toujours aux mains du pouvoir central. Toutes ces divisions m’attristent beaucoup. Je considère qu’elles représentent un appauvrissement total. Je ne veux pas d’un pays où tout le monde se ressemble, partagent la même religion, la même langue, la même ethnie. Moi, l’Irak que j’ai connu était un pays arc-en-ciel, multiculturel. Aujourd’hui, tous ceux que je connais veulent partir. Y compris mon frère, qui a toujours été très attaché à son pays, mais qui souhaite voir ses enfants grandir ailleurs. Pendant longtemps, à chaque fois que je retournais en Irak, je découvrais avec surprise des gens optimistes, qui avaient envie de se battre et de rester. Ce n’est plus le cas désormais.
Si j’ai fait ce film c’est que, malgré toutes mes craintes, je gardais espoir pour mon pays. L’espoir que la guerre nous débarrasse de Saddam. L’espoir qu’au chaos de l’intervention américaine succède la démocratie. Aujourd’hui je dois dire que je suis nettement plus pessimiste.
Dans la première partie du film, la caméra ne nous emmène que très rarement à l’extérieur, dans les rues de Bagdad. Puis, dans la seconde, nous y sommes plongés constamment. Les langues se délient, les gens ont besoin de s’exprimer, et vous étiez là pour recueillir leurs mots. Comment comprendre cette évolution ?
Dans la première partie du film, sous Saddam, l’espace public n’existait tout simplement pas. Les gens ne pouvaient pas parler. Il y avait d’un côté le leader, le père, le Dieu, et de l’autre, la foule des anonymes sans visages, les Irakiens. La propagande de Saddam avait réduit le peuple à cela. Évidemment, il était strictement interdit de filmer à l’extérieur. J’aurais été arrêté si j’avais essayé, car je n’avais pas d’autorisations – d’ailleurs, je ne voulais pas en demander car je ne voulais pas d’un responsable du Ministère de l’Information qui m’accompagne partout sur le tournage et qui me dise à qui parler. L’Irak sous Saddam, c’était comme la Corée du Nord aujourd’hui … Par la force des choses donc, je me suis d’abord retrouvé à filmer exclusivement à l’intérieur, dans la maison familiale.
Mais une fois le régime tombé, la rue a changé, la parole s’est libérée. Et alors les gens ne parlaient pas que du présent, du chaos causé par l’invasion, mais aussi et surtout du passé, de ce qui leur était arrivé sous Saddam. Toutes ces choses qu’il ne pouvaient pas raconter avant, comme les arrestations et les exécutions. Pourtant, personne n’écoutait leurs histoires ; ni les médias, ni les hommes politiques. Moi, je voulais les entendre, donc je suis sorti filmer dehors.
Au total, vous avez filmé pendant un an et demi. Vous avez dû accumuler une quantité considérable de rushs … Comment s’est déroulée la phase de montage ? Comment construit-on un film de 5h30 ? A quel moment vous est venue l’idée du diptyque ?
Je n’ai eu l’idée de construire le film en deux parties qu’une fois arrivé en salle de montage. Au départ, quand je suis parti tourner, je n’avais aucune idée de ce que tout cela allait donner. Tout pouvait s’arrêter n’importe quand. Ma famille pouvait me dire qu’elle n’avait plus le cœur à être filmée. Les bombes pouvaient commencer à tomber du jour au lendemain. Il pouvait m’arriver quelque chose … J’ai donc filmé pour enregistrer chaque instant, tant que j’étais vivant, tant que la caméra fonctionnait, tant que j’avais des K7.
Ce n’est qu’en 2013, quand j’ai regardé les 120 heures de rushs, que j’ai vu qu’il y avait un film. J’ai tout de suite su qu’il serait long, et qu’il serait en deux parties. Cette structure s’imposait naturellement tant l’invasion américaine marque une rupture immense entre l’avant et l’après. Regarde Haidar ! Dans la première partie, c’est juste un enfant inconscient, il s’amuse à la campagne, il ne s’intéresse pas à la politique du tout … Et quelques semaines plus tard, après les bombardements, c’est une autre personne. Tu l’as vu cette différence ? Elle est énorme.
Le montage m’a occupé pendant plus d’un an et demi. D’abord, j’ai monté séparément les séquences que j’avais tournées, puis je les ai agencées les unes par rapport aux autres, en essayant de respecter la chronologie des évènements. J’ai abouti à un premier montage de 12 heures. Puis à un deuxième de 9h30. Pour enfin arriver à une version finale de 5h30. J’ai dû me séparer de certaines de séquences que j’aimais beaucoup, qui étaient très belles, mais qui ne racontaient pas la guerre. Car mon sujet à moi, dans le film, ça reste la guerre.
Votre neveu, votre nièce, votre frère et votre beau-frère, entre autres, sont autant de piliers sur lesquels reposent le récit. Comment ces membres de votre famille proche sont-ils devenus des personnages de votre film ?
Le casting s’est fait naturellement. J’ai une grande famille, et j’ai tout de suite écarté ceux qui ne voulaient pas être filmés, ou qui avaient un rapport compliqué avec la caméra. Je ne voulais forcer personne. J’ai donc choisi toutes les personnes qui avaient un lien apaisé à l’image. Puis ce sont elles qui se sont emparées du film … C’est exactement cela qui s’est passé avec Haidar par exemple. Même chose mon beau-frère, avec lequel j’ai un rapport d’amitié très fort. Lui, d’ailleurs, incarne quelque chose de très important : on le voit, chaque jour, obligé de faire trois voyages différents pour déposer ses enfants à l’école en sécurité. C’était important pour moi d’avoir un « personnage » qui véhiculait cette réalité. Car, s’il n’y a pas de « Superman » dans le film, il y a une myriade de héros du quotidien, et il en est un.
Et en effet, à de nombreux égards, Homeland : Irak année zéro relève presque du film de fiction !
C’est peut-être l’aspect le plus important à mes yeux. On me pose beaucoup de questions concernant la politique. Et c’est normal. Mais Homeland reste un film de cinéma. Il y a une citation de Godard que j’aime beaucoup et qui explique bien ma démarche : «Tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction ». J’ai essayé de construire une histoire, une évolution narrative. De forger un récit.
Il m’a donc paru très important de faire exister les « personnages », et de les distinguer le plus possible les uns des autres. Car avec Homeland, je n’ai pas cherché à raconter un évènement ; j’ai avant tout voulu raconter des personnages, sur une période d’un an et demi. Je voulais raconter ce qui se passait d’historique en Irak, mais à travers les répercussions que cela pouvait avoir sur la vie des gens. La guerre, on en parlait tout le temps à la télévision, avec des interviews d’hommes politiques et des images de destructions. Tout cela ne m’intéressait pas. Moi, ce qui m’intéressait, c’était la manière pour ces gens de traverser une situation aussi exceptionnelle.
Pour finir, je ne fais pas de barrière entre fiction et documentaire. Pour moi il y a du cinéma et du non-cinéma. Il existe beaucoup de fictions qui ne sont pas du cinéma. Et beaucoup de documentaires qui sont du cinéma. Wiseman, Wan Bing, c’est du cinéma. Ce n’est pas parce qu’ils filment des vrais gens, dans de vraies situations, que ce n’est pas du cinéma. Car pour moi, dans leurs films, il y a toujours un point de vue. Et à partir du moment où il y a ce regard, il y a de la création cinématographique.
Dans quelle mesure avez-vous mis en scène ce que le film nous montre ? On a parfois l’impression que les personnes que vous filmez ont été installées dans le cadre par vos soins et qu’elles parlent pour la caméra, tant la situation et les dialogues sont riches de sens. C’est par exemple le cas de cette séquence sur les rives de l’Euphrate, à Hit, dans laquelle votre neveu parle des bombardements avec ses amis…
Parfois, en filmant la réalité, on peut capter des choses absolument formidables, impossibles à saisir sur un plateau de fiction. Quel acteur, aussi extraordinaire soit-il, peut-il être aussi présent à l’écran que Haidar ? Ou que mon beau-frère ? Dans la séquence dont vous parlez, je n’ai rien demandé à mon neveu et ses amis. On est quelques jours après l’invasion : de quoi parleraient-ils sinon de la guerre ? La discussion est née spontanément, je ne crois pas l’avoir provoquée.
Ma mise en scène, je la vois davantage ailleurs. Dans les choix relatifs au cadre par exemple. J’ai notamment décidé de tout filmer avec un objectif grand-angle, qui n’est pas celui de la caméra, car je savais que j’allais souvent me retrouver dans des espaces réduits, et que je voulais intégrer le plus de personnes possible au cadre.
Plus généralement, moi qui aime cadrer à l’épaule, j’essaie de savoir dans chaque instant ce qui compte, ce qui est le plus important, ce qu’il faut montrer donc. Certes, cela se fait instinctivement au tournage, je n’y réfléchis pas sur le moment, je le sens. Mais cet instinct du moment est le résultat d’années de travail et de réflexion, qui, je crois, murissent depuis mon doctorat de cinéma…
Propos recueillis par Benjamin Chevallie

Homeland – Irak Année Zéro : La critique

Homeland est un incroyable document historique sur la deuxième guerre du golfe. Un documentaire portant sur la population irakienne avant et après cette guerre et la façon dont les gens vivent et survivent en Irak. C’est aussi un remarquable documentaire dont le générique se limite à un seul nom, celui d’Abbas Fahdel qui en a été le réalisateur, le directeur de la photographie, le monteur et le scénariste.Sentant venir une deuxième guerre du Golfe dont l’Irak serait le point focal, le réalisateur Abbas Fahdel qui vit en France depuis des années a décidé de retourner en Irak filmer les irakiens. Pour cela, il est retourné dans sa famille qu’il a filmée au quotidien chez elle et à l’extérieur.
Ainsi de février 2002 jusqu’à début mars 2003, il est resté en Irak avant de retourner en France pour la naissance de sa fille. C’est cette partie qui est traité dans le premier documentaire Avant la chute.
La guerre s’est déclaré juste après et le réalisateur a eu beaucoup de mal à retourner en Irak, ce qui lui a pris 2-3 semaines. C’est donc après l’arrivée des américains à Bagdad que le deuxième documentaire Après la bataille commence.
C’est un drame qui a mis fin au tournage. Il aura fallu 10 ans à Abbas Fahdel pour que ce dernier se décide à monter les images qu’il avait filmées. C’est le dixième anniversaire de cette guerre qui l’a décidé ainsi que l’envie de montrer un document incroyable aux spectateurs du monde entier et de rendre ainsi hommage aux gens qu’il a filmé.
Le documentaire, malgré sa longueur qui pourrait en rebuter certains, a été couvert de prix dans le monde entier et s’avère être un monument du film documentaire.
C’est une œuvre riche et puissante qui entraîne le spectateur au cœur d’une famille irakienne. On vibre, on rit, on pleure de concert avec ces irakiens qui nous ressemblent tant.
Si la première partie tourne beaucoup autour de la maison familiale et des ses environs, la deuxième s’ouvre plus sur une ville mutilée dont certains lieux comme la radio locale sont entièrement rasés.
La possibilité de circuler est d’ailleurs due à la présence d’un acteur très connu du cinéma irakien qui est resté auprès de d’Abbas Fahdel. La présence de la caméra pouvait ainsi s’expliquer par un tournage.
Mais si un certain nombre de personnes se retrouvent dans Homeland, notamment parmi la famille du réalisateur lui-même, c’est son jeune neveu Haidar qui sert de fil rouge à l’histoire. Ce dernier très présent à l’écran, fort photogénique et attachant, vie sa vie parfois avec insouciance et permet d’entreprendre un étrange voyage au cœur des bagdadiens.
Le documentaire est d’une force incroyable et, guerre oblige, il n’est pas rare de découvrir des personnes qui peu de temps après leur apparition à l’écran sont tuées. De discrets encarts notifient cela et il est difficile de ne pas avoir les yeux embués à la découverte de ces vies brisées.
Si les 6 heures du documentaire peuvent paraître décourageant de prime abord, à l’exception de quelques passages brefs un peu longs (notamment en deuxième partie), on ne voit pas le temps passer, immergé complètement devant ces quelques mois dans la vie des irakiens.
Il faut d’ailleurs féliciter le distributeur Nour Films d’oser sortir en salle un tel film et de le faire partager sur grand écran aux spectateurs.
Le documentaire réussi d’ailleurs le tour de force de montrer sans détours les horreurs de la guerre sans aucun parti pris. C’est l’histoire figée d’un temps passé qui est montré, celle des espoirs, des joies et de la tristesse d’hommes et de femmes qui ne veulent que vivre correctement.
Homeland est un magnifique documentaire qui est un témoin visuel remarquable d’une guerre terrible dont l’Irak ne s’est toujours pas remise à l’heure actuelle. Un film dont les personnages campent des portraits magnifiques de personnes souhaitant vivre dans le pays qu’elles aiment.
Exceptionnel !
Read more at http://www.unificationfrance.com/article42067.html#5doRG29iHYWf7CcC.99

Dans le quotidien belge L’Echo: “Des images poignantes, parfois drôles, qui forment un témoignage unique.”

Le Journal du Dimanche : “Personnel, émouvant, passionnant…”

Causette écrit sur Homeland: “une oeuvre bouleversante qui donne à voir et à vivre la guerre (puis le chaos) comme jamais.”

Pascal Mérigeau écrit à propos de Homeland:
“Rarement le choc de l’intime et de l’Histoire a été restitué avec une telle force”‘.
Pour lire l’intégralité de l’article (3 pages), cliquer sur les photos.
Très bel article de Camille Bui consacré à Homeland dans les Cahiers Du Cinéma (officiel):
“Malgré une tension permanente, au cours des cinq heures et demie du film, jamais la guerre n’apparaît de manière frontale. Les bombes et les morts disparaissent dans le hors-champ ou dans l’ellipse pour réapparaître dans les paroles et les regards. Loin d’instaurer une distance protectrice, ce parti pris confère toute sa force émotionnelle au film. (…) De cette mise en scène emphatique nait la puissance politique du film pour un public non irakien: la guerre n’apparait plus comme une succession d’abstractions militaires et médiatiques qui égrainent nombre de morts, cibles stratégiques et dommages collatéraux. Elle devient sensible en tant que violence réelle, faite à des hommes et des femmes, et inscrite dans l’histoire. (…) le documentaire de Fahdel, partant d’une bulle intimiste, s’étend pour gagner une ampleur collective bouleversante. Tout s’y construit à partir des liens affectifs qui se nouent au sein d’une famille, de part et d’autre de la caméra, mais pour mieux investir d’autres liens, avec les voisins, les amis, les concitoyens et faire circuler les affects à travers un peuple endeuillé et révolté. Ce grand montage de sentiments intimes et politiques plaide pour une compréhension complexe de la situation contemporaine et de la responsabilité occidentale dans les conflits au Moyen-Orient, à l’heure où une partie du territoire irakien est sous contrôle de l’Etat Islamique. La traversée cinématographique du homeland irakien parvient à transformer notre conscience à l’échelle du monde.”
Revue Images documentaires:
La filiation rossellinienne de Homeland
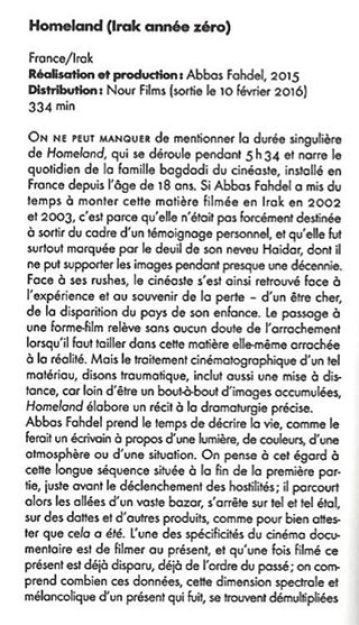


Transfuge Magazine: “Homeland n’est pas seulement le grand film d’un peuple, c’est aussi un document sur notre histoire actuelle.”

Vogue: “Six heures pour s’attacher à une vie… Et sortir bouleversé par une mort.”
“Peu porté sur le spectaculaire (…) ce documentaire fleuve dégage pourtant une puissance tragique folle. Elle émane de son regard immersif, plein d’intelligence et d’empathie.”

Positif – Revue mensuelle de cinéma:
“Homeland (Irak Année Zéro)
Le temps retrouvé
EMMANUEL RASPIENGEAS
« Le vent se lève,
il faut tenter de vivre »
Paul Valéry, Le Cimetière marin
Quelques mois après le coup de force esthétique que constituaient les quatre heures de Norte, de l’Indonésien Lav Diaz, et dans le sillage des trois volets des Mille et Une Nuits du Portugais Miguel Gomes, une nouvelle expérience hors-norme réussit à se frayer aujourd’hui un chemin vers les salles, proposée par le représentant d’une cinématographie décapitée par l’Histoire. Car c’est bien une autre façon de penser le rapport à la projection de cinéma que développent les deux parties constituant les plus de cinq heures de Homeland (Irak Année Zéro) du réalisateur iraqien Abbas Fahdel. Montage rétrospectif de centaines d’heures de rush filmées en 2003, avant et après l’invasion américaine de la seconde Guerre du Golfe, cette œuvre-fleuve arrive jusqu’à nous auréolée d’une impressionnante carrière en festivals, où elle aura réussi plusieurs fois à remporter dans une même édition les faveurs du jury et du public. Preuve que derrière sa durée intimidante et sa forme atypique se cache un grand film populaire.
Filmé en 2003, donc, mais monté plus de dix ans plus tard. La raison de ce décalage entre le tournage et la finition est tragique, et révélée dès les premières minutes du film. Le fil directeur de la narration de Fahdel, le héros de sa chronique, est son neveu Haidar, qui décédera quelques mois après la chute du régime de Saddam Hussein, d’une balle perdue, à l’âge de 11 ans. Incapable de filmer après ce drame, durant lequel il fut lui- même blessé, le réalisateur aura dû attendre le dixième « anniversaire » de l’invasion américaine pour réussir à s’atteler à la subtile architecture de son deuil. Muni de cette information, le spectateur se retrouve dès lors face à un film à suspens, parti-pris perturbant, mais jamais suspect de gratuité ni d’abjection. Faire survenir la mort de l’enfant sans crier gare eut été autrement plus dérangeant, et se faisant, le cinéaste augmente la force élégiaque de son requiem.
Filmé avec une caméra DV, le quotidien de Fahdel et de ses proches est un instantané à la forme brute, aux contours flous propre au numérique naissant du début du XXIe siècle. C’est de cette image en apparence peu maîtrisée que naît l’émotion, face aux reflets tremblotants d’un monde irrémédiablement disparu. Il y a une dimension proustienne dans cette très littérale recherche d’un temps que le réalisateur lui-même croyait perdu. Dans un geste se voulant exhaustif, Abbas Fahdel capte toutes les traces de vie se présentant devant sa caméra. Il observe, scrute, contemple, tourne la tête et son objectif sans pause ni repos, comme atteint d’une hypersensibilité du regard, dans une sorte de démarcation iraqienne et cinématographique de la nouvelle de Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Une tempête venue de l’ouest se prépare, et avec un calme que l’on devine inquiet, le réalisateur s’accroche à la technique la plus rudimentaire de captation visuelle, celle du home- movie, pour préserver tout ce qu’il devine prêt à être balayé : le bonheur d’être réuni en famille, le poids des souvenirs échangés, les moments d’introspection silencieuse d’hommes et de femmes attendant l’inéluctable… Il pointe sa caméra là où la vie la guide, comme un bâton de sourcier à la recherche d’une eau vitale. L’eau qui joue un rôle central dans ce passé recréé, exhumé de l’abîme de la tristesse, comme en témoigne une longue séquence où la famille du réalisateur s’active à creuser un puits artisanal dans son propre jardin, afin d’anticiper les pénuries d’eau potable. Aventure épique d’une durée étonnante, qui donne à voir l’effort et la technicité qu’une telle entreprise réclame, elle est le cœur joyeux du premier chapitre du film, auquel font écho de nombreuses promenades sur les bords du Tigre, où enfants et adultes profitent des ultimes langueurs estivales avant l’hiver guerrier. En tissant ensemble des petits détails et saynètes, telles que la traversée d’un zouk, la visite d’un antiquaire, l’observation de la cuisson de son pain par un boulanger, Abbas Fahdel fait de ce volet inaugural, intitulé Avant la chute, un film-herbier. Connaissant la terrible conclusion à venir, le spectateur se surprend alors à vouloir que cette première partie dure éternellement, pour pouvoir s’accrocher à ces sourires, ces élans enfantins détruits par une guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu.
Après cette cueillette faussement désinvolte, le documentariste filme, dans Après la bataille, son errance sur le champ de ruines de l’Irak nouvelle. Si la première partie construisait un entre-monde presque idyllique, où l’on devinait toutefois la chape de plomb du régime baasiste imposant le silence sur tout sujet politique, la seconde prend acte de l’assèchement de la source du jardin d’Eden, rendu aux broussailles et aux ronces. Abbas Fahdel filme la terre stérile et caillouteuse où ne poussent plus les fleurs qu’énumérait avec gourmandise son neveu. À elles, se substituent les munitions jonchant les rues, devenues en quelques semaines le nouveau domaine d’expertise des petits, qu’ils exhibent avec excitation devant l’objectif, comme on tend un bouquet. Aux tiges gorgées de sève des plantes répondent les filaments fondus des pellicules brûlées de l’ancien bâtiment de la télévision d’état. Séquence bouleversante où Fahdel ne peut que filmer pour partager, impuissant, le désarroi d’un de ses proches, qui empoigne à pleines brassées les parchemins de celluloïd, et tente, dans un geste dérisoire, d’y reconnaître des scènes, des visages, des titres, pour en imprimer une dernière fois le souvenir. Assèchement et éclatement sont les maîtres mots de ce second chapitre, où l’on assiste au retour d’une parole étoufée par des décennies de dictature. Les secrets, les rancœurs et les accusations contre l’ancien régime remontent soudainement à la surface, comme une nappe phréatique malsaine, bien différente de l’eau joyeuse d’Avant la chute. Après avoir creusé un puits, la caméra du réalisateur plonge dans la terre et dans les cœurs pour fouiller les charniers de Saddam. Mais le véritable sujet de cette longue conclusion est la cohabitation stérile et violente entre Iraqiens et Américains, pourtant débutée sous de bons auspices, portée par une joie palpable de la part des oppressés enfin libérés. Néanmoins, l’irruption des boys surarmés et manifestement perdus dans cet Orient mystérieux impose une évidence presque anthropologique, parfaitement captée par le réalisateur : dans ce décor complexe, les Américains sont des corps étrangers, des agents pathogènes d’un dérèglement à laquelle la société iraqienne n’était pas immunisée. Leur apparition dès la première image du second chapitre est un choc, après les trois heures passées dans le ventre chaud d’une société repliée sur elle-même. Nul opprobre n’est réellement formulé contre les soldats, qui ne sont que rarement montrés (tout au plus des silhouettes à travers des vitres de voitures, pour réclamer des laissez-passer), mais le réquisitoire est violent contre la présence écrasante de la première puissance mondiale, sourde et aveugle aux cris du peuple, première responsable de la déréliction d’une société fragilisée. Film-somme et film-monde, Homeland (Irak Année Zéro) marque d’une pierre blanche l’histoire du cinéma iraqien, et constitue un document d’une ampleur inédite sur les racines des dérèglements géopolitiques actuels. Mais également film-stèle : la mort du petit Haidar qui referme brutalement les 5 h 30 de ce mausolée symbolise l’impasse et l’auto-destruction d’une nation abandonnée, à laquelle Abbas Fahdel n’aura pu donner que la plus douloureuse des épitaphes. ”

“Homeland : Irak année zéro
un documentaire d’Abbas Fahdel. En salle le 10 février.
Comment filmer l’Irak à la lumière des trente dernières années de chaos? En montrant de ce pays ce qu’on n’a finalement jamais montré: ses habitants. Avec Homeland: Irak année zéro, son documentaire de cinq heures trente, Abbas Fahdel a certainement réalisé un grand film. Dont il raconte les coulisses.
« Entre amis, on était baasistes, communistes ou islamistes, mais on s’entendait bien, on allait voir les films ensemble.» En 1980, alors que l’Irak n’a pas encore connu les enfers successifs de la guerre contre l’Iran, des interventions américaines sur son sol et de Daech, Abbas Fahdel, Babylonien de 18 ans, décide de s’envoler pour la France. Le choix a été mûrement réfléchi : avec l’équivalent de 400 euros en poche, il part étudier le cinéma. Deux décennies plus tard, il rentre au pays pour y retrouver enfin sa famille. Les retrouvailles lui font l’effet d’une révélation. Il décide alors de filmer leur quotidien. De ces images de vie naît Homeland : Irak année zéro. « J’avais laissé mes sœurs étudiantes, et je les retrouvais mariées avec des enfants.» Avant son départ, Abbas fait un rapide casting et promet qu’il ne cadrera que ceux qui le souhaitent. Les meilleurs « acteurs », les plus « fluides » derrière l’objectif, reviennent avec insistance dans les scènes de vie quotidienne. « Au tout début du film, ma sœur me demande de ne pas la filmer. Elle veut se couvrir avant. J’ai préféré ne plus jamais la faire apparaître dans les plans. » Derrière sa caméra, Abbas apprend à connaître ceux qu’il a laissés derrière lui : «Pour mes petits neveux, j’étais l’oncle de France. J’avais mon portrait accroché dans leur séjour. Alors quand je suis revenu en 2002, il y avait une sorte de fascination commune. » Le réalisateur filme principalement à l’intérieur du domicile familial et prend soin de ne jamais enregistrer les conversations compromettantes sur le régime de Saddam Hussein. «Mon beau-frère dit par exemple à un moment quand la famille regarde Saddam à la télé: “Bon, change de chaîne”, en plaisantant. Si la censure avait vu cela, il aurait été exécuté, ainsi que toute la famille. Quand mes neveux chantent sur les toits en rigolant “Happy birthday Saddam” ils auraient pu y passer aussi.»
De Saddam à Daech
C’est un présupposé simple, logique et vérifiable une fois posé le pied à Bagdad: l’Irak des 18 ans d’Abbas Fahdel n’a plus rien à voir avec le lieu du chaos qu’il redécouvre. Le réalisateur franco-irakien est devenu étranger à son propre pays d’origine. Systématiquement visionnées, ses bobines font le tour des bureaux de la censure avant chaque retour en France. Dans la rue, on le questionne parfois sur la présence de sa caméra. Là encore, Abbas a trouvé une excellente parade à la paranoïa des autorités : arpenter les rues, caméra au poing, en compagnie de Sami Kaftan, alias le George Clooney irakien. «Quand on se faisait arrêter par les services de sécurité, je disais que je faisais un documentaire sur lui», se marre Abbas. De ses quelques semaines de vie et de tournage sous la présidence à vie de Saddam Hussein, l’homme ne garde pas un bon souvenir. «Déjà, on devait dire “Monsieur le Président”, “le camarade militant”, “le garde Hussein”. Vivre sous Saddam, c’était comme vivre en Corée du Nord. Un frère devait se méfier de son frère.» Toute la première partie regorge de non-dits, de sous-entendus lointains et de plans fixes axés sur la télévision familiale du domicile, branchée sur la chaîne du parti Baas où l’immense Saddam est loué tel un dieu immortel.
Pourtant, le 20 mars 2003, ledit dieu apporte mort et destruction en Irak et à Bagdad. Après des semaines d’attente interminable et de passages où les aînés de la famille racontent leurs guerres aux plus jeunes, aussi inquiets que curieux, l’armée américaine pilonne la capitale. Abbas est rentré en France entretemps pour la naissance de sa fille. Il revient tourner la seconde partie peu après l’incursion des GI. Là encore, il ne reconnaît plus le pays. Dans la famille, sortie indemne des bombardements nocturnes de l’aviation américaine, les langues se délient. Haidar, petit neveu d’Abbas, s’agite derrière la caméra avec une aisance proche de celle d’un comédien né pour les planches. Le garçon s’envole à mesure que le pays s’enfonce dans le chaos. Biberonné à la Nouvelle Vague et sensible à François Truffaut au temps des projections irakiennes dissoutes aux mélos indiens ou aux comédies musicales égyptiennes, Abbas en fait son personnage principal. « Truffaut disait, et je trouve que cela résume bien mon film: “Tout grand documentaire tend vers la fiction et tout grand film de fiction tend vers le documentaire.” » Dès lors, les deux deviennent inséparables. Des ruines de Bagdad contrôlées par les Américains aux souks de la capitale, en passant par la faculté et l’école de ses neveux, Haidar le suit partout. À la fois assistant réal’, personnage principal et neveu de 12 printemps, Haidar s’accapare l’écran et fait le show, allant jusqu’à imiter les discours de Saddam pour amuser la galerie. Il devient le porte-parole d’une population irakienne sans visage, délaissée par des médias obnubilés par la guerre. «Le fait de ne pas avoir mis de voix off, d’avoir fait le choix de ne pas interviewer d’experts ou d’officiels, était le résultat d’un ras-le-bol. J’ai-considérablement souffert de ces trente longues années de médiatisation. L’Irak, c’est le pays dont on a parlé le plus en trois décennies, mais sans jamais montrer les gens. Les 25 millions d’Irakiens n’avaient jusque-là pas de visage. Il n’y en avait que pour Saddam, ou maintenant Daech. » À Bagdad, personne ne regrette Saddam et Abbas filme les premières colères de la population locale contre la présence américaine. Si les GI apportent leur version de la liberté d’expression, leurs paquetages contiennent également leur lot de bavures: balles perdues, erreurs de bombardements, insécurité, arrestations arbitraires, destruction volontaire des dattiers – l’arbre référence du système économique et écologique de la région – ou explosions de cartouches à retardement. Non loin du bercail familial, des groupes armés se partagent les quartiers. De jour comme de nuit, il devient dangereux de sortir. L’espoir d’un nouvel Irak se révèle très vite être un immense leurre. Le drame n’est jamais loin pour Abbas et sa famille, et l’homme perd des proches.
Quand l’Irak fête le deuxième anniversaire de l’invasion américaine en 2013, Abbas Fahdel ressort des cartons de vieilles bobines. Voilà près d’une décennie qu’il ne les a plus visionnées. C’est trop insoutenable. « J’avais l’impression de composer avec des fantômes », avoue-t-il. Mais Abbas « se force à regarder » et le déclic est immédiat. Homeland: Irak année zéro naît une seconde fois. Dans la tête du réalisateur, tout commence à s’éclaircir : « J’ai commencé à le monter par la fin. C’était plus logique.» Problème, la première version atteint une durée de plus de douze heures et les refus de la part des rares distributeurs susceptibles de sortir le film sont légion. «Le format était toujours une contrainte. J’ai donc décidé de produire et de monter moi-même mon film. Il résume bien ce qu’est le cinéma irakien d’aujourd’hui : fait d’un objectif et d’un stylo.» La seconde version fait neuf heures et la dernière dure finalement cinq heures trente-quatre. Abbas laisse le choix du format au distributeur. En deux projections distinctes ou d’un seul trait, avec un entracte entre les deux. «Je préfère la deuxième option, avec une bonne pause entre les deux. Même si je sais que tout le monde ne dispose pas
emploi du temps… »
Propos recueillis par Quentin Müller et Jean-Vic Chapus


Le Monde
Lussas : « Homeland », une famille et la guerre en Irak
Le Monde.fr | 20.08.2015
C’est l’un des films événement des Etats généraux du film documentaire de Lussas, organisés du 16 au 22 août : Homeland (Irak année zéro), d’Abbas Fahdel. Une plongée minutieuse dans le quotidien des Irakiens, celui de la famille du réalisateur, avant et après l’intervention américaine de 2003. La caméra est à l’affût de tout, comme s’il y avait urgence à conserver une mémoire avant destruction. Le documentaire fleuve de 5 heures et 34 minutes, découpé en deux parties – l’avant et l’après –, a obtenu le prix du meilleur long-métrage (Sesterce d’or) au festival Visions du Réel, à Nyons (Suisse), et vient d’être primé à Locarno (Doc Alliance Selection Award).
La projection de Homeland à Lussas commencée à 14 h 30, mardi 18 août, s’est achevée vers 22 heures, à l’issue d’un débat. Pendant la pause, vers 17 heures, le réalisateur recevait un message d’un distributeur américain, désireux de sortir le film aux Etats-Unis. Homeland est déjà programmé auNew York Film Festival (du 25 septembre au 11 octobre), nous dit-il. En France, le documentaire sortira au printemps 2016.
Citant Godard, selon lequel « un grand film documentaire tend toujours vers une fiction », Abbas Fahdel a choisi ses « personnages » de Homeland,des membres de sa famille. Son beau-frère, ancien ingénieur de la radio irakienne, dont le bâtiment a été détruit ; sa nièce, étudiante, et tout particulièrement son neveu, Haidar, tout jeune adolescent qui devient vite le moteur du film, tant il est vif, drôle, et curieux de la terrible actualité de son pays. Dès le premier volet, le spectateur apprend sa mort prochaine. Il décédera après l’intervention américaine, dans un pays en plein chaos, victime de tireurs inconnus. « Il m’a fallu dix ans pour faire le deuil de Haidar, et replonger dans les rushes », explique sobrement Abbas Fahdel.

« Ce film, c’est ma vie », ajoute le réalisateur, auteur de Nous les Irakiens (2004) – un 52 minutes coproduit par Agat Films – et d’une fiction, A l’aube du monde (2008). Né en Irak, à Babylone, à une centaine de kilomètres de Bagdad, Abbas Fahdel a quitté le pays à 18 ans pour étudier le cinéma, à Paris. « C’était dans les années 1980. J’ai eu pour professeurs Eric Rohmer, Jean Rouch, Serge Daney. J’ai forgé ma vocation de cinéaste pendant mon adolescence, en Irak. Il y avait une trentaine de salles rien qu’à Bagdad ! J’ai découvert les films de Buñuel, de Hitchcock, d’Antonioni, sous-titrés en arabe. Le Mépris de Godard a été une révélation », dit-il.
Quand, en 2002, la perspective d’une intervention américaine se profile, Abbas Fahdel décide de retourner dans son pays. Il avait toujours gardé un vague sentiment de culpabilité depuis son départ. « Tout le monde savait que Bush allait déclencher les hostilités, mais on ne savait pas la date. J’avais peur pour ma famille, et je voulais documenter ce moment historique. »
Le volet 1 du film est une chronique de l’attente, dans un climat troublant, où règne paradoxalement une certaine légèreté. Pendant que la télévision déverse les images à la gloire de Saddam Hussein, les préparatifs rythment le quotidien : un puits est installé dans le jardin, pour que la famille ait de l’eau à peu près potable pendant le conflit ; une montagne de petits pains sera bientôt stockée dans un grand sac ; les vitres du salon sont consolidées avec du ruban adhésif épais et l’on voit encore les traces de celui utilisé lors de la dernière guerre, en 1991, etc. Haidar s’active, presque guilleret : pendant la guerre, il ira à la campagne…
« C’est comme des paysans qui s’attendent à un hiver rigoureux. Ils savent faire », résume Abbas Fahdel. Les Irakiens sont abonnés aux privations depuis plus de trente ans : « Il y a eu la guerre Iran-Irak, de 1980 à 1988, puis, après un court répit, l’intervention américaine de 1991, avec la coalition internationale. Ont suivi les douze ans d’embargo, qui sont peut-être pire que la guerre, et génèrent de la rancœur… Les gens de Daesh, aujourd’hui, c’est aussi la génération de l’embargo. » Entre 2002 et 2003, Abbas Fahdel tournait, tournait, et toujours pas d’invasion américaine. « Je suis reparti à Paris en mars 2003. Trois jours plus tard, l’intervention américaine avait lieu ! Le temps que je m’organise, je suis revenu quelques semaines plus tard. La ville de Bagdad était déjà tombée… »

Dans le volet 2, la famille du réalisateur témoigne de cette guerre qui aboutit très vite, après l’invasion du 20 mars 2003, à la défaite de l’armée irakienne. Mais cette fois-ci, il faut sortir de la maison, aller sur le terrain, filmer les destructions, enregistrer la détresse et la colère des habitants qui se sont encore appauvris. Les pillards sévissent, la police ne fait plus son travail, la population commence à s’armer, les filles ne sortent plus de peur d’être enlevées. Le cinéaste embarque sa caméra dans la voiture de son beau-frère, qui fait le chauffeur et accompagne ses enfants à l’école, à l’université…
Son ami, le comédien et metteur en scène Sami Kaftan, « aussi connu en Irak que Robert De Niro aux Etats-Unis », lui sert de « couverture » pour filmer à l’extérieur. Il lui permet aussi d’accéder aux studios de cinéma de Bagdad, dont on peut constater l’état de ruine, avec des tables de montage hors d’usage, et des montagnes de pellicules abandonnées.
Malgré le désastre, le film garde une certaine énergie, et toujours cette élégance de ne pas montrer l’hystérie ambiante. Le cinéaste fait part de ses sentiments mêlés : « Ce film est contaminé par mon bonheur d’être avec les miens. Et pourtant, l’Irak est invivable. Quand je suis en France, je deviens pessimiste sur mon pays. Tous les jours, on compte une dizaine de morts, mais plus personne n’en parle. C’est devenu la routine. Mais quand j’y retourne, je retrouve un peu d’espoir », dit-il, en évoquant les manifestations de ces dernières semaines : « Une nouvelle génération ose brandir ses slogans : “Ni sunnites, ni chiites. On veut un Etat laïque”. »
Enfin, Abbas Fahdel n’est pas peu fier de citer ce commentaire du réalisateur américain engagé Jonathan Nossiter : « Sur sa page Facebook, il dit queHomeland est un bon antidote à American Sniper », le récent film de Clint Eastwood, sur un tireur d’élite envoyé en Irak.
Par Clarisse Fabre
Homeland : Iraq Year Zero remporte les deux principaux prix desRIDM (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal):
Le Grand Prix
Le Prix du Public

Homeland : Iraq Year Zero remporte les deux principaux prix des RIDM (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)

Homeland : Iraq Year Zero remporte les deux principaux prix des RIDM (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
«HOMELAND», LE FILM D’UNE GUERRE
Rencontre avec le réalisateur irakien Abbas Fahdel autour de sa fresque documentaire, où il navigue, cinq heures et demie durant, dans le quotidien d’Irakiens avant et après l’intervention américaine. Une immersion saisissante.
Image extraite de «Homeland» d’Abbas Fahdel. Photo DR
La veille, le metteur en scène irakien Abbas Fahdel était au festival du film documentaire de Yamagata, au Japon, où il a raflé les prix d’excellence et du jury. Cet après-midi où on l’attrape entre un train et un avion, il sera au Festival international du film de la Roche-sur-Yon, pour une rencontre avec le public après la projection de son monumentalHomeland. Abbas Fahdel est un intermédiaire, un intermittent, un inter quelque chose. Il a passé sa vie entre l’Irak et la France ; il mène depuis quinze ans une carrière entre le réel et la fiction. Il est difficile de le bloquer durant une de ses oscillations transcontinentales.Pour le moment, Fahdel est assis dans une brasserie de la gare Montparnasse, commande un verre de vin et une salade César. Il a une sale tête et des gestes agités. «Je suis en jetlag, je ne dors quasiment pas depuis une semaine. C’est comme pendant mes films. Je ne dors pas pendant le tournage et après je tombe malade ou je m’écroule. Je ne sais pas comment je tiens physiquement.»
Coup de foudre pour «Jules et Jim»
Le titre Homeland n’est pas une référence à la série américaine où Claire Danes roule des yeux tous les quarts d’heure. C’est plutôt un clin d’œil àHeimat, la saga allemande sur un village rhénan. «Savoir qu’une œuvre comme ça existe m’a donné du courage pour construire la mienne. C’est important. J’espère d’ailleurs que mon film incitera des réalisateurs à prendre leur caméra. On sait que le projet vaut le coup quand sa vie en dépend», explique-t-il. De quoi la vie d’Abbas Fahdel dépendait ? De sa famille. Homeland montre, sur une durée de cinq heures et demie, le quotidien de ses proches en Irak, mais aussi de ses voisins, du quartier, de Bagdad et, finalement, de tout un pays, entre 2002 et 2003, avant et après l’intervention américaine. Le spectateur est plongé comme rarement dans un environnement familial autant que dans un contexte politique. Il apprend à creuser un puits, sait pourquoi scotcher les fenêtres en temps de guerre… «J’avais l’obsession de tout enregistrer. J’avais une formule : regarder et garder. Je suis devenu obsédé par les traces.» Le banlieusard Abbas Fahdel choisit alors, en 2002, de laisser en France sa compagne et sa fille de 10 ans pour retourner en Irak : «A quoi sert de vivre ici si ta famille meurt là-bas ? J’ai fait mon testament et je suis parti.»

Image extraite de «Homeland» (photo DR).
Fahdel avait déjà fait le voyage, au début des années 80, mais c’était alors dans le sens contraire, pour se rendre en France étudier le cinéma. Son père, de souche paysanne, travaillait à Babylone dans une prison, où il organisait les repas, et où il a peu à peu été en contact avec les idées progressistes des opposants emprisonnés. Après le travail, le père vendait des crêpes à la sortie des salles de ciné. Son fils Abbas l’accompagnait et, dans la foulée, voyait-revoyait-rerevoyait les comédies musicales égyptiennes ou indiennes, les westerns spaghettis, les films italiens… tout ce qui n’était pas américain. A 18 ans, dans le jardin de l’Institut français de Bagdad, il assiste à une projection de Jules et Jim.Coup de foudre qui l’incite à prendre la direction de Paris, où sans argent ni contact il va apprendre la langue, s’inscrire en fac et finir doctorant en cinéma dix ans plus tard.
Cette époque de la guerre Iran-Irak, il ne la passe pas à Bagdad mais à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), dans un étage d’une maison loué à des étudiants. Il ne veut pas retourner au pays où il serait enrôlé sous les drapeaux. «Je ne voulais ni tuer ni être tué», tout comme son voisin de chambre, un Iranien. Pendant vingt ans, Abbas écrit sur le cinéma pour des revues arabes et prend des nouvelles de sa famille par le biais du téléphone ou du courrier. «Ceux qui restent de ma génération sont considérés comme des survivants qui ont traversé la guerre Iran-Irak, la guerre de 1991 et celle de 2003.»
Les langues se délient
Le visionnage de Homeland, qui devrait sortir en salles le 10 février 2016, est à considérer comme une expérience dont le point de force se situe au début de la seconde partie. La guerre est passée, Saddam est en fuite, les soldats américains sont là. Les Irakiens ne leur sont pas hostiles, mais quelque chose cloche : des routes sont barrées, il faut emprunter d’autres itinéraires, montrer ses papiers. La vie a changé. Les langues se délient sur Saddam le tyran. Peu à peu la présence des mitrailleuses irrite, effraie. Les soldats deviennent des intrus, ce que le spectateur, immergé depuis quelques heures avec ces protagonistes qu’il connaît et qu’il a vu évoluer dans une succession de moments familiaux presque intimes, parvient à saisir, comprendre et ressentir.
«C’est le problème : les Américains se sont conduits comme une force d’occupation et non de libération. Ils ont fait d’énormes bourdes, comme dissoudre la police. Du coup, tous ces policiers baasistes du régime sont devenus dangereux.» Ceux-ci forment des bandes, s’en prennent à la population. Alors, les familles s’arment. Haidar, le neveu d’Abbas, 12 ans, joue avec une mitraillette qu’il a appris à charger après la guerre.
La première partie du film est un Striptease baigné d’une angoisse insouciante : on lit l’inquiétude sur les visages des adultes, mais les enfants jouent toujours et les ados déconnent. La seconde partie s’apparente à un cauchemar : l’inquiétante étrangeté se trouve à chaque coin de rue, dans la découpe des ruines, dans la présence de soldats à la fac. Puis c’est l’horreur, les dégâts collatéraux et les gros plans de brûlures sur des corps d’enfants.
«Pour moi, présenter le film à New York [il y a quelques semaines, pendant son tour du monde des festivals, ndlr] a été important. Des gens, des Américains, sont venus me voir à la fin pour s’excuser. Souvent, les spectateurs font ça. Ils expliquent alors qu’ils étaient jeunes et mal informés», comme s’ils n’avaient pas réussi à comprendre qu’en Irak «il y avait aussi des Irakiens».«Je pense que j’ai réussi à donner un visage aux Irakiens avec ce film», explique Fahdel, qui ne rechigne pas non plus à mettre en scène certaines séquences, comme le montrent ces moments découpés et filmés sous deux angles différents pour une seule caméra. «Pour moi, le documentaire et la fiction n’existent pas. Beaucoup de films sont des téléfilms et beaucoup de documentaires sont du cinéma.» Un mélange dont use aussi la propagande du régime, comme retransmise à la télé dans des clips à la gloire de Saddam. Fahdel aime à citer cette phrase de Godard : «La fiction tend vers le documentaire, et le documentaire vers la fiction.» Il a casté les membres de sa famille, les a archétypés pour pouvoir mieux révéler les aspects de ce «village-monde» : «En visionnant ce film, je pense que vous connaissez l’Irak comme si vous y aviez vécu un ou deux ans.»
Une nouvelle inquiétude
Ce pays qu’il a filmé jusqu’à la tragédie qui scelle la dernière scène et qu’on taira, a pour lui aujourd’hui disparu, découpé et noyé dans une nouvelle inquiétude distillée par l’islamisme. Mais la guerre, la crainte et la violence semblent au fond l’essence du pays. Une séquence montre un acteur retourner dans les studios de cinéma de Bagdad, brûlés. Les trépieds sont cramés, les projos sont devenus des masses noires fondues. Il trouve un chapeau sur le sol : «C’est celui que je portais quand je jouais le patriote Sliman. Il assassinait le lieutenant colonel Leachman pendant l’occupation britannique.» Au premier étage, es salles de montage aux tables noircies. Au mur, une photo d’Alain Delon. Par terre, une bobine 35 mm. Il en regarde des photogrammes à la lumière du soleil : «C’est un film de guerre.»
‘Homeland’ puts faces to Iraq War
The longest film at True/False 2016 makes survival a family affair.
In a stunning six-hour homage to his family and the place of his birth, Iraqi-French director Abbas Fahdel presents a critical message about the tangible consequences of unchecked American foreign policy in the Middle East that is worth all its 364 minutes.
Following his own extended family in the months before the 2003 American invasion of Iraq and the subsequent occupation, Fahdel creates an image of Iraq that many Americans may not have thought ever existed.
Just like in America, the children giggle at music videos on the computer, have to read Plato for homework and enjoy comic books and watching Tarzan in their spare time. However, alongside this normalcy, children and adults alike prepare for war. They build wells and pack bags full of dried bread and urge their relatives to start buying water bottles.
And in the midst of what some Americans might see as truly terrifying, many of the Iraqi people still find humor in the encroaching darkness. Some of Fahdel’s nieces and nephews laugh hysterically when given diapers in case of chemical weapons. In a disconcerting scene during the first part of the movie (before the invasion), Fahdel films a huge gang of children playing war in the streets with Styrofoam and rocks in a game that slams the audience with a horrible sense of irony.
After a thirty-minute intermission, we return to what several people in the film refer to as “the new Iraq.” Now, Americans sit atop tanks outside of national museums and in the streets. Huge traffic jams and no public transportation makes moving around difficult; car thieves and unchecked gangs, thieves and murderers force many Iraqis to stay in their homes after sunset.
However, it quickly becomes obvious that the American presence is a major cause of these new dangers. Iraqis have gone from being controlled by the oppressive and human rights-violating Saddam Hussein to something that teeters in and out of dangerous anarchy. Listening to Iraqis detail life under American occupation makes the Bush administration’s naming of the invasion Operation Iraqi Freedom feel even more bitterly hypocritical and ironic.
Fahdel’s compelling, three-dimensional picture of Iraqi people also comes alive through an astounding number of video portraits of citizens of all ages in neighborhoods and markets. His nephew Haidar also adds an indescribable element of soul to the film. At just 12 years old, his personality colors the everyday life of his family, whether he is complaining about his sisters not working hard enough or arguing with old men in the market about their opinion on Saddam. These sections of the film feel like a desperate cry for the audience to realize the humanity of Iraq and prove that this is not a movie about violence. Rather, it shows how ordinary people deal with the tragedies and consequences of war and ineffective governments.
Fahdel also explores one of the lesser obvious tragedies of war—the destruction of a culture. We follow Iraqi actor Sami Kaufman through burnt out theaters and explore the nearly destroyed national film and television archives after the war.
Hopefully the film will provoke Americans to actually think about why other countries may not like the United States, let alone want its help. At one point in the film, an Iraqi man asks why the American government “must stop progress here and bomb the whole world for Americans to feel safe,” and forces the audience to think critically about how the West handles global policing.
In this coming election year, Americans need to bear witness to the mess they’ve helped create and “Homeland: Iraq Year Zero” is an important step in encouraging some sort of accountability for effectively destabilizing an entire region using years of damaging foreign policy.
Humanity was born on the banks of the Tigris River that runs in the background of the film and it’s clear that despite terrifying conditions, humanity and love still flows in Iraq thanks to people like Fahdel’s family.
MOVE gives “Homeland” 4.5 out of 5 stars
http://move.themaneater.com/stories/2016/3/8/homeland-puts-faces-iraq-war/#.VuLub_l96M-
Homeland (Iraq Year Zero) vient d’être récompensé par le jury et le public du Festival International de Yamagata.
Le Jury de la compétition internationale lui décerne le Prix de l’excellence (Award of Excellence), et le Public lui décerne son prix (Citizens’ Prizes).

The Trophy is designed for YIDFF by sculptor Azuma Kenjiro. It is modeled after the bright yellow-green stalks of rice plants at harvest time, one of the symbols of Yamagata City and Yamagata Prefecture.

Publié le 27 janvier 2016 à 09h26 | Mis à jour à 09h26
Homeland: Iraq Year Zero: chronique d’un Irak qui bascule

Une nouvelle récompense pour Homeland : Le Prix du Public, remporté au festival international de Ficunam, à Mexico


POR JORGE AYALA BLANCO
En sólo 7 días, pero incluyendo 90 filmes repartidos en 5 secciones (Competencia Internacional, Ahora México, Manifiesto Contemporáneo, El Porvenir, Aciertos: Encuentro Internacional de Escuelas de Cine) y varias retrospectivas pertinentes (Gomes, Khutsiev, Julien, López Aretche), el festival arrancó por su plato fuerte: Visita o memorias y confesiones (1982), el inesperado obsequio post mortem del legendario portugués superlongevo Manoel de Oliveira (1908-2015), deliberadamente autorretenido por más de 33 años, con ávido hurgamiento feraz del espacio casi único de una solariega mansión laberíntica donde vivió 40 años y creó las primeras 20 de sus 64 cintas, ultraliterarias voces-eco dialogantes en off a lo India Song (Duras 75) fantasmalmente escritas por Agustina Bessa-Luís, neovanguardista creación en hueco hiperreal tipo Straub-Hanoun-Akerman, autorretrato de un genio conservador hijo de principios del XIX prolongándose hasta el XXI, álbum de familia archiburguesa y su decadente poderío fabril, detonantes confesiones a cámara del realizador apenas septuagenario, retrato floral de la esposa María Isabel abnegada estilo ibérico aberrante, delirio-añoranza de la virginidad femenina como forma exclusiva de la santidad, recuerdo traumático de los injustos 10 días carcelarios que dura duraderamente conmovieron al cineasta durante la dictadura, arrasadora ceremonia-saudade del adiós fatal y la sombra invasora de una magnífica magnolia inmisericorde.
Prosiguió a tambor batiente con El blues de Kaili del precozmente inasible debutante chino de 26 años Bi Gan narra la humilde travesía existencial-onírica en varios presentes, pasados y futuros, de un expresidiario médico-poeta rural en busca de su querido sobrinito cuyo torvo padre Cara de Loco acaso vendió o hizo refugiarse en una provincia lejana, un viaje primero inmóvil con poemas radiofónicos y luego territorial, a base de alígeras tomas dinámicas de ejecución imposible, cierto antológico plano secuencia comunitario de 41 minutos multiespaciotemporales y una deliciosa ronda encantada de criaturas pluridialectales. El evento del matemático bielorruso Serguéi Loznitsa escarba y profundiza en el subversivo momento clave de la caída de la URSS exacto del 29 al 31-VII-91 en un Leningrado desde entonces de nuevo San Petersburgo, como antes lo hizo en la reciente insurrección ucraniana en Maidán(14), pero ahora con tomas de archivo en b/n de 12 formidables fotógrafos, para leer la belleza de la revuelta popular en los rostros y actitudes corporales de los anónimos participantes y sus arengas y cánticos espontáneos, todo enmarcado en pausas-comentario irónico de El lago de los cisnes de Chaikovski, ¿o era El chapoteadero de los patos del fin de la pesadilla comunista para dar paso a otra impunidad? Y Un piso más abajo del rumano Radu Muntean, sobre la torturante imposibilidad de delatar al vecino feminicida, reemplazando el viejo drama de la responsabilidad ético-política socialista por el de la castración existencial.
Pero el centro gravitacional del evento fueron las casi 6 subyugantes horas de Patria (Irak, año cero) del preciso hombre-orquesta iraquí Abbas Fardel, que describen con nulo exotismo ni pathos impostado la cara sonriente pese a todo del ignoto país otro, primero preparándose con TValegría para su trágica inmolación durante los últimos temerosos días del régimen totalitario de Saddam Hussein (Parte 1: Antes de la caída) y luego apenas recuperándose del inicial ramalazo invasor (Parte 2: Después de la batalla), en un díptico raro y cercano a la vez, una cinta casera a nivel barrial-nacional sobre el reverso genuino de un martirologio colectivo sin faz humana en la industria de la manipulación de las conciencias, ahora dentro de la calidez cotidiana más común e inmediata, hecha del infatigable bombeo en el jardín hasta que salga agua limpia o la cinta protectora en el ventanal sobre la del conflicto bélico del 1991, y luego, de la omnipresencia de zonas infranqueables y desvíos, recorrido en auto por devastaciones urbanas con rostro sufriente y otras físico-espirituales devastaciones fuertemente individualizadas, saqueadores acechantes, cementerio de archivos fílmicos, niños de un incallable coro helénico clásico cual guías del horror, soldados yankies buenaonda aunque armados hasta los dientes y una elegía islámica leída sin gloria del dolor en el júbilo diáfano de un sobrinito de súbito desaparecido dentro del flujo funeral de este magma visibilizado.
Aunque hubieron propuestas más lúdicas y celebratorias, como Justo ahora, mal entonces, donde el delicado miniaturista sudcoreano Hong Sang-soo corrige su trama por una sola infinita vez pero a loHechizo del tiempo (Ramis 93), sin lograr que el alígero relato irónico sobre un desesperado ligue erótico transferencial logre romper la infame horma-barrera autorrepresiva; como Maestà, la Pasión de Cristodel francés Andy Guérif, donde se van activando genealógicamente uno a uno los 26 paneles de un políptico del XIV de Duccio de Siena, en viviente estado de gracia bidimensional; o como John From del joven lusitano Joao Nicolau, jubilosa fantasía amorosa adolescente, en la lírica vía juvenil abierta porAquel querido mes de agosto del jocundo Gomes (08), alrededor de una alucinada quinceañera de vacaciones en una unidad habitacional que se enamora del treintón vecino artista plástico que se le cruza en el elevador con su hijita, mientras la chava se entrega mayormente a acciones cada vez más insólitas, en solitario o al lado de una amiga pelirroja tan lunática como ella, para demostrar que del rito al mito sólo hay un humito, con citas y pinturas y pintarrajeos papúes de la Melanesia de Gauguin, llenos de frescura e inventiva forma fílmica pura, en cortísimas secuencias a plano fijo de colores radiantes, donde todo es vivaz, marciano y godardianamente posible.
Sin duda, nadie podría hacer nada mejor por dignificar la difusión del cine en la UNAM.
*FOTO: Con casi seis horas de duración, Patria, Irak, año cero fue el centro de FICUNAM/ Especial.

REVIEW: Patria (Irak Año Cero)
Por
Marco César Monroy

Calificación Cine Pro: 5/5
A lo largo de casi tres horas, Abbas Fahdel abre la ventana al mundo musulmán, hasta ahora aparentemente hermético para los occidentales. A través de su mirada conocemos a su pueblo en una situación fatal: la llegada de una guerra. Motivo suficiente para desencadenar una reflexión sobre la vida misma y el amor a un país. La segunda parte abarca las consecuencias de una guerra narradas desde la perspectiva de los ciudadanos de Bagdad. El trabajo propone una visión civil donde no domina el dramatismo, sino la confusión e integración de la guerra a la vida cotidiana de un pueblo.
Casi seis horas de película son suficientes para que se abra un mundo frente a nosotros. Un mundo que normalmente había sido retratado desde fuera, lejano y ajeno. Un mundo que únicamente conocíamos por el nombre de Irak. Patria (Irak año cero) del director iraquí Abbas Fahdel no sólo muestra los conflictos bélicos que se suscitaron en Irak tras la invasión estadounidense en 2003, sino que va más allá y manifiesta la forma de vida de toda una nación entera.
Una cámara en mano, manipulada por el ojo del propio director, registra en un primer momento la vida de su propia familia, en una especia de película casera guiada casi a modo de tour por Haidar, el pequeño sobrino de doce años de Fahdel. En principio se muestra lo elemental de la estructura familiar para la conformación de una sociedad con relaciones aún más complejas, y que siempre tienen su correlato con determinadas épocas históricas. Pero no sólo vemos éste entramado de relaciones sociales, más importante aún es que se nos hace patente el conflicto emocional, interno y personal que vive y vivirá cada miembro de la familia. Así transcurrirá la primera parte de la película, en la que progresivamente se dejarán los linderos familiares para entretejer y entrever cada vez más las bifurcaciones que van surgiendo.
La segunda parte se filma a partir de la ocupación por parte del ejército estadounidense, dejando fuera de la pantalla el conflicto armado, pues aquello que ignorábamos era lo que internamente se vivía más no el hecho mismo de la guerra. Ya no habrá tanta concentración en el nido familiar, la atención ahora se ocupará más del caos que habita en las calles. De este modo Abbas Fahdel borra el “entre” y se ocupa de sus dos polos: el antes y el después; el antes de la caída y el después de la batalla. Sin duda esto responde a unas de las principales preocupaciones del film: el problema de lo Otro. Lo que tanto le preocupa al director no es ya una reflexión, sino una flexión sobre la realidad inmediata que viven los iraquíes, la cual nos hace preguntar: ¿Quiénes son y cómo viven esta realidad que los circunscribe? Una pregunta que no es exclusiva para el espectador y que alcanza a sus propios protagonistas.
Las imágenes son libres y se mueven únicamente con el propósito de encarnar lo que ellas mismas son. Bajo esta premisa se podría conjurar el ejercicio cinematográfico que ejecuta Fahdel en su película; el cine muestra eso que está ahí pero que normalmente no se percibe y que al mismo tiempo reclama ser visto. Muestra también los fantasmas de fuerzas que se consumen unas a otras en una lucha interminable que no está mediada por ninguna moral y que se explica e implica a través de la oscilación que va de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Patria (Irak año cero) no es una película más sobre la guerra, es una obra magna que se alza y se guarda a sí misma un lugar dentro de la Historia del cine.

“Patria (Irak año cero)” muestra en primera persona la destrucción de un pueblo y su cultura
LA INVASIÓN ESTADOUNIDENSE A IRAK EN 2003, Y LA DESTRUCCIÓN DE UN PAÍS, SU CULTURA, SU MEMORIA Y SU ESPERANZA, ES MOSTRADA EN PRIMERA PERSONA POR EL CINEASTA IRAQUÍ ABBAS FAHDEL.”Patria (Irak Año Cero)” es un valioso documental que registra -en imperceptibles seis horas- sus vivencias, las de su familia y las de un pueblo entero en los momentos previos y posteriores a los bombardeos y el ingreso de las tropas extranjeras.
Escrito, dirigido, producido, filmado y montado por el propio Fahdel, este documental (que se verá en el Malba los domingos de agosto, a las 19.30, y se exhibe desde el jueves en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, en Córdoba) revela sin caer nunca en sensacionalismos ni golpes bajos el modus operandi que Estados Unidos llevó -y lleva- adelante para bombardear e invadir a Irak, como a otros países.Sin subrayados, la película muestra la demonización estadounidense de una cultura y una religión enteras en base a propaganda y mentiras, y alude a una seguidilla de agresiones previas, como el embargo comercial y financiero que destruyó la economía iraquí, o como la agitación de intrigas internas y la manipulación mediática, todo eso con el objetivo obsceno de apropiarse de sus riquezas naturales, en este caso de su petróleo.
Premiado en numerosos festivales del mundo, Fahdel realiza una crónica cotidiana en cámara en mano, íntima, casi hogareña, de la vida de sus parientes, amigos y vecinos durante los meses previos a los bombardeos, capturando la idiosincrasia de los iraquíes, un pueblo digno y alegre, que no pierde nunca la sonrisa ni el humor a pesar de la ansiedad, el estrés y el temor generados por la cercanía de una amenaza cada vez más palpable.
Detrás de la propaganda estigmatizadora en contra de un pueblo y su cultura, la película descubre -y muestra por primera vez al mundo occidental- la vida doméstica, las diversiones, la comida y las formas de relacionarse de seres humanos sensibles, interesados por el saber, generosos y solidarios, que disfrutan y se esperanzan al igual que cualquier otra persona del planeta, demostrando así que no son ni serán únicamente cifras en frías estadísticas de víctimas y destrucción.
De ese modo, casi sin quererlo, Fahdel visibiliza la ignorancia que estadounidenses y gran parte del mundo occidental tuvo y tiene en relación a los iraquíes en particular, y a los musulmanes y el Islam en general, pero desde una perspectiva lo más objetiva posible, sin glorificarlos ni eludir sus propios defectos, como el conflicto religioso entre sunitas y chiitas o el grado de responsabilidad en la caída de Irak del gobierno represivo y autoritario de Saddam Hussein.
La película está dividida en dos partes de tres horas, separadas por un intervalo, en la primera de las cuales Fahdel registra sutilmente un proceso in crescendo de miedo y ansiedad, disimulado entre bromas y cierta indiferencia, donde las condiciones de vida de sus parientes y vecinos se van deteriorando, sus rostros alegres se modifican y todos empiezan a acumular comida, combustible, agua y remedios en vistas de lo que vendrá.
Uno de los protagonistas del filme es su sobrino Haidar, un joven de 12 años que morirá semanas después de los bombardeos, baleado en una emboscada, y a quien el director retrata en toda su energía y curiosidad, observando cómo sus mayores compran armas para defenderse, bromeando con sus hermanas o haciendo preguntas y sorprendiendo a propios y extraños con reflexiones sobre la vida que, en su ingenuidad, no dejan de ser agudas y profundas.
Fahdel retrata a la gente común y revela el daño psicológico que les provoca la cercanía de la guerra, y en algunos momentos pone el foco en los menores, en sus juegos de guerra con armas de juguete o en una conversación entre dos amiguitos que se preguntan si su ciudad será bombardeada y si deberán combatir cuando les llegue el turno, a lo que uno de ellos responde que lo harán cuando sean mayores, porque todavía siguen siendo niños.
Sin embargo, en su segunda parte, cuando los estadounidenses ya bombardearon, invadieron y derrocaron a Hussein, el documental demuestra que la candidez no es propiedad exclusiva de los niños, sino que muchos adultos iraquíes -quizás por incomprensión e incredulidad frente a tanta devastación- se preguntan ingenuamente por qué los invasores destruyeron sus hogares, sus museos y la infraestructura de su país, o por qué asesinaron a sus amigos y vecinos, civiles inocentes que no les habían ofrecido ninguna resistencia.
Entre las ruinas y escombros de lo que alguna vez fue un país unido y próspero, algunos iraquíes recuerdan la primera invasión estadounidense, impulsada por George Bush durante la Guerra del Golfo en 1991, y otros no dejan de notar la “casualidad” de que fuera justamente otro Bush, su propio hijo, el presidente estadounidense que ordenó -en base a la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva- este nuevo ataque.
“Resulta revelador cómo desde la presencia estadounidense en adelante toda una forma de vida es arrasada mientras cunde la corrupción, la destrucción de la historia y sus archivos (incluyendo un instituto de cine y todas sus películas) y la instauración de una especie de Lejano Oeste”, escribió el crítico Roger Koza, quien -movido por la conmoción que le generó el filme- se convirtió de manera amateur en su distribuidor en la Argentina.
Aunque no sea su objetivo, “Patria (Irak Año Cero) es una obra imprescindible para comprender mejor un mundo cada vez más caótico y violento, donde la propaganda y la manipulación mediática son usados para demonizar, agredir, aislar, perjudicar o incluso invadir países soberanos que no se subordinan a una mirada unívoca del mundo ni aceptan a la “democracia” como la única forma posible de gobernarse.

PATRIA: IRAK AÑO CERO / HOMELAND: IRAQ YEAR ZERO
Por Roger Koza
HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA

Patria: Irak año cero/ Homeland: Iraq Year Zero, Irak-Francia, 2015.
Escrita y dirigida por Abbas Fahdel
**** Obra maestra
En la Casa Blanca hay guionistas ingeniosos. A uno de ellos se le ocurrió que el gobierno de Bagdad contaba con armas de destrucción masiva y que tal suposición justificaba una invasión. Había pasado más de un año y medio de aquel acontecimiento vil que derrumbó las Torres Gemelas; el presidente Bush lideraba entonces una guerra contra el terror que justificaba expediciones “democráticas” como la que había anunciado en Irak. Había que destituir a Saddam Hussein y refundar la nación. Por qué un país extranjero y su ejército tenían que encargarse de ese destino: he aquí el deus ex machina de la “película”.
Los guiones de Washigton tienen consecuencias, y es justamente eso lo que fue a registrar a su país de origen Abbas Fahdel, un cineasta iraquí que residía en París, ciudad a la que fue en su juventud a estudiar cine. Quizás siguiendo un poco los pasos de uno de sus maestros, Jean Rouch, el cineasta, que permanece en un riguroso fuera de campo, se limitó a seguir la cotidianidad de la vida de su familia de Bagdad, antes y después de la invasión. Los bombardeos y el combate también quedan en fuera de campo, aunque los efectos estarán patentizados por las imágenes en toda la segunda parte del film: hogares civiles destruidos, ministerios incinerados, calles destruidas y un archivo audiovisual convertido en cenizas. El inventario de la ocupación es canallesco; los daños colaterales, vergonzosos: el país es desde entonces la locación de un western, un escenario caótico en el que no se puede prescindir de las armas.
Fahdel empieza con el orden doméstico y de ahí va incorporando a los vecinos del barrio, después a los ciudadanos de Bagdad y del resto del país. El film no es otra cosa que un cosmorama de Irak; en pocos minutos se “habita” ese país satanizado por Occidente y se corre el velo de nuestra ignorancia. Constatación inmediata: la amabilidad de la mayoría de los personajes es ostensible, como también lo es la riqueza cultural del país. Esto es posible porque Fahdel es un anfitrión magnífico: un par de visitas a museos suministra datos pertinentes de la reciente historia del país, un paseo por las calles permite entender la composición de clases y la situación política antes y después de Hussein; hasta tiene el tino de hacer conocer la vida en los pueblos y otras ciudades.
Políticamente, Homeland: Irak Year Zero es criteriosa en su delicado trabajo de injuriar al régimen de Hussein como también a los heraldos de la democracia. Los señalamientos críticos para el gobierno del dictador, sobre todo en el primer capítulo, están dispersos y apenas enunciados, una táctica de supervivencia simbólica en un país en el que todos los niños estaban obligados a enviarle una carta a su máximo líder en sus conmemoraciones personales; es probable que no todos estuvieran inmunizados al adoctrinamiento sistemático, pero Fahdel reúne varios signos disruptivos: una venta de armas callejera, discusiones entre militantes en la vía pública, cortes de luz permanentes, una monótona aparición televisiva de Hussein, cuya razón de ser luego será dialécticamente explicitada en la segunda parte, al hacerse alusión al veto de canales extranjeros en el menú de la televisión satelital. Este modelo paradójico diferido por el cual algo se dice pero no del todo para luego retomarlo más tarde y completarlo, a menudo en forma de contradicción, corresponde a una forma de trabajar sobre el montaje concebido a gran escala.
El movimiento es el siguiente: identificar constantes y sus variaciones y hacerlas colisionar en la distancia, como se puede observar en el tonto ejemplo de la televisión satelital, o como el severo pasaje con el que culmina el primer segmento en un museo de la memoria que se resignificará total y tardíamente con el abrupto y seco desenlace de la segunda parte. Fahdel es un cineasta microscópico: en el acopio de detalles y fragmentos narrativos aislados va hilvanando metódicamente un segundo relato universal, que no es otro que el de un pueblo sometido a la arbitrariedad de un tirano y a la voluntad de poder de un imperio inescrupuloso. El rítmico montaje de Fahdel no solamente es eficaz en suavizar el tiempo elegido para desenvolver el relato con una elegante fluidez que es en sí un prodigio; el montaje es a su vez el desmontaje ideológico de los opresores locales y foráneos.
Pero este film no sería el mismo si no contara con su guía ética y vital llamada Haidar, el sobrino de 11 años del director, siempre curioso, solidario con sus hermanos, primos y transeúntes, y de quien se nos advierte en el inicio que perdió la vida. La fuerza de su protagonismo desmiente el anuncio, pero la realidad vencerá finalmente la ilusión fantasmal de su presencia. De algún modo, él representa a todos los niños (inocentes) que la política de los adultos ignora y suprime. El fin de su vida es la eternización de la infamia, sustantivo que tipifica el curso regular de la Historia. Es difícil desentenderse de Haidar, quien pasó súbitamente al reino de lo infilmable. Hoy tendría unos 25 años, más o menos como tantos otros.
Esta crítica fue publicada en otra versión por el diario La voz del interior en el mes de agosto de 2016
Roger Koza / Copyleft 2016
Homeland (Iraq Year Zero) Irak (2015) Abbas Fahdel
Homeland (Iraq Year Zero) Irak (2015) Abbas Fahdel
Hace semanas que tenía pendiente escribir esta reseña sobre uno de los documentales más impresionante que he visto en mucho tiempo: Homeland (Irak año cero). Dividido en dos partes de 3 horas cada una de ellas: ¡y creerme que no le sobra un sólo segundo!; el documental del iraquí Abbas Fahdel provoca en el espectador un impacto semejante al que dejaría un misil Tomahawk lanzado sobre una de las riberas del mítico Tigris.
La propuesta de Abbas Fahdel navega en las antípodas del resto de los innumerables documentales que se realizaron sobre la invasión norteamericana en Irak. Al director nacido enBabilonia (residente en Francia desde hace 15 años), le preocupaba especialmente la imagen con que los medios occidentales retrataban al pueblo iraquí, ignorando por completo la opinión de la población civil: y por supuesto (esto lo añado yo), importándoles un comino al mefítico “trío de las Azores” la muerte y la destrucción que traería consigo una guerra, amparada además en razones vergonzosas y bastardas.
En febrero de 2002, Abbas Fahdel viaja a Bagdad con la intención de registrar documentalmente la vida de una familia iraquí bajo la amenaza de la guerra: los elegidos son su propia familia; su hermano, sus sobrinos, sus cuñados, sus amigos y vecinos… Esta primera parte lleva por título “Before the fall” (Antes de la caída).
 En casa de los Fahdel la familia se reúne en torno a la televisión: la figura de Sadam Husein es omnipresente; el dictador se reúne con su consejo de ministros para evaluar las amenazas norteamericanas; intenta transmitir a la población la capacidad de su gobierno para responder con contundencia la invasión; Sadam rodeado de niños, Sadam saludando al pueblo, Sadam, siempre Sadam…
En casa de los Fahdel la familia se reúne en torno a la televisión: la figura de Sadam Husein es omnipresente; el dictador se reúne con su consejo de ministros para evaluar las amenazas norteamericanas; intenta transmitir a la población la capacidad de su gobierno para responder con contundencia la invasión; Sadam rodeado de niños, Sadam saludando al pueblo, Sadam, siempre Sadam…
Haidar tiene 12 años, es sobrino de Abbas Fahdel, y tiene un desparpajo impropio de un niño de su edad. Los preparativos para sobrevivir a la guerra los vive con la inocencia de un juego infantil. Su padre ha decidido cavar un pozo de agua en el jardín de su casa, con la idea de abastecerse en caso de restricciones o cortes de suministros locales de agua. Haidar se pasa el día bombeando agua, mientras explica a sus primas la importancia de su labor. En otra secuencia, el niño cruza con cintas de embalaje los cristales de las ventanas: explica que así se evitará que los cristales se rompan en mil añicos cuando comiencen las explosiones.
La actividad no se detiene en los mercados de Bagdad: Abbas Fahdel nos muestra la labor cotidiana de vendedores y clientes: artesanos, panaderos, libreros, sastres… Estimulados ante la presencia de la cámara, hablan de la amenaza de la guerra que viene y de las guerras pasadas que les tocó sufrir. Acostumbrados a vivir cómo una maldita condena, bajo la sombra funesta de los conflictos armados y de las tiranías, los iraquíes demuestran aparentemente una templanza y una entereza admirable. Pero cómo se dice por España: “la procesión va por dentro”. ¿Quién puede esperar algo de sensatez cuando a los políticos que tienen que buscar soluciones sólo les interesa los negocios que surgirán tras la guerra? La amenaza de la invasión es cada día más real: las armas de destrucción masiva vendrán con el sello de “calidad” EEUU.
 Homeland (Irak año cero) tiene la frescura de un documental humanista; cercano y absolutamente empático: cualquiera de nosotros podría ser cualquiera de los hombres y mujeres anónimos que se cruzan ante la escrutadora mirada de Abbas Fhadel. Despojado de alardes técnicos ni dobleces estructurales, el director iraquí se sirve de una cámara domestica y de un equipo básico de sonido, para ir confeccionando un mural tan gigantesco cómo caleidoscópico.
Homeland (Irak año cero) tiene la frescura de un documental humanista; cercano y absolutamente empático: cualquiera de nosotros podría ser cualquiera de los hombres y mujeres anónimos que se cruzan ante la escrutadora mirada de Abbas Fhadel. Despojado de alardes técnicos ni dobleces estructurales, el director iraquí se sirve de una cámara domestica y de un equipo básico de sonido, para ir confeccionando un mural tan gigantesco cómo caleidoscópico.
Los sobrinos del director, sentados en torno al televisor, siguen con emoción las imágenes que la cadena pública emite sobre las manifestación contra la guerra que se suceden en todo el mundo: ¡Su guerra! –Pierden el tiempo– dice uno de ellos. Una chica le responde de inmediato, con un tono de sentida gratitud: -¡Se preocupan por nosotros!-.
Parte 2 –Después de la batalla
 Abbas Fahdel se encuentra en Francia cuando EEUU inicia su acción militar en Irak. No podrá regresar a Bagdadhasta dos semanas después de la invasión americana. El país que se encuentra a su regreso queda magníficamente retratado en unas secuencias en las que Abbas graba las calles de Bagdad, mientras su hermano Ibrahim conduce. Aunque la guerra ha terminado, las carreteras están atestadas de columnas de vehículos militares. Los controles de los americanos cierran carreteras y obligan a los iraquíes a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Los efectos de los bombardeos son notables: la destrucción no se ha centrado exclusivamente en edificios oficiales, muchos barrios residenciales han quedado reducidos a escombros. Con el país sin gobierno, los iraquíes exigen la protección de los americanos ante los numerosos casos de saqueo, robos y asesinatos cometidos por delincuentes comunes y mafias que comienzan a organizarse. Pero los americanos ya han cumplido su objetivo, tras el derrocamiento del régimen y la muerte de Sadam Hussein, poco les importa el sufrimiento del pueblo iraquí.
Abbas Fahdel se encuentra en Francia cuando EEUU inicia su acción militar en Irak. No podrá regresar a Bagdadhasta dos semanas después de la invasión americana. El país que se encuentra a su regreso queda magníficamente retratado en unas secuencias en las que Abbas graba las calles de Bagdad, mientras su hermano Ibrahim conduce. Aunque la guerra ha terminado, las carreteras están atestadas de columnas de vehículos militares. Los controles de los americanos cierran carreteras y obligan a los iraquíes a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Los efectos de los bombardeos son notables: la destrucción no se ha centrado exclusivamente en edificios oficiales, muchos barrios residenciales han quedado reducidos a escombros. Con el país sin gobierno, los iraquíes exigen la protección de los americanos ante los numerosos casos de saqueo, robos y asesinatos cometidos por delincuentes comunes y mafias que comienzan a organizarse. Pero los americanos ya han cumplido su objetivo, tras el derrocamiento del régimen y la muerte de Sadam Hussein, poco les importa el sufrimiento del pueblo iraquí.
 Cada día que pasa, la situación es más dramática: el caos y el miedo se apoderan de la población. Incluso uno de los sobrinos de Abbas nos muestra un fusil que ha comprado una vez finalizada la guerra: explica ante la cámara sus motivos: –La situación empeoró, hay muchos bandidos. Sin policía, la gente quedó obligada a comprar armas para defenderse. No hay policías que atrapen a los ladrones. Después de la guerra, Sadam liberó a todos los criminales que estaban en prisión, incluso a los condenados a muerte, eso aumentó el caos. Un amigo fue a la policía a denunciar el asesinato de su padre, los policías de dijeron que no podían hacer nada.-
Cada día que pasa, la situación es más dramática: el caos y el miedo se apoderan de la población. Incluso uno de los sobrinos de Abbas nos muestra un fusil que ha comprado una vez finalizada la guerra: explica ante la cámara sus motivos: –La situación empeoró, hay muchos bandidos. Sin policía, la gente quedó obligada a comprar armas para defenderse. No hay policías que atrapen a los ladrones. Después de la guerra, Sadam liberó a todos los criminales que estaban en prisión, incluso a los condenados a muerte, eso aumentó el caos. Un amigo fue a la policía a denunciar el asesinato de su padre, los policías de dijeron que no podían hacer nada.-
 En una urbanización a las afueras de Bagdad, Abbas graba a un grupo de vecinos, un hombre se muestra desesperado: a su espalda podemos ver reducida a escombros, lo que hace unas semanas era su casa. Nadie se explica por que los americanos dispararon sus misiles contra las casas de civiles. El hombre añade con indignación, que toda su familia tiene que dormir en una furgoneta: han perdido todo lo que tenían: –Juro que si veo a un americano, lo asesinaré-. concluye el hombre mordiendo con rabia sus palabras.
En una urbanización a las afueras de Bagdad, Abbas graba a un grupo de vecinos, un hombre se muestra desesperado: a su espalda podemos ver reducida a escombros, lo que hace unas semanas era su casa. Nadie se explica por que los americanos dispararon sus misiles contra las casas de civiles. El hombre añade con indignación, que toda su familia tiene que dormir en una furgoneta: han perdido todo lo que tenían: –Juro que si veo a un americano, lo asesinaré-. concluye el hombre mordiendo con rabia sus palabras.
 No hay familia en Irak que no haya sufrido la pérdida violenta de alguno de sus miembros. Desgraciadamente la muerte también ha llamado a la puerta de los Fahdel: tres de sus jóvenes sobrinos que aparecen en el documental, morirán asesinados por pistoleros comunes.
No hay familia en Irak que no haya sufrido la pérdida violenta de alguno de sus miembros. Desgraciadamente la muerte también ha llamado a la puerta de los Fahdel: tres de sus jóvenes sobrinos que aparecen en el documental, morirán asesinados por pistoleros comunes.
En Julio de 2003, un año y media desde el comienzo de la grabación Abbas Fadhel, su sobrino Haidar muere de un disparo en el asiento trasero de un auto que conducía su padre. El director iraquí decide suspender la grabación del documental. Fue necesario que transcurrieran diez años, hasta que Fadhel pudiera ver las imágenes y retomar el proyecto.
 En el año 2015, el prestigioso festival francés “Vision du Réel”, incluye en su sección oficial el estreno mundial de “Homeland (Irak Year Zero)”. Un emocionado Abbas Fahdel recoge el máximo galardón del festival, además de una mención especial en la sección “Interreligious Prize”.
En el año 2015, el prestigioso festival francés “Vision du Réel”, incluye en su sección oficial el estreno mundial de “Homeland (Irak Year Zero)”. Un emocionado Abbas Fahdel recoge el máximo galardón del festival, además de una mención especial en la sección “Interreligious Prize”.
“Homeland (Irak Year Zero)” continúa a día de hoy, su andadura en festivales y muestras de cine de todo el mundo. No me cabe la menor duda que el documental de Abbas Fahdel ocupará un puesto destacado en la historia del cine mundial. Tal parece que el destino quisiera reparar con la inmortalidad del documental, una deuda contraída con el sufrido pueblo iraquí: en una de sus secuencias, el director nos muestra el interior del edificio que albergaba todos los archivos históricos del cine y del documental iraquí: todo su patrimonio audiovisual está reducido a cenizas.
La invasión de Irak ha tenido unas consecuencias devastadoras no sólo para el pueblo iraquí: ISIS nació en una prisión estadounidense en el desierto de Irak, conocida con el nombre de Camp Bucca. Bush, Blair y Aznar, abrieron la caja de Pandora el 15 de Marzo de 2003, en la isla de las Azores. 17 años después, los líderes políticos de Occidente se muestran incapaces de cerrar la caja de todos los males: Elpis, el espíritu de la esperanza, está comenzando a perder la confianza de su virtud y amenaza seriamente con diluirse en el fondo de la maléfica caja creada por Zeus. A mí se me ocurre una idea, que aunque no reparará los daños, bien podría servir como un punto de inflexión: que Bush, Blair y Aznar, sean juzgados por crímenes de guerra ante el Tribunal de la Haya.

Humanos, demasiado humanos: Homeland (Iraq Year Zero), de Abbas Fahdel

Por Leo Lozano
La Historia, esa que se escribe con mayúscula, ha estado plagada de conquistas y derrotas, de ganadores y vencidos, de grandes personajes y acontecimientos. La narrativa de esa historia se ha encargado -casi siempre- de consignar lo antes mencionado omitiendo un pequeño detalle: la gente común, aquella que vive y padece las consecuencias de una conquista, una guerra o una crisis social, económica, o de cualquier otra índole.
Superada la paranoia por el cambio de milenio, a la antigua Mesopotamia le toca protagonizar la primera guerra del siglo, y uno quisiera, de verdad, abordar el asunto con el mayor tacto posible, evitando apasionamientos, rencores, diatribas y frases condescendientes, pero ¿cómo evitarlo? La política apasiona y las injusticias enfurecen; hay que tomar partido… ¿de verdad hay que hacerlo?
¿Por qué el conflicto en Irak en 2003 tendría que ser más especial qué otros?, ¿cuál es la razón por la que debemos avergonzarnos como especie cuando vemos esa desgracia en específico y no otras, las de nuestro propio país incluso? ¿No se ha regido la historia de la humanidad por hechos como este?, ¿no le ha tocado a todas las civilizaciones vivir un esplendor y una consecuente decadencia? Escribo esto en un estado de conflicto interno después de haber visto Homeland (Iraq Year Zero).
El documental de Abbas Fahdel es un testimonio sobre las omisiones de la Historia. Pero más que eso, es un documento del día a día de una nación y su lucha por la supervivencia antes y después de una guerra. El iraquí divide su filme en dos partes, en la primera, con cámara en mano filma a los integrantes de su familia previo a la ocupación estadounidense, alternándolo con la reacción de los habitantes de Bagdad y de ciudades aledañas ante la inminente invasión. En la segunda parte, observamos la vida después de la guerra y con el país en plena ocupación; Irak bajo la influencia del Estado Americano y sus aliados.

Sabemos de antemano que los imperios siempre han de encontrar la justificación perfecta para satisfacer sus apetitos expansionistas: evangelización, civilización, democracia, libertad y demás falacias. La política es el arte de la simulación por excelencia. A los iraquíes les tocó ser señalados por producir armas de destrucción masiva, pese a las sanciones y el embargo al que fue sometido el país después de la Guerra del Golfo Pérsico.
Así, el ciudadano de a pie, vive el día a día previo a la guerra, bombardeado por la propaganda del régimen paternalista de Saddam Hussein y las noticias que reportan en cuenta regresiva los detalles de la invasión.
Las reminiscencias de conflictos anteriores, la conciencia de un pasado y una Historia, los usos y costumbres de la familia iraquí, la vida en comunidad, la proyección a futuro ante un clima de caos, pero sobre todo, la voz, la risa y las aspiraciones de una infancia cuyo futuro se percibe nebuloso. Porque en el documental de Fahdel, uno de los grandes protagonistas, además de su país y su gente, son los niños, en especial su sobrino Haydar.
El filme -en su primera parte- no escatima en mostrarnos el ir y venir de la vida simple en la infancia, incluso en situaciones extremas, como la amenaza de una guerra. La familia de Fahdel vive su día a día con la plena conciencia de que probablemente eso que conocen como vida, una vez iniciada la invasión, se extinga. Pese a ello, la alegría, la vitalidad, las risas, incluso el humor con respecto a su peculiar situación, no desaparecen. El iraquí conserva el buen semblante, a sabiendas de que miles de años de historia por detrás, no se anulan con otra ocupación -una de tantas- ni con la destrucción de su legado arquitectónico y cultural.

Lo entrañable, lo desgarrador de este poderoso testimonio de humanidad, va más allá de señalamientos y enconos étnicos y políticos, y se ubica en la fuerza de sus protagonistas; una sociedad eternamente amenazada y vejada por intereses de propios y extraños. Fadhel logra documentar, y se agradece que lo haga así, el impacto que tienen en la sociedad las decisiones de sus líderes. El director evita en todo momento tomar partido por uno u otro lado; el filme va por otro rumbo, el de consignar el testimonio de las víctimas directas de la guerra.
En este hemisferio del planeta, estos hechos eran desconocidos, ya que la cobertura mediática se limitó a la recopilación de cifras sin sentido, con un evidente apoyo a Estados Unidos y sus aliados. Lo que ofrece este documental es una ventana al mundo del iraquí común, y a su vez un combate a la ignorancia, al prejuicio y al odio.
Ignoro si esto funciona. La dinámica de la convivencia del hombre es harto compleja, y aunque uno quisiera creer en las utopías, la realidad siempre te golpea en la cara, justo como lo hace el final de este documental.
En el se resumen las principales ideas del filme, pero no en el sentido en el que uno esperaría; el final es una conclusión nefasta, pesimista y reveladora sobre lo absurdo de este mundo en el que vivimos.
Si después de leer esto, el lector conserva un poco de curiosidad por Homeland (Iraq Year Zero), esta se proyectará en el marco del FICUNAM como parte de su Competencia Internacional, que se celebrará del 24 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México.
Y si no es curiosidad lo que queda en el lector, sí es un mínimo de sensibilidad, entonces, sólo me resta decir, que pese a todo, lo que verá le dejará un buen sabor de boca.

18e Festival Indépendance et Création.
DMZ국제다큐영화제의 꽃인 경쟁부문 대상 ‘흰기러기상’은 이란 압바스 파델 감독의 영화 ‘이라크 영년’이 차지했습니다!
Homeland (Iraq Year Zero) remporte le principal prix, “The White Goose Award”, au festival DMZ Docs, en Corée du Sud.

De droite à gauche:
Jo Jae-hyeon (star du cinéma coréen et acteur fétiche de Kim Ki-duk) et Abbas Fahdel DMZ DOCS

De droite à gauche: Jo Jae-hyeon (star du cinéma coréen et acteur fétiche de Kim Ki-duk), Abbas Fahdel, Jean- Pierre Rehm (directeur du FIDMarseille), Jeon Sung-kwon, directeur de DMZ DOCS

Trois films à ne pas rater cette semaine
Le Monde.fr | 14.10.2015 à 06h56 • Mis à jour le 14.10.2015 à 10h24 | Par Jacques Mandelbaum
CHRONIQUE FAMILIALE DE LA DÉVASTATION IRAKIENNE : Homeland

Cela se passe au festival de La Roche-Sur-Yon et c’est un événement plutôt rare. Un film de cinq heures qui se veut la chronique quotidienne d’une famille irakienne, pendant un an et demi, avant et après l’invasion américaine de 2003. L’auteur, Abbas Fahdel, né à Babylone, est installé en France depuis l’âge de dix-huit ans. A l’annonce de l’imminence d’une guerre dans son pays natal, il y retourne muni d’une caméra, et en ramène le matériau qui constituera in fine ce film-fleuve, tourné dans sa propre famille. Aussi loin que possible des images journalistiques « embarquées » ou des fictions de guerre hollywoodiennes, voici, filmé de l’intérieur, avec tendresse mais sans pathos excessif, le désastre universel de la guerre qui s’abat sur une famille qu’on pourrait prétendre comme toutes les autres, si elle n’avait pas subi le joug de la dictature d’un tyran durant des décennies, avant de devoir subir la désagrégation de son pays et la dévastation dans ses propres rangs. Le film a été montré dans de nombreux festivals. Il sortira en France en février 2016.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/10/14/la-selection-cinema-du-monde_4788861_3476.html#OzILZDHBTTf6Zzm0.99
ENTREVUE AVEC ABBAS FAHDEL – HOMELAND (IRAK YEAR ZERO)
9 NOVEMBRE 2015
À LA FOIS INTIME ET ÉPIQUE, HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) EST LA CHRONIQUE QUOTIDIENNE DE LA VIE EN IRAK AVANT ET APRÈS L’INVASION AMÉRICAINE DE 2003. ABBAS FAHDEL, L’AUTEUR DE CETTE ŒUVRE FLEUVE INOUBLIABLE, A RÉPONDU À NOS QUESTIONS.
HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) SERA PRÉSENTÉ AVEC SOUS-TITRES ANGLAIS LE 17 NOVEMBRE (PARTIE 1 ET 2 AVEC ENTRACTE DE 45 MINUTES) ET LE 21 NOVEMBRE (PARTIE 1 ET 2 AVEC ENTRACTE DE 45 MINUTES), ET AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS LES 19 (PARTIE 1) ET 20 NOVEMBRE (PARTIE 2).
“En filmant l’histoire du 21è siècle, Abbas Fahdel s’inscrit dans l’histoire du cinéma.”


Mubi.com
“Homeland (Iraq Year Zero)”

“Our point of view follows a trajectory to become the vanishing point of our own failure.” —Jacques Lacan

CRITIKAT
6ème Festival International du Film de La Roche-sur-Yon
(……)
Homeland, Iraq Year Zero : « les puissants ne s’excusent pas »

C’est avec cette phrase lancée par un Irakien à son fils de douze ans, qu’Homeland, film-fleuve de deux fois cent-soixante-cinq minutes, annonce peut-être le plus simplement son programme : si l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, rien n’empêche les perdants – du moins les victimes – d’en présenter le contrechamp d’injustice. Cinq heures trente ne sont pas de trop pour conjurer dix ans de domination sur le champ de bataille des images ; lesquelles, toujours produites par les puissants, réduisent dans le meilleur des cas les Irakiens à un peuple de victimes, et au pire à des figurants complètement hagards. Dix ans de micro-reportages télévisés, de Fox News au JT de David Pujadas, où le talionnisme afghan et le néocolonialisme en Irak semblent ramener la même vision chaotique de ce nouveau Far East. Or, si le récit de cette spoliation reste visible, Homeland, en optant pour le feuilleton tranquille d’une chronique familiale, la relègue en toile de fond. C’est qu’Abbas Fahdel, avec lequel nous nous étions entretenus lors des États généraux de Lussas, préfère aux démonstrations magistrales la discrétion des intérieurs, des voitures, des marchés couverts et de toutes ces petites chambres de confidences dont la guerre démantèlera les cloisons. Si bien qu’à une première partie plutôt feutrée, répond, dans la seconde, la complainte à ciel ouvert d’un peuple dénudé. À travers sa propre famille, élargie à la rue tout entière tant leurs portes sont toujours ouvertes, c’est à un peuple que le cinéaste confie les clefs de son récit. Hormis quelques sous-titres présentant les lieux et les personnages, jamais le filmeur ne vient arranger, nuancer ou harmoniser toutes les versions contradictoires de ses semblables. C’est ainsi qu’à l’image de barbares qu’endossent les Irakiens dans les médias occidentaux, nouvelles peaux rouges ébahies devant les défilés de la cavalerie, répond un film de « semblables » – où chacun, par le naturel de sa contribution, offre une nouvelle facette à ce hors champs, qu’Homeland remplit salutairement. Si l’Irak reste à reconstruire, la reconquête de ses propres images, à laquelle s’est livré Fahdel, apporte sûrement la plus belle des premières pierres.
Film Review: ‘Homeland (Iraq Year Zero)’
More homely than Homeland, but hard to carry as normal

Don’t miss the screening this Saturday with a talk from the director himself.
Putting aside the fact that we now know the 2003 invasion of Iraq was an illegal war waged on false pretences and some embarrassingly tenuous link to 9/11, this film focuses on the smaller picture: an Iraqi family. The brothers, the in-laws, nieces and nephews of filmmaker Abbas Fahdel populate the screen during almost the entire running time, which stands at a whopping five hours and 34 minutes.
Meet Iraq’s Partridge Family
We watch this extended middle-class family as they prepare for the coming war, with evidence of the last one (and international sanctions) still everywhere. The film chronicles their lives in Baghdad, and the rural town of Hit, during the run-up to the 2003 war and aftermath that follows. If a subject ever justified those five-plus hours of your time, it is this one.
Bonding with their brood
Without resorting to the kind of sledgehammer manipulation in propaganda like American Sniper, the film takes its time by gently immersing you in the everyday lives of these people. It’s a simple, recognisable existence and ultimately touching.
Your emotional investment in these people happens without any narrative devices; it’s simply the result of the time you spend with them.
The effect is such that you are left in no doubt that these people saw those events much more clearly than we ever could, that the real casualties of this mess were the social infrastructure, the pride of working people and the collective innocence of the Iraqi youth – their faces contributing to several sequences, filmed like still portraits.
In these sequences we are confronted only with heartbreakingly open faces, warm smiles, their uninhibited joy at being filmed, curious and playful.
Insights into Iraqi iniquity
Two points resonate throughout the film: that some of those faces we are introduced to are certainly not alive today (subtitles bluntly inform us of the fates of certain participants throughout); and that here was a cache of goodwill toward the occupiers, which due to a combination of incompetence, a lack of respect, single-minded greed and poor planning, was wasted – and most shamefully, left to fester – turning to resentment and distrust, thereby laying the foundation for the chaos we see today.
It’s an important film. Unfortunately, the running time will put off some, but the film screens in two manageable parts and your stamina will be greatly rewarded with a sobering glimpse into the Iraqi mindset and an absolutely unique perspective into the other side of this conflict and its ongoing repercussions.
‘Homeland: Iraq Year Zero’ is showing again at 9am at Grand Teatret on November 14, where there will be a chance to listen to and possibly meet the director.
Homeland (Iraq Year Zero)
★★★★★
Dir: Abbas Fahdel;
Iraq and French documentary, 2015, 334 mins
http://cphpost.dk/activities/film/film-review-homeland-iraq-year-zero.html
Homeland (Iraq Year Zero) screens at 5:30pm on Monday, October 5, with the documentary spotlight of the 53rd New York Film Festival.
The greatest film that I saw at this year’s edition of Olhar de Cinema screened on the Brazilian festival’s first and last days. Homeland (Iraq Year Zero) needed full days to itself, and not simply because of its running time. As has happened to me when watching Claude Lanzmann’sShoah (1985)—another lengthy, interview-and-landscape-based film of great power—I felt so thoroughly immersed in the stories being told by people as they lived moment-to-moment that I could feel my sensations of time and place change.
Abbas Fahdel’s documentary record of his middle-class Iraqi friends and family members during the periods shortly before and after the 2003 American military invasion of their country initially created a safe and comforting space for me to dwell in. Over time, it then gradually led me to perceive that space being undone and ruptured by violence. The film ended with seeming suddenness, and I left the theater shaken. I stayed with a sensation of helplessness over how I, as an American, had consented to the destruction I’d just seen. The world looked different now.
Homeland (Iraq Year Zero) has since gone on to screen at a number of other international festivals. Its North American premiere will take place at the New York Film Festival; the middle-aged Fahdel—who, despite spending much of his adult life in France, has shot all four of his completed feature-length films in his birth country—will attend the screening.
His personal film is divided into two parts, each of which runs close to three hours. “Before the Fall” begins in Baghdad in February of 2002, and its domestic discussions (sometimes held in front of a television while news reports play) run with a growing awareness of the invasion to come. “After the Battle” picks up in the now-devastated city in April of 2003, with civilian Iraqis alternately demonstrating, regretting, and decrying how their lives have changed. Many of the same characters appear in both parts and are introduced with simple title cards stating their name and their relation to Fahdel—for instance, “my brother.”
The filmmaking is simple and unobtrusive, with Fahdel himself holding the camera as he informally engages people to describe their routines or else is led by them on outdoor tours. These guides present a radio station and a film studio blown to pieces by bombings, along with marketplaces, homes, and human bodies (both living and dead) that have been marked by the perpetrators of an officially concluded wave of attacks. American soldiers register as infrequently glimpsed threats, and no kinds of reparations seem to be forthcoming. Among the people most actively noting this lack to us is Fahdel’s alert, charismatic young nephew Haider, whose death at the hands of unknown gunmen is related in a title card long before its moment comes and resonates throughout the rest of the film.
I watched Homeland (Iraq Year Zero) with a sense that its story has not yet ended. The love that Fahdel holds for his kinfolk and agony he feels over their fates persist more than a decade later. I contacted him shortly after Olhar de Cinema’s conclusion, resulting in a short interview that I have chosen to publish as a monologue.
Abbas Fahdel:
“I have lived in Paris since I was eighteen years old, but when I return to Iraq, I feel in my element, as one Iraqi among many. I made my first film there, Back in Babylon, in 2002, and then went back to the country once again when threats of a new war became clear. I was driven by a kind of unspoken superstition. Filming, for me, is an act of life, and by filming my loved ones on the eve of a new war, I maintained the hope of preserving them from harm. I left Iraq four days before the war’s outbreak and then returned a few weeks later to film the country’s new reality—one rocked by chaos and violence, with my family plunged into mourning.
“Homeland (Iraq Year Zero) is a choral saga that features my friends and family members as its protagonists. The choices of which people to focus on were made by me during filming. My young nephew Haider immediately emerged because of his liveliness, intelligence, and responsiveness, as well as because of his attachment to me and willingness to do everything with me, wherever I went. When he was killed, I felt unable to continue, to the point of not being able to look at the rushes I had shot for over a decade before eventually returning to find a film in them.
“My brother Ibrahim is a kind of onscreen stand-in for me. As a double, he overcomes the lack of my own image. He is the guide, or in terms recalling Tarkovsky, the “stalker” who brings us into the story’s prohibited location. The ‘Zone’ in Homeland is made up out of the neighborhoods devastated by war.
“Mahdat—my brother-in-law and Haider’s father—also seemed to me to be an interesting character in several ways. He is a father concerned about his children’s safety, and he therefore accompanies them, along with us, as a driver to their schools, universities, and workplaces. We can see much of modern Iraq this way. I myself felt endangered several times while I was filming, but I also felt that it was my duty to continue.
“Something particular to my family members is that they are very representative of the Iraqi middle class—educated and tolerant descendants of Shiite and Sunni alike. The Iraqi middle class was harmed by the war and American occupation more so than any other class was. The chaos and violent climate favored thieves, criminals, and war profiteers at its members’ expense. While others stole from their environment, they struggled to survive.
“The invasion of Iraq caused an upheaval in the lives of ordinary Iraqis that could be seen as creating a clear ‘before’ and a clear ‘after.’ My decision thus arose to divide the film into two parts. This decision also had to do with the film’s unusual length. I understood, even while we were shooting, that my filmed record would result in a long work, one spanning a large period of time over the course of several hours. The film is not just the result of months’ worth of filming and editing, but also several years’ worth of incubation during which I carried Iraq in my mind and in my heart.
“I accepted the fact of Homeland’s long duration from the beginning. Each film must have its own time to breathe. Some works need only five minutes to express themselves, while others—such as Wang Bing’s Tie Xi Qu: West of the Tracks (2002) or Homeland—need many more.
“The few producers that I contacted helped me realize, though, that neither traditional cinema nor television outlets would be willing to finance a film too long to screen or broadcast in a conventional way. I therefore decided to produce the film myself. It would be detrimental to the art of cinema to require filmmakers to match established formats. I do not intend to be subject to them, even if freedom requires making my movies without any industry’s support.
“It was vital to me to make a work that could serve both as a projection of a human reality and as a personal expression. The Americans who invaded Iraq in 2003 were unaware of the country’s rich past and civilization. If they had looked, then they could have discovered another reality while scanning the ground for supposed weapons of mass destruction. They could have found the oldest cities in the world and the first texts of humanity scattered amidst the bomb craters.
“Iraq is also the country of my childhood and adolescence—my lost homeland. Its name reminds me of dear faces and of familiar places, as well as of a spirit living beneath its sky that makes it an eternal source of inspiration.”
Lineup Announced for NYFF53 Spotlight on Documentary

Festival international de la Roche-sur-Yon.
Le lendemain, le réalisateur Abbas Fahdel participera a ce débat:
SAMEDI 17, 11h30
SORTIR DE LA ZONE DE CONFORT
Pietro Marcello (réalisateur de Bella e Perduta, Compétition Internationale), Salomé Lamas (Membre du Jury Nouvelles Vagues, réalisatrice) Abbas Fahdel (réalisateur de Homeland, Séances Spéciales). Ces trois cinéastes aux pratiques artistiques très différentes ont pourtant un point commun : ils s’aventurent dans des territoires complexes, hors des sentiers battus, pour nous raconter les aspects déroutants de notre présent. Tous trois, ils en reviennent avec des œuvres au style inclassable, et à la beauté renversante. Les trois réalisateurs nous parlent de leur processus de création. Rencontre modérée par Jean-Pierre Rehm, délégué générale du FIDMarseille.
No Place Like Homeland _ Jeffrey Ruoff
No Place Like Homeland

Abbas Fahdel’s Homeland (Iraq Year Zero) is the most significant work of art to come out of the Iraq war.
The documentary follows months, weeks, and days leading up to the 2003 U.S. invasion of Iraq and months into the subsequent occupation. Shot in Baghdad and the countryside on a lightweight video camera, this electrifying five-and-a-half hour film divides into two parts, Before the Fall and After the Battle.
The world premiere of Homeland took place at the 2015 Swiss film festival Visions du Réel, where it was awarded best feature in the international competition. On Oct. 5, the movie has its North American premiere at the New York Film Festival.
Using a long-take style reminiscent of Claude Lanzmann’s epic Shoah (1985) on the destruction of the European Jews, Before the Fall wanders through the day-to-day lives of the director’s family and friends in Baghdad, the capital’s city streets, its bazaars, and, eventually, their homes in the countryside, possible safe havens from the looming Anglo-American Blitzkrieg.
A kind of time capsule, Homeland opens in Baghdad at the home of Fahdel’s brother Ibrahim. Among others, we meet the director’s nephew Haidar, a precocious, vibrant 12-year-old boy, who plays an increasingly significant role as the movie unfolds. Eventually, after the fall of the capital, Haidar accompanies the filmmaker on numerous excursions throughout the city.
Watching Homeland is like pulling a photo album off the shelf, dusting it off, revisiting family and old friends, made increasingly poignant by the passage of time. In the faces of ordinary Iraqis gazing into his camera, Fahdel reasserts the beauty and magic of the close-up.
Retrospect hovers around the edges of the screen, as we know the terrible future that awaits Fahdel’s relations. Anxious, they still go about their affairs as normally as possible. They prepare for the coming invasion, just in case, not knowing if, or when, it will come. The director’s niece and her cousins chat about marriage and share their desire to eventually open a gynecological clinic. To partly paraphrase an old Yiddish saying, women plan and the U.S. government laughs.
At the end of Part 1, we learn to our shock – from an intertitle – that Haidar will die in the coming months. A chronicle of a death foretold.
In the aftermath of 9/11, the Bush administration was hijacked by a minority of neoconservatives, whose sights had long been set on invading Iraq and deposing America’s one-time ally Saddam Hussein. After the Battle carefully chronicles the terrible wake they left in Iraq.
Strikingly, there is no “shock and awe” in Homeland, our “rockets’ red glare” are kept entirely off-screen by the filmmaker. Fahdel refuses to recycle the spectacle of destruction that played 24/7 on American media. Instead, he records its aftermath, the traces left behind.
Unlike Claude Lanzmann, Fahdel does not appear on camera and his off-screen presence is less angry, more contemplative. By discussing Fahdel’s masterpiece in light of Lanzmann’s own, I am not equating the extermination of the European Jews with the obliteration of Baghdad and Iraq. Only time will tell where the destruction of this Middle Eastern country ranks in the long list of world atrocities.
In After the Fall, ominous portents emerge in the early weeks and months of the U.S. occupation. Looters thrive, the occupiers stand by, chaos reigns. Fahdel’s protagonists draw unsettling equations between the old and the new, “Saddam and the Americans brought us nothing but misfortune.” In the street, one Iraqi says, “Their soldiers didn’t come to free us. They came to enslave us and to exploit our country’s resources.”
Like Shoah, Homeland is a great work of history. Inspired by a Paul Klee painting Angelus Novus, German-Jewish philosopher Walter Benjamin described his vision of the angel of history:
His face is turned toward the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward.
Filming virtually by himself, Abbas Fahdel is just this kind of witness. Director. Producer. Cinematographer. Editor. Angel of history.
Traumatized by the death of his nephew, Fahdel stopped videotaping. An Iraqi exile living and working in France, the director mourned for more than a decade, only completing Homeland twelve years later.
To those of us who live far from Baghdad, Fahdel has written an indelible scroll of the Iraqi capital, once upon a time. Homeland remains an everlasting tablet of a proud people preparing, and enduring, a destiny written by a handful of extremists in Washington, DC, itself once the capital of a lawful country.
From many a bombed building, Fahdel makes silent stones speak. Through its duration and attention to everyday detail, Homeland allows us, symbolically, to sit shiva with the extended Fahdel family, friends, and, by implication, the Iraqi people, as they mourn their dead. Paying such a home visit is a deed of kindness and compassion.
Homeland certainly does not soft peddle Saddam Hussein’s brutality. Fahdel’s brother points out the country’s largest mass grave, containing victims of the 1991 post-Gulf War uprising. Firing guns into the sky, Iraqi citizens celebrate the deaths of Hussein’s cruel sons. Fahdel’s network of relatives and friends includes opponents of the regime imprisoned, tortured, and/or murdered in the 1980s and 1990s. We mourn them, too, as we grieve the victims of the American occupation.
Despite the escalating chaos, there are small signs of hope. Fahdel’s niece passes her university exams. In the penultimate sequence, a relative gives birth, to the great joy of the extended family. “She looks like her grandmother!,” one exclaims. In the final scene, however, as they drive home from the hospital, unknown gunmen strafe their car, killing Fahdel’s 12-year-old nephew. “Uncle!,” he cries, the last word spoken in the film.
My daughter’s high school civitas homework notes that Iraq was part of the Fertile Crescent, the cradle of civilization, where language, agriculture, trade, and science originated. Now, thanks to the Bush regime, there is literally no place like home for millions of Iraqis, in the shards of their country or on the trails of exile. The crooked shall not be made straight.
The epic Homeland (Iraq Year Zero) breathes life back into the vibrant society of Baghdad in 2003. Like Shoah, it is a monument to the power of cinema to recreate a vanished world. Every second in its company is richly-spent. When you have the chance, invite Abbas Fahdel into your home; “Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.”
![]()

Film Review: ‘Homeland (Iraq Year Zero)’
OCTOBER 4, 2015 | 07:38AM PT

Abbas Fahdel’s verite glimpse of life before and after the American invasion of Iraq serves as a poweful chance to empathize with the other side.
Peter Debruge
What would you do if the world’s most fearsome military presence threatened to invade where you live? How does one even begin to prepare for that kind of assault? In “Homeland (Iraq Year Zero),” Baghdad-situated filmmaker Abbas Fahdel offers world audiences an extraordinary opportunity to identify with the “enemy” in the Iraq War — conveniently faceless in most Western coverage, but humanized here by members of Fahdel’s own family. Clocking in at nearly six hours and presented in what may feel like raw homevideo form, this transformative verite glimpse into the lives of everyday Iraqis demands both patience and empathy to sit through, but the reward is worth every second, as an extremely limited number of courageous programmers and curious audiences can attest.
Stylistically speaking, Fahdel’s approach flies in the face of what we’ve come to think of as “war movies,” whether scripted or otherwise. Nothing here seems polished, manufactured or even remotely sensationalized. Recorded over the course of 17 months, beginning in Feb. 2002, the film opens with a shot of a cat, for crying out loud, and features scenes of its subjects singing, shopping and watching cartoons, as well as celebrating family weddings and religious feasts. The idea here is to immerse audiences in a world that, while superficially different from their own, resonates as familiar on the most fundamental levels — namely, that desire to be left alone and allowed to survive.
In this respect, Fahdel (who visited his relatives, but assembled the film in France, where he has spent the majority of his life) makes the curious, yet undeniably haunting choice of informing us via sober onscreen text which of his family members will die before the film ends — not so much a spoiler as a bit of foreboding that underscores the senselessness of their fates, while excusing the fact that it was never his intention to make a snuff film. Their deaths will remain undepicted. Thus, it is perhaps an hour into the film when we learn that Fahdel’s 12-year-old nephew Haidar will be killed after the U.S. invasion.
While the film’s attention has a tendency to drift at times, Haidar serves as a sort of mascot throughout, kidding around with his relatives, explaining basic principles for the camera’s benefit and trying his best to experience a normal childhood under these exceptional circumstances. Given what we already know of his fate, Haidar becomes a kind of walking ghost, helplessly naive about the actual dangers of the imminent American attack. As far as he and the family are concerned, they have been through this before: In one scene, Haidar and his cousins joke about how a diaper can serve as a gas mask, while in another, he re-applies tape to keep the living-room windows from shattering, covering traces that remain from the last war.
Divided into two parts, subtitled “Before the Fall” and “After the Battle,” the film concludes its largely 2002-set first half with a visit by Haidar to the Al-Amiriyah shelter, now a memorial to the 400 civilians killed when Americans bombed the facility in 1991. To quote one of President George W. Bush’s family members (who clearly fared better than Fahdel’s), “Stuff happens,” though “Homeland” goes a long way to recover the sense of human tragedy in what others may view as cold inevitability. In the meantime, it’s thoroughly unnerving to see Bush (and by extension ourselves) referred to in the way many of us saw Saddam Hussein depicted at the time. Here, Hussein is celebrated as Iraq’s “beloved master” by local TV, who present the U.S. as a bully nation that crossed an ocean to start a fight — though no one seems to miss him terribly once he’s gone.
The longer and less immediately engaging second half picks up three weeks after the 2003 invasion and finds both Fahdel’s family and the nation completely transformed by the experience. It’s now commonplace to see American armored vehicles in the streets, where those who might not be so candid with a foreign crew reveal how beefs with Hussein’s corrupt system have now shifted to complaints about the ineffectual new system in place. It almost goes without saying that people would be unhappy with the war, and the inconveniences captured feel relatively minor compared to those which have been thoroughly reported via more professional journalists.
Clearly determined to film everything he can from ground level, Fahdel tours the city to find many prominent buildings reduced to rubble, including both the country’s leading radio station and the Baghdad Cinema Studios’ film archive. The helmer spends much of his time in the car, guided by relatives who supply much-needed context for what we’re seeing. This unofficial driving tour has become almost hypnotic by the point the film ends — with the sort of chilling impact to which faux docs such as “Blair Witch Project” and “Cloverfield” (where the cameraman doesn’t necessarily survive the experience) have perhaps desensitized us. Here, there’s no thrill to the horror, just the heavy weight of having witnessed the true toll of xenophobia, coupled with the gift of being offered the one thing that could prevent its ever happening again: empathy.
https://abbasfahdel.com/2015/02/12/homeland-iraq-year-zero/
Ballast
Abbas Fahdel : « En Irak, encore dix ans de chaos »
Entretien inédit pour le site de Ballast
Né à Hilla, Babylone, en Irak, Abbas Fahdel est réalisateur, scénariste et critique de cinéma franco-irakien. Arrivé en France lorsqu’il avait 18 ans pour faire des études de cinéma, il a notamment signé les films Retour à Babylone (2002) etNous les Irakiens (2004). Ses réalisations témoignent d’une volonté toujours plus poignante de dépeindre le quotidien de ces individus qui vivent le chaos de nos livres d’histoire. Abbas Fahdel revient aujourd’hui avec un documentaire fleuve de 5 heures 34, dont les images datent de 2002/2003, avant et après l’intervention américaine en Irak. Dans Homeland (Iraq Year Zero), Fahdel ne filme pas n’importe quelle famille et le travail est délicat : il s’agit de la sienne propre. Entretien.
 Ce n’est pas votre premier documentaire sur l’Irak. Pourquoi ces retours ? Pourquoi vouloir à tout prix réaliser des films « de l’intérieur », en phase avec le quotidien des familles, de votre famille ?
Ce n’est pas votre premier documentaire sur l’Irak. Pourquoi ces retours ? Pourquoi vouloir à tout prix réaliser des films « de l’intérieur », en phase avec le quotidien des familles, de votre famille ?
Le fait d’avoir quitté un pays en guerre engendre une forme de culpabilité. Évidemment, je n’y suis pour rien, mais tout survivant culpabilise. Il y avait aussi ce besoin de retrouver ma famille, mon pays. En tant que cinéaste, je pense que le plus important se résume en deux mots : « regarder » et « garder ». J’ai été privé de l’Irak pendant quinze ans. En 2002, à la veille de la nouvelle guerre, je me suis dit qu’il fallait que je rentre. C’était risqué parce que, pour les autorités irakiennes, je suis irakien, mais je suis rentré avec un passeport français. Je suis arrivé avec ma caméra pour filmer : quand on est privé de ceux qu’on aime depuis quinze ans, on n’arrête pas d’y penser et on veut garder des traces, des images de ses proches.
Pourquoi avoir attendu dix ans entre le moment où vous avez tourné les images et la sortie du film ?
« Le fait d’avoir quitté un pays en guerre engendre une forme de culpabilité. Évidemment, je n’y suis pour rien, mais tout survivant culpabilise. »
J’ai beaucoup filmé : de février 2002 jusqu’à début mars 2003. On attendait la guerre qui n’arrivait pas. Il a fallu que je rentre à Paris pour la naissance de ma fille. Une fois arrivé en France, la guerre a été déclenchée en Irak, et je me suis donc organisé pour y retourner deux ou trois semaines après. J’ai continué de filmer et me suis arrêté lorsqu’un drame est survenu dans ma famille : mon neveu Haidar, qui avait onze ans à l’époque et qui s’était imposé comme personnage principal du film, a reçu une balle perdue dans la tête. Pour moi, il n’était plus question de filmer après sa mort, et même de regarder les images. C’était impossible ; je ne pouvais pas. Les images sont restées dans les boîtes pendant dix ans et, en 2013, à l’occasion du 10e anniversaire de l’invasion de l’Irak, je me suis dit qu’il fallait que je les voie. Je ne savais pas ce qu’elles valaient, mais j’avais 120 heures de rushs… et elles devaient avoir une valeur historique. J’ai regardé, et j’ai tout de suite vu Homeland possible. La question principale était : est-ce que j’ai le droit de le faire ? Est-ce que les parents d’Haidar avaient envie que le monde entier voie ces images-là ? Je leur ai demandé leur avis : ils m’ont donné leur approbation mais m’ont prévenu qu’ils ne pourraient pas regarder le film.
Votre neveu était un enfant qui, malgré sa jeunesse, avait déjà une conscience politique accomplie. L’éducation était alors soumise à la propagande du régime – les livres d’école que l’on voit à l’image sont remplis de portraits d’Hussein titrés « Our father » : comment Haidar a-t-il pu se forger sa propre opinion ?
C’était dans sa nature. Il était très mature. Son père est ingénieur et il travaillait pour une radio irakienne qui a été bombardée. Il est très cultivé. C’est l’éducation familiale qui fut en partie la cause de cette conscience politique là. Au-delà de ça, les enfants irakiens grandissent vite. Il y a eu treize ans d’embargo, la première guerre du Golfe, huit ans de guerre avec l’Iran. Ce sont des enfants qui sont nés dans la guerre. Mes neveux et nièces n’ont rien connu d’autre. Ils se racontent les guerres : dans le film, il y a une séquence où la sœur d’Haidar, étudiante à l’université, lui raconte comment était la première guerre du Golfe alors qu’ils sont en train d’attendre une nouvelle guerre. Ça fait inévitablement grandir. Ce sont des enfants qui vivent l’Histoire ; ils la connaissent mieux que ceux qui la lisent.

Image extraite de Homeland (Iraq Year Zero).
Durant votre tournage, pour vous protéger, vous étiez souvent accompagné de l’acteur irakien Sami Kaftan, le « Robert De Niro irakien », comme vous l’appelez : vous faisiez croire que vous réalisiez un reportage sur lui. Au regard des risques, pour vous et votre famille, le referiez-vous ?
Je ne sais pas. Je me dis que j’étais inconscient. Aujourd’hui, je n’aurais peut-être pas cette énergie-là. Il faut dire que la déception n’est pas un bon moteur pour travailler. À l’époque, on savait que la guerre allait avoir lieu et que ça allait être terrible, mais il y avait quand même l’espoir de voir une vraie démocratie s’installer après la chute de la dictature. Ça me donnait l’énergie pour produire et ça explique aussi pourquoi, dans le film, les gens se préparent à la guerre mais ne se lamentent pas : il ne peut rien leur arriver de pire et ils espèrent pouvoir sortir du tunnel. Or, aujourd’hui, le résultat n’est pas à la hauteur de ces espérances. Je ne cache pas que j’y ai pensé : repartir avec la caméra en Irak. Mais à quoi ça servirait ? J’ai une sœur qui vit dans la ville de Hīt, actuellement sous l’emprise de Daech depuis le mois de décembre 2014. Je suis certain que Daech ne va pas rester : c’est un phénomène qui va durer peut-être encore deux ou trois ans, mais c’est tout. Le pire, c’est que je ne vois pas à quoi ressemblerait l’après. Tous les hommes politiques irakiens sont corrompus. En ce moment, il y a des manifestations partout en Irak… Une sorte de printemps irakien. Le problème reste que la jeunesse qui se soulève dans la rue n’a pas les moyens de changer le pouvoir établi. Je ne vois pas de solution. On est probablement partis pour encore dix ans de chaos.
On vous dit documentariste, cinéaste, journaliste…
… Je suis cinéaste. J’ai regardé quasiment tous les documentaires irakiens. Le documentaire, c’est quoi ? On interviewe les personnalités qui sont impliquées dans la guerre irakienne : ex-ministre, ambassadeur… Ils racontent des choses, c’est vrai, mais ça ne nous apprend rien sur l’Irak, sur la vie en Irak et le quotidien. Ma démarche est complètement différente de celle d’un documentariste. Je veux montrer ce qui se passe vraiment là-bas, sans commentaire et sans voix off.
Votre film a deux parties : « Before the Battle », puis « After the Battle ». Dans la première, les Irakiens n’osent pas parler. Votre famille se retrouve devant les vidéos de propagande du régime et on ne sait rien de leur ressenti. Tandis que dans la seconde, les langues semblent se délier. Est-ce l’effet que produit la guerre, ou une volonté, en tant que cinéaste, de faire la part des choses entre ces deux périodes ?
« La moindre critique contre le régime menait à une exécution. Sous Saddam, les familles devaient absolument avoir un portrait de lui dans leur maison. Dans chaque quartier, il y avait une cellule du parti Baas. »
Dans la première partie, les Irakiens vivent sous la dictature de Saddam, la plus terrible au monde, semblable à la situation actuelle en Corée du Nord. Un régime très policier, très paranoïaque. La moindre critique contre le régime menait à une exécution. Sous Saddam, les familles devaient absolument avoir un portrait de lui dans leur maison. Dans chaque quartier, il y avait une cellule du parti Baas. De temps à autre, ils rendaient visite aux familles sous prétexte de les saluer. En réalité, ils vérifiaient s’il y avait bien un portrait de Saddam affiché au mur. Dans les conversations privées, je savais bien ce que ma famille pensait, mais il était hors de question de filmer ça : c’était trop risqué. Il y a quelques moments qui m’ont échappé. Par exemple, il y a une séquence dans le film où ma famille regarde des images de manifestations à Paris contre la guerre en Irak. Une de mes nièces dit : « Ils sont libres de manifester. » Son frère lui répond : « Oui, c’est pas comme chez nous. » Je ne l’avais pas entendu pendant le tournage. Comme j’ai laissé les images dix ans, je ne savais pas, et quand j’ai vu les images, je me suis dit : « Mince, heureusement que la censure n’a pas vu ça ! » Quand mes neveux et nièces jouaient sur la terrasse de la maison, craquant une allumette en chantant « Joyeux anniversaire Saddam » et qu’ils en riaient, c’était aussi très dangereux.
Par contre, effectivement, dans la seconde partie, les langues se délient. Sous Saddam, on allumait la télé et on avait le choix entre un discours de Saddam, une chanson sur Saddam ou un dessin animé. Tandis que dans la seconde partie, on dispose de centaines de chaînes satellites, y compris du porno ! Mon but était de faire un film impressionniste. Je ne voulais pas donner de commentaires ou poser des questions. L’image suffit. Je mise beaucoup sur l’intelligence du spectateur. Mes deux premiers documentaires ont été produits pas la télévision française et j’ai souffert de formatage : 52 minutes, pas de plan silencieux, pas de plan-séquence… Ils commentent tout : ceci est un verre, ceci est une tasse, etc. Mon film est un peu une réaction par rapport à toutes ces frustrations que j’ai eues et à ces compromis que j’ai dû faire avec mes deux premiers films.

Pour en revenir sur la censure, comment avez-vous fait, justement, pour faire passer autant d’images critiquant le régime irakien jusqu’en France ?
Je suis rentré en Irak avec un passeport français en 2002. On ne peut pas sortir d’Irak sans montrer les cassettes à la censure. Certaines n’étaient pas montrables. Je n’ai jamais filmé quelqu’un qui disait directement du mal de Saddam. Malgré cela, il y avait des choses que je ne pouvais pas montrer. J’ai donc fait un tri dans les cassettes et j’en ai donné une partie à Sami Kaftan. Il habite en face du ministère de l’Information ; c’est un peu son arrière-cour. Il a passé deux heures avec les responsables de la censure qui ont regardé les cassettes et lui ont demandé «Mais pourquoi il a filmé tous les discours de Saddam du début jusqu’à la fin ? » Malin, Sami leur a répondu : « Mais pourquoi ? Vous avez quoi contre les discours de Saddam ?! » J’avais un ami qui était attaché culturel de l’ambassade de France à Bagdad. Aujourd’hui, je peux le dire, parce qu’il y a eu prescription. Je l’avais invité chez moi, à Bagdad, et je lui ai demandé : « Si j’ai des cassettes un peu problématiques, est-ce que je peux me les faire envoyer par l’ambassade ? » Il a tout de suite accepté. Je tiens à le dire parce que je trouve que c’est un geste héroïque : en tant qu’attaché culturel, il se devait de soutenir ma démarche.
En parlant de culture, il y a un moment fort dans votre film, celui où l’on découvre l’Office du cinéma et du théâtre irakiens complètement anéanti par les bombardements américains. Que reste-t-il du cinéma et de la culture irakienne au lendemain de ces attaques ?
« On a beaucoup parlé du pillage du musée de Bagdad dans les médias internationaux, mais personne n’a parlé de la destruction des archives du cinéma et de la télévision irakienne. »
On y regroupait toutes les archives du cinéma irakien, vraiment tout : les films de fiction, les reportages, les dessins animés, les archives d’actualités… Tout a été brûlé et pillé le premier jour de la chute de Bagdad. On a beaucoup parlé du pillage du musée de Bagdad dans les médias internationaux, mais personne n’a parlé de la destruction des archives du cinéma et de la télévision irakienne. Ils ont pris les ordinateurs, les chaises et tout ce qui pouvait servir, avant de brûler le reste. La mémoire audiovisuelle du pays est partie en fumée avec les bobines de films…
Vous montrez un Irakien fier de porter une arme et d’en avoir dans sa maison pour se défendre. On apprend ensuite qu’il a été tué par une bande rivale. Avez-vous été témoin d’une forte présence de cette mafia irakienne ?
C’était la loi du plus fort. Dans chaque quartier, il avait des voyous qui n’avaient pas bougé sous Saddam. Lorsque la dictature est tombée, ils en ont profité pour semer la terreur dans leur quartier. Devant la caméra, ils passaient pour des gentils en disant qu’ils protégeaient le quartier, mais c’était faux ! La famille de la femme de mon frère y vivait. On allait leur rendre visite. Il y avait ces deux types-là dans la rue et mon frère m’a raconté leur histoire : ils volaient des voitures et les revendaient. Je n’ai pas assisté à leur assassinat, c’est mon frère qui me l’a appris plus tard, alors que je demandais des nouvelles depuis Paris. Ce sont effectivement des mafias : il suffit qu’il y ait une bande rivale sur leur territoire pour que ça éclate.
Le film sortira en salle en 2016. Qui est le distributeur ?
C’est Nour, une jeune maison qui a distribué beaucoup de films documentaires ; ils sont vraiment engagés. Nour, en arabe, signifie « lumière »… ce qui veut tout dire. Ils ont une démarche militante et ont beaucoup aimé le film. Je pense qu’ils vont vraiment bien le défendre.

Avril 2003 | AFP.
Si on vous demandait de réduire la durée de votre film, le feriez-vous ?
Vous, vous avez vu le film. Est-ce qu’il y a des moments à couper ? Toutes les personnes qui l’ont vu ont compris que la durée du film se justifiait. Il m’est arrivé de m’ennuyer devant un film de cinq minutes. Dans les cinq minutes, il y en a parfois quatre de trop. Ce n’est pas la durée du film qui compte, mais la manière dont on l’exploite. J’avais justement cette crainte-là : les gens ne sont plus habitués à voir un film de cinq heures trente. Quand j’ai eu l’idée du film, en 2013, j’en ai parlé aux producteurs des deux premiers films. Ils m’ont dit que ça ne serait pas possible et qu’ils ne pourraient pas trouver de financement, ni à la télévision, ni ailleurs. C’est pour ça que je l’ai produit moi-même.
Que s’est-il passé au moment où vous vous êtes dit « Je dois faire un film avec ces images » ? Comment l’idée a-t-elle été accueillie par les producteurs ?
« J’ai donc décidé de le produire seul, quitte à le diffuser sur Internet. J’avais ces images, et je n’avais pas le droit de ne pas les montrer. »
Les premières réactions étaient très négatives. La productrice de mes deux premiers films m’a dit que ce film ne serait pas faisable, car trop long. J’ai donc décidé de le produire seul, quitte à le diffuser sur Internet. J’avais ces images, et je n’avais pas le droit de ne pas les montrer. Une fois que je l’ai produit, j’ai contacté Arte, car je pensais que c’était la seule chaîne capable de s’intéresser à ce genre de film. Je leur ai envoyé un e-mail. Je leur ai montré et, un mois après, ils m’ont répondu que c’était une réalisation extraordinaire, qui éclairait beaucoup de choses sur l’Irak mais, malheureusement, qu’ils ne voyaient pas comment programmer un film aussi long sur leur chaîne… En lisant cette réponse, je me suis dit que personne n’en voudrait : ni producteur, ni distributeur, ni chaîne de télévision, et certainement pas des festivals ! J’ai eu une très bonne surprise lorsque j’étais en vacances en Grèce. J’ai reçu un coup de téléphone : « Je suis Luciano Barisone, directeur artistique du festival Visions du réel à Nyon ; j’ai regardé votre film, c’est extraordinaire. Je le veux en première mondiale dans mon festival. » Ça, c’était l’année dernière, cinq ou six mois avant le festival.
Votre famille vit toujours en Irak ; est-ce que vous comptez y retourner bientôt ?
J’y retourne régulièrement, au moins une fois par an. Par contre, lorsque j’y vais, je pars sans ma caméra. Je ne veux plus filmer. J’ai peur de filmer quelqu’un, et qu’après… par superstition. Après la mort d’Haidar, ma sœur est partie de Bagdad ; elle a eu peur pour ses autres enfants. Elle est partie s’installer à Kerbala, au sud de Bagdad. Elle voulait être plus proche de la tombe d’Haidar parce que, pendant trois ans, tous les jours, elle… [L’émotion commence à emporter Abbas ; nous lui demandons s’il préfère passer à une autre question.] Je dois finir ma phrase… c’est très important pour moi. Tous les jours, pendant trois ans, elle se recueillait sur la tombe d’Haidar. C’est important à dire car une mère qui perd son enfant, ce n’est pas anodin. À force de parler du film, je finirai par en parler comme un film, et plus comme l’histoire de ma famille.
BALLAST Abbas Fahdel _ « En Irak, encore dix ans de chaos »

Paz para Nós em Nossos Sonhos (Peace to us in our dreams), de Sharunas Bartas (Lituânia, 2015), A Obra do Século (La Obra del siglo), de Carlos Quintela (Cuba, 2015) e Terra Natal: Iraque Ano Zero (Homeland: Iraq Year Zero), de Abbas Fahdel (Iraque, 2015)
outubro 22, 2015 em Coberturas dos festivais, Em Campo, Pedro Henrique Ferreira

Distopias e barbárie
por Pedro Henrique Ferreira
É praticamente inevitável que as nações que de algum modo viveram sob o ideário comunista no século XX lidem com as transformações de seus respectivos países a partir da abertura e o que esta proporcionou, seu significado mais profundo nos cenários e nas pessoas. A tônica de muitos destes filmes é a do desamparo e abandono, como se a guinada capitalista houvesse forçado um certo estado pós-apocalíptico. É algo presente no cinema de algumas figuras hoje um pouco mais conhecidas de nós, como, por exemplo, Béla Tarr, Zvyagintsev, Skolimowski ou Mungiu, mas também de figuras que são menos estabelecidas.
Um caso evidente é o de Sharunas Bartas. Inicialmente, encontramos poucos ou nenhum ponto de identificação com seu universo aqui nos trópicos. Razão pela qual não nos conectamos tanto com seu estilo, e a recepção de seus filmes no Brasil eventualmente passa um tanto mais batida do que deveria. Seu cinema, aparentemente difícil de ser tragado, é não obstante um dos mais importantes reflexos do destino do Leste Europeu pós-URSS. Seu mais recente, Paz para Nós em Nossos Sonhos, é um exemplar dos seus mais gélidos, lentos e silenciosos, o que em princípio pode afastar, embora quem esteja disposto a passar pela árdua experiência encontrará filme de alguma força. Não é das maiores obras de Sharunas Bartas, e segue em muito o diapasão de seu longa-metragem prévio, o noir O Renegado do Leste. Embora ainda carregue força particular, não está exatamente à altura de alguns de seus trabalhos anteriores (p.e.:Três Dias, A Casa ou Liberdade). Também não serve como mostruário de seu cinema, embora rapidamente notamos estar dentro de seu universo.
A premissa narrativa é uma viagem à casa de campo de um homem (encenado pelo próprio diretor), sua esposa (Yekaterina Golubeva) e sua filha (Ina-Marija Bartaite, filha biológica de Bartas). Todos vivem dramas e buscam remediá-los com a viagem. O longa-metragem ainda soma alguns outros personagens ao trio da família, outras figuras que vivem e participam do cenário melancólico. O que chama atenção é como a história destas figuras é construída isoladamente. A família convive no mesmo espaço e, no entanto, os dramas de cada um não têm muito nexo com os do outro. A câmera de Bartas não penetra nestes dramas: os observa como parte da superfície do mundo. Como em seus filmes anteriores, o diálogo é quase nulo. O vocabulário cinematográfico minimalista é feito de rostos, gestos, posturas e paisagens. A impressão que nos é deixada é a de um enorme vazio; uma poética construída em cima deste vazio, mais ligada à idéia de uma fotogenia epsteiniana com senso plástico mais contemporâneo (próximo, quiçá, ao de Leos Carax, com quem o diretor guarda proximidades pessoais e artísticas, embora aqui menos que em outros de seus filmes, como, por exemplo, A Casa) do que da angústia antonionesca. Não há incomunicabilidade, pois, para havê-la, pressupõe-se uma vontade não-atingida de diálogo. Os personagens de Bartas, no entanto, mais do que não se entenderem, mal se falam. Convivem meio que alheios uns aos outros, tratando-se quase como que objeto e cenário de suas vidas. Talvez a única exceção seja a violinista bergmaniana, cujo drama nos lembra um pouco o mal vivido pela protagonista de Através do Espelho – embora sem redenção, e quando tenta conversar sobre música clássica com a vizinha, logo nota ter sido uma má ideia sequer começar a investida.
As pequenas tramas vão se construindo paralelamente umas às outras até desaguarem numa tragédia, como no mais recente longa-metragem de Skolimowski. Em muitos sentidos, o filme de Bartas é uma versão mais bem-sucedida de 11 Minutos. A tragédia é também aparentemente conduzida pelo acaso, mas, no fundo, resultado de uma assertiva moral, porém menos externa às circunstâncias que no caso do primeiro, no qual o agente trágico era mais visivelmente um julgamento divino ex machina. Aqui não há Deus. São mais evidentemente as ações dos homens, cada um respondendo individualmente a seus próprios estímulos, dramas e fantasmas, como se os demais coabitantes daquele espaço fossem apenas uma outra parte do cenário. Em um dos discursos finais, uma das poucas falas de Paz em Nós para Nossos Sonhos, o protagonista diz que segue apenas suas vontades, que é assim que o mundo funciona e que qualquer outra atitude é simplesmente mentirosa. O discurso se quer realista e, no entanto, sua associação à tragédia posterior o torna um tanto cínico, como se este tipo de individualismo houvesse criado um mundo de sentimentos erráticos e vítimas aleatórias, como se o capitalismo houvesse nos conduzido moralmente mais próximo à barbárie. A trama minimalista é alçada à condição macro, mítica como nos filmes de Zvyagintsev. É uma visão dos descaminhos do Leste Europeu no mundo após a invasão da abertura de mercados, tornada, se não em dramas pessoais, justamente na exaltação do individualismo presente nos mais novos dramas da realidade cotidiana do país. A tentativa de reconexão com um sentido mais humanista é em vão; o final trágico, sua condenação moral (como em inúmeros dos produtos cinematográficos da região). A experiência comunitária algo distante, inconcebível no mundo moderno e capitalista, um produto de um passado morto e sonhado, referenciado no título.
Encontramos em A Obra do Século outro exemplar sobre o destino distópico de uma nação após o fim da União Soviética, embora quase oposto. Saltamos aqui para uma Cuba estagnada e sofrida, outrora o país de Terceiro Mundo que foi o principal investimento bélico do bloco comunista nas Américas. O que está em jogo é a contraposição entre uma república sonhada e uma realidade disforme. A dualidade é favorecida pelo dispositivo que contrapõe imagens documentais coloridas de propaganda da construção de uma usina nuclear titânica durante os anos da Guerra Fria e a encenação em P/B da vida cotidiana de pessoas que eventualmente se mudaram para uma cidade construída em torno da usina e que, hoje em dia, vivem em certo estado de sonambulismo. As imagens coloridas do passado anunciam desenvolvimento e vislumbram um futuro otimista. As imagens do presente são de uma cidade vazia, o resultado de um projeto naufragado, e revelam imobilidade torpe. A Cuba que enxergamos não é aquela do Caribe paradisíaco, mas um mundo em ruínas, que parou no tempo após o fim de seu principal investidor.
A trama acompanha três homens que vivem sob o mesmo teto. O engenheiro Rafael (Mario Guerra) mudou-se para a cidade durante a década de 1970 para trabalhar na usina. Desde o abandono do projeto, vive desempregado e sem ter dinheiro para sair de lá. Junto dele, moram seu pai, Otto (Mario Balmaseda), um senhor de opiniões retrógradas que acredita ainda mandar na casa, e seu filho, Leo (Leonardo Gascón), jovem que retornou ao apartamento do pai após separação traumática com a ex-mulher. Enquanto o exterior é um cenário amplo e vazio da cidade, centralizada pela monumental usina largada às moscas, o interior é um espaço apertado, que força as três figuras a estarem em contato o tempo todo. O lugar cria evidente conflito de gerações entre uma Cuba reacionária pré-regime, representada pela figura do avô, uma outra Cuba que participou do regime e hoje se vê frustrada pelos descaminhos da nação, representada na figura do pai, e ainda uma terceira Cuba jovem, apática, sem vontade de criar vínculos mais fortes com o passado e mais envolta em seus próprios dramas pessoais.
Os grandes méritos de A Obra do Século estão na capacidade inventiva e no olhar humano com a situação. O cenário apocalíptico não se torna desculpa para a frieza. Neste sentido, a atitude de Carlos Machado Quintela é quase oposta à de Bartas. Mesmo na medida em que paira sobre aqueles personagens um enorme sofrimento, nem por isso o cinema precisa enxergá-lo como tragédia. As situações são, com muita simplicidade, trabalhadas mais na chave do cômico, seja nas perguntas absurdas do avô, na autoindulgência do pai ou na falta de conexão com a realidade do filho. Mesmo o leit motif do peixe no aquário, figura que simboliza a paralisia daquela família, adquire mais conotações cômicas que propriamente pesadas. É como se o diretor cubano vislumbrasse que, mesmo na distopia, existe enorme capacidade de rir de si próprio. Eventualmente, mesmo genuínos laços fraternais. Em suma, que o cenário do abandono não elimina estados de espírito próprios ao homem em qualquer local ou situação, que não nos cobra necessariamente uma atitude realista diante da cena, que a inventividade e o sonho ainda são possíveis. Não à toa, A Obra do Século em alguns momentos flerta com a ficção científica, transformando o elefante branco em máquina, aproveitando-se do cenário pós-apocalíptico de forma semelhante, por exemplo, aBranco Sai, Preto Fica em alguns cenários da Ceilândia.
Quem mais se dedicou a mostrar a própria nação como um espaço pós-apocalíptico foi certamente o diretor Abbas Fahdel no impressionante documentário de cinco horas e meia Terra Natal: Iraque Ano Zero. As circunstâncias aqui são completamente diferentes das dos dois filmes mencionados anteriormente. Primeiramente, porque o Iraque não participou do bloco soviético; tornou-se inimigo dos EUA mais à frente. Depois, por causa do dispositivo. O longa-metragem de Fahdel investe no cinema direto, esboçando uma crônica de sua própria família nos momentos imediatamente anterior e posterior à invasão norte-americana.A Obra do Século também mostrava o passado, mas como projeto, não como cotidiano. Fahdel consegue extrair da primeira parte de seu longa-metragem um retrato fidedigno dos hábitos dos moradores de Bagdá, que faz também com que a segunda parte do filme se torne poderosa graças à oposição com a primeira.
Um comentário sobre o dispositivo: houve dois outros filmes exibidos no Festival do Rio que também fizeram experiências cinematográficas partindo do cinema direto e que, mais do que isso, se dedicaram a alçar o fato epistolar à condição de representante de uma fronteira geográfica/tempo histórico. No filme EmJackson Heights, Frederic Wiseman se via diante de um bairro nova-iorquino e seus múltiplos espaços, demonstrando a democracia norte-americana ideal em estado vivo. Em Istambul – Crônica de uma Revolta, Pilavci e Gottschilich faziam remissão à cidade enquanto filmavam uma praça, extraindo consequências sobre um estado político mais amplo. Em Terra Natal: Iraque Ano Zero, o destino do país é apresentado pelo vai-e-vém de uma família. No primeiro caso, Wiseman se abstém completamente de intervir na narrativa. No segundo caso, as duas diretoras se engajam politicamente em um dos lados da disputa e recontam as experiências vividas, adicionando inclusive a voz em off que reorganiza as imagens. Já Terra Natal: Iraque Ano Zero faz curioso jogo em que o diretor filma praticamente sua vida, aceitando-se como personagem, embora sempre oculto por trás da câmera. Recusa-se a omitir opiniões certeiras sobre os muitos assuntos discutidos, embora fique evidente a recusa à invasão norte-americana tanto quanto ao governo de Saddam Hussein.
Este modo simples de filmar se revela de enorme complexidade. Envolve a tarefa árdua de dialogar ativamente com o que está em cena e extrair o sentido dramático. Propor as regras da partida sem interferir no resultado. A capacidade de criar distância das imagens que fazem ou fizeram parte de seu próprio repertório cotidiano nos recorda o trabalho de Jonas Mekas, embora Fahdel aqui tenha de lidar com o fato presente, e não com a memória. Graças a esta habilidade e ao cuidado que tem para não se tornar o protagonista da filmagem de sua própria vida, o diretor consegue inventar, por exemplo, um personagem tão carismático quanto o do sobrinho, que, de figura ocasional, é enaltecido a representante de um mundo, seu destino tornado a condição de toda uma geração.
O título faz menção à obra de Rossellini, Alemanha, Ano Zero, em qua a vida de um outro menino encarnava o fantasma germânico do imediato pós-guerra. A morte dele era a tragédia do espírito e a expiação de um destino histórico. Em muitos sentidos, é o mesmo que acontece com o sobrinho em Terra Natal: Iraque Ano Zero. Do mesmo jeito que o personagem rosselliniano, a criança se porta como adulto. É o herdeiro de uma tradição, um tanto velha e cheia de verdades. O tempo todo, incorpora um espectro maior que seu pequeno corpo. O que chama atenção principalmente é como o longa-metragem consegue explicitar que a mudança sofrida por Bagdá após os bombardeios norte-americanos não está somente nos escombros de uma antiga civilização ou no cerceamento imposto pelo exército invasor. O Iraque passa a ser uma terra caótica e sem lei. Tiroteios são cotidianos. O desemprego cresce. Os moradores se adequam a esta nova realidade imposta pela guerra da forma como podem.
Mais importante que isso, a mentalidade começa a se transformar com a iminência da guerra. As crianças já brincavam de dar tiros e jogar bombas. Um sentido de barbárie penetra sorrateiramente naquele microcosmo. O herói rosselliniano de Alemanha, Ano Zero agia inconscientemente como que por brincadeira. A certa altura, a brincadeira se torna realidade. O mesmo acontece aqui. A guerra não destrói apenas os cenários. Ela inventa novas paisagens mentais. Transforma o mundo não somente a partir de uma disputa pelo poder, mas principalmente através do repertório de imagens que povoa o imaginário comum. Paulatinamente, acostumamo-nos a viver em outro mundo, com outras regras, onde tiroteios, por exemplo, são dados comuns. O que conduz Terra Natal: Iraque Ano Zero a seu momento ápice, surpreendente justamente porque passamos a nos acostumar com a aquilo tudo, o momento em que a tal brincadeira enfim ganha realidade. Neste sentido, o suicídio do menino em Alemanha, Ano Zero é um correlativo da morte do menino iraquiano. Ela surge como uma espécie de martírio mais amplo, uma revelação de que certas coisas foram perdidas.
Cinecolor Argentina
Valdivia 2015
Crítica de Homeland (Iraq Year Zero), de Abbas Fahdel
Ganadora del prestigioso festival suizo Visions du Reel de Nyon, Homeland -que nada tiene que ver con la popular serie homónima- es un documental estremecedor, que cambia por completo la perspectiva sobre el conflicto de Irak.
El resultado de tantos meses de filmar tanto en la casa familiar como en las calles (el viejo recurso de salir con un auto para rodar y tomar testimonios adquiere aquí unas dimensiones inusitadas) es una película de casi 6 horas divididas en dos partes: Before the Fall (que muestra los preparativos de la población ante la ya inminente invasión norteamericana en medio del aparato propagandístico de Saddam Hussein) y After the Battle (que expone las consecuencias del ataque, el caos social incluso con el control estadounidense que incluye saqueos y secuestros por parte de bandas criminales).
La película está llena de situaciones extremas (que incluyen el asesinato de Haidar, el querible sobrino de 12 años del director) y de otras no menos conmovedoras como recorrer lo que quedó (escombros) de la radio o del archivo fílmico de los Baghdad Cinema Studios, pero con recorrer las calles desoladas, las viviendas arrasadas o un mercado popular alcanza para comprender que sobre Irak hasta ahora sólo habíamos conocido una de las campanas, la de los “vencedores”. Es tiempo, con este magnífico trabajo -épico y artesanal a la vez- de apreciar la otra mirada: la de los vencidos, la de las víctimas, la de los invisibles.
ETATS GÉNÉRAUX DUDOCUMENTAIRE, 2015

Homeland (Iraq année zéro) d’Abbas Fahdel.
“Un événement dont l’onde se propage encore de festival en festival fit halte à Lussas : Homeland (Iraq année zéro) d’Abbas Fahdel, film en deux parties pour une durée totale de près de cinq heures trente. Film à la finition retardée et dont l’écho est d’autant plus troublant : Fahdel était parti retrouver sa famille irakienne, qu’il n’avait pas vue depuis ses dix-huit ans, quelques mois avant l’invasion américaine de 2003 ; par malchance, il est rentré en France juste avant le déclenchement des hostilités, et est revenu filmer deux semaines après la conquête. Les rushes sont restés dix ans dans un tiroir, parce qu’un de ceux qui y étaient le plus présent, Haidar, neveu d’une douzaine d’années, a trouvé la mort au hasard d’une fusillade alors qu’il trônait sur le siège arrière d’une voiture à côté de son oncle cinéaste. Dix ans, c’est le temps de deuil qu’il a fallu pour oser affronter les images de ce garçon sémillant, bavard avec bonheur, qui, mort, est devenu la colonne vertébrale d’un film qui est aussi son tombeau (les dernières images sont celles de sa sépulture) ; c’est aussi le temps qui nous sépare d’un événement qui ouvrit l’âge au cours duquel « l’antiterrorisme » devait devenir la méthode de gouvernement par excellence, et où la France résistait encore à cette fausse raison sécuritaire avant de prendre le pas comme toute bonne nation impérialiste. De là l’étrangeté de ces images nous rappelant à une cause doublement perdue (marquée par l’échec, puis oubliée).
La première partie narre une attente oscillant entre angoisse et espoir, entre la peur d’un enlisement guerrier et l’excitation à l’idée d’être enfin débarrassé de la clique baasiste. Scènes privées pour l’essentiel, interdiction de tourner oblige ; le film adopte la forme d’un diarisme familial à l’occasion agrémenté de sorties en voiture, notamment aux côtés de la superstar irakienne Samir Kaftan. Ou comment figurer la politique par son négatif, c’est-à-dire allégoriser sa privation : l’impossibilité visuelle d’une scène commune dit assez la dissolution de l’espace public en régime dictatorial (à la place, les émissions saddamolâtres que la télé passe en boucle, avec tout le kitsch esthétique d’une telenovelas). La seconde partie montre un peuple qui déchante après sa supposée libération par une armée qui, quels que soient ses airs de sauveuse, ne peut pas ne pas avoir l’arrogance de la conquête ni les bavures du pouvoir. Pour principal changement, le déliement des langues et l’émancipation de la caméra. Le cinéaste peut enfin sortir de son confinement domestique et parcourir les rues pour observer les ratés de la libération : telle personne subissant la vindicte indue des pouvoirs en place, telles destructions « accidentelles » par des bombardements compulsifs et qui laissent les populations sans abris, telle insécurité générale en raison de l’anarchie entretenue par des gangs nouvellement essaimés. Centralité des dommages collatéraux. Le film laisse une belle place, glorieuse même, à ceux qui pour n’être d’aucun côté subissent les feux croisés des factions en désordre. Une des plus belles scènes montre une manifestation d’Irakiens soulevés contre l’occupation illégitime d’une armée qui, au nom de sa propre sécurité, met en suspens la sûreté de chacun. Et une autre, centrale, consiste en une visite des studios de cinéma ravagés par les bombes, studios qu’autrefois jalousaient tous les pays voisins et qui ne sont plus que cendres dans lesquelles disparaît tout un pan de la mémoire nationale. Toute cette seconde partie est construite sur une telle dialectique de la mémoire, montrant d’un côté l’arasement historique qu’entraîne une invasion méconnaissant les us de ceux qui, « libérés », n’en sont pas moins maintenus dans un statut de vaincus, de l’autre les remontées d’une mémoire interdite pendant les heures d’Hussein : celle de ceux qu’il a persécutés, effacés, et dont les noms et les visages reviennent sous forme d’affichettes collées un peu partout – comme si la seule vraie libération était celle des morts sortant enfin d’un silence qui aggravait leur disparition.
La référence du titre à Allemagne, année zéro de Rossellini n’a rien de gratuite. Les deux cinéastes ont partagés un même problème – comment raconter un pays enseveli sous les décombres – et une solution similaire – prendre le prisme de la famille, voir les événements se réverbérer sur les vies de quelques êtres. Ce qui fait que le meilleur observatoire de l’irrémédiable altération est une voiture depuis laquelle sont filmés une très grande partie des longs plans du film, comme s’il était besoin d’une vitre pour refléter le changement. L’autre point commun avec le maestro italien, c’est l’enfant comme crucifié de la guerre. Seulement, le petit Edmund optait pour un grand saut dans le vide signifiant la fin de tout suite à la déraison du monde, quand Haidar, lui, est tué par une balle qu’on imagine perdue – toute la différence de deux destins nationaux, entre l’autodestruction et l’assassinat géopolitique. Restent les autres enfants, nombreux dans le film, vraies machines à regard-caméra. On se souviendra d’une scène dans laquelle une flopée de bambins s’empare de différentes munitions traînant sur le bas-côté, et les dénomme une à une devant le cinéaste. Est sensible, dans le regard de celui-ci, toute l’inquiétude amoureuse qu’il porte à ces enfants, et qui fait que, chose rare, ces multiples plans sur l’innocence du jeune âge ne tombe pas dans la mièvrerie qu’ils encouragent généralement. Grande vertu de Homeland que sa retenue sans prétention, dans laquelle la tristesse fait taire l’indignation vertueuse et opte pour le mutisme du regard désolé.”
Etats généraux du documentaire, 2015 – Débordements
Hors-Champ (quotidien des Etats Généraux du Film Documentaire de Lussas)
Entretien avec Abbas Fahdel
– Vous n’apparaissez pas à l’écran dans votre film, vous n’en êtes pas le sujet. Cependant, vous avez pris des risques personnels en vous rendant en Irak en 2002…
– J’ai pris ce risque de filmer en Irak parce que je suis irakien, ma famille vit là-bas et je suis cinéaste. Dans le contexte de l’imminence d’une intervention américaine, que pouvais-je faire d’autre ? Un poète écrit, un peintre fait un tableau… J’ai pris ma caméra, j’y suis allé sans savoir si je pourrais revenir en France et si je pourrais filmer. En 2002, j’avais la nationalité française. Je ne pouvais pas pénétrer en Irak en tant qu’Irakien : comme je n’ai pas fait mon service militaire, les autorités m’auraient interdit de quitter le pays. Même avec un passeport français, je prenais tout de même des risques. Le régime de Saddam était comparable au régime nord-coréen d’aujourd’hui… en plus paranoïaque. Filmer en Irak n’était pas autorisé. Un mois avant que je ne commence mon tournage, un Britannique d’origine irakienne avait été arrêté parce qu’il prenait des photographies ; il avait été jugé et exécuté… J’ai beaucoup filmé à l’intérieur des maisons, depuis l’intérieur des voitures : cela ne pose pas de problème. Pour les séquences extrieures, je faisais des repérages une demi-heure avant ou la veille, j’observais, je prévenais certaines personnes, pour des questions de sécurité. Souvent aussi, je me faisais accompagner par Sami Kaftan, l’équivalent d’un De Niro pour les Américains, un ami acteur qui apparaît dans le film. Il a accepté de prendre ce risque-là pour moi. Quand les Irakiens me voyaient avec lui, ils pensaient que je faisais un reportage sur lui !
– Homeland 1 est construit comme un film de suspens. Avec ce paradoxe, cette tension permanente : d’un côté, une population sous tension, inquiète, se préparant à une guerre inévitable ; de l’autre, une grande solidarité, des jeux d’enfants, de la quiétude…
– En 2002, la grande majorité des Irakiens redoutaient la guerre mais ils l’espéraient aussi, pour se débarrasser de Saddam. Tous voulaient retrouver une vie normale après treize années d’embargo qui ont causé un nombre de morts plus important que pendant une guerre. À l’image, les Irakiens que j’ai rencontré ne réclamaient pas la fin de Saddam : ils ne sont pas fous ! Cependant, avec l’imminence de la guerre, les gens commençaient à oser parler, surtout à un Franco-Irakien comme moi qui vit à l’étranger. Les gens comprenaient très vite que j’étais irakien et que je n’habitais pas l’Irak : par exemple, je n’ai pas de moustache ! Il me voyait m’intéresser à leur vie quotidienne, ce qui leur semblait incongru… En Irak, je n’avais pas peur : avant même d’y aller, je me disais que j’allais peut-être mourir là-bas. Cette pensée m’a apporté la paix. Ce n’était pas héroïque, j’avais fait ce que j’avais à faire dans ma vie. De plus, j’avais la conviction de réaliser un film utile, qui me survivrait, un film plus important que ma seule existence. Enfin, je n’étais pas différent de chaque Irakien qui, sortant de chez lui, n’était pas sûr de revenir. Mon soulagement est que si j’étais mort là-bas, mon film n’aurait pas existé…
– Guidée par l’avancée des voitures et le déplacement de vos personnages, votre caméra semble parfois voler sur ces territoires. L’image semble cramée par la lumière, embrassant de larges espaces…
– La caméra passait des lumières extérieures à celles de l’intérieur, de l’ombre au zénith. Mon angoisse était de savoir s’il resterait quelque chose à l’image. En Irak la lumière n’est pas comme en France : l’impression d’éblouissement est donc accidentel. J’ai passé six mois à étalonner et mixer le film. Pour le son, je travaillais avec deux micros, un micro-cravate sur l’un des personnage et le micro de la caméra. Dans Homeland 2, toutes les maisons, faute d’électricité, étaient équipées de groupes électrogènes très bruyants : j’ai donc passé beaucoup de temps à nettoyer le son. Ma fierté est que chaque Irakien peut comprendre chaque mot du film. J’ai choisi un objectif grand angle afin de filmer dans des espaces confinés : salons, intérieurs de voiture.. Ce choix d’optique m’a permis de réunir de nombreux personnages dans un même plan.
– La lumière des visages rythme votre film, les sourires inespérés illuminent les situations et ne cessent d’éclore…
– Les mêmes personnes filmées par quelqu’un d’autre n’auraient pas offert ces sourires-là. On dit que la beauté est dans le regard de celui qui regarde. J’étais ému lorsque je regardais les Irakiens, car je les trouve si beaux, hommes, femmes, enfants. Certes, je voulais ponctuer le film de regards caméra, mais je n’avais pas anticipé l’importance que les regards et les sourires prendraient. J’ai été privé de l’Irak que j’ai fui à dix-huit ans. Lorsque je suis revenu vingt ans après, les gens ont perçu dans mon regard cet amour : ils se sont senti en confiance, ils savaient mon empathie.
– Le regard des enfants traverse la guerre, survit au désastre. Pourquoi donnez-vous une si grande place à l’enfance dans votre film ?
– Lors d’une séquence à Bagdad, ma famille regarde une vidéo des manifestations anti-guerre à Paris. Ma fille y apparaît, agitant un drapeau irakien ; une femme lui demande de quel pays est le drapeau et ma fille lui répond : « Irak. » Ma fille est née la nuit de la première guerre du Golfe. Lorsque j’assistais à sa naissance à Paris, les Américains bombardaient Bagdad. La guerre, c’est la mort et la destruction ; les enfants, c’est la vie. Pour moi, sa naissance a été une victoire sur la guerre : cette nuit-là, au moins une irakienne échappait à la mort. Aujourd’hui, tous les jours, il y a des manifestations à Bagdad contre le pouvoir et la corruption. La jeunesse est dans les rues, les enfants que j’ai filmés en 2003 sont maintenant les acteurs du « Printemps irakien ». J’ai filmé les enfants parce que ce sont eux que l’on doit regarder en cas de guerre. J’ai terminé de filmer en 2003 ; cette année-là, mon neveu Haidar est mort. Il m’a fallu dix ans avant d’avoir le courage de regarder mes images pour voir ce qu’il en restait. J’ai alors vu des images qui avaient pris toute leur valeur. En 2013, dix ans après l’invasion de l’Irak, j’ai commencé : un an et demi de montage, cent-vingt heures de rush ; trois étapes de film : une version de douze heures, puis de neuf heures et maintenant de cinq heures et demi. Ce travail a été un torrent d’émotions. Voir Haidar tous les jours m’a fait beaucoup pleurer. J’ai dit à ma famille qu’il fallait que je termine ce film pour les Irakiens et qu’Haidar en serait le principal personnage ; ils m’ont répondu : « Fais ton film, Abbas, mais nous ne le regarderons pas. » Ils n’en supporteraient pas la vision. Ce que j’ai filmé est un moment historique qui a disparu, non pas une fiction. Revoir ces images, c’est accéder à un monde qui n’est plus. En tant que cinéaste, en tant qu’Irakien, c’est un éblouissement. L’une des séquences importantes du film se déroule dans l’Office du cinéma où un ami déambule au milieu de centaines de bobines brûlées.Toute la mémoire visuelle du pays a été détruite. Si vous avez la photographie d’un disparu, vous avez au moins son image ; si vous ne l’avez pas, vous le perdez alors définitivement. L’idée de garder des traces m’a obsédé et lorsque j’ai vu mes images, j’ai compris que de ce monde au moins il resterait cela pour les Irakiens.
Propos recueillis à Lussas par Sébastien Galceran et Mickaël Soyez
Hors champ – Homeland (Irak année zéro) de Abbas Fahdel – Tënk
 30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 2015 (03) / CRÍTICAS BREVES (112): HOMELAND: IRAQ YEAR ZERO:
30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 2015 (03) / CRÍTICAS BREVES (112): HOMELAND: IRAQ YEAR ZERO:
*** Obra maestra ***Hay que verla **Válida de ver * Tiene un rasgo redimible ° Sin valor
Por Roger Koza
 Homeland: Iraq Year Zero, Abbas Fahdel, Irak-Francia, 2015. (****)
Homeland: Iraq Year Zero, Abbas Fahdel, Irak-Francia, 2015. (****)
Una extraña obra maestra, una de las películas del año, un retrato de la vida en Irak antes y después de la invasión estadounidense en marzo de 2003, con las lógicas consecuencias de un acto bélico de esa naturaleza. El admirable trabajo de registro y montaje por parte de Abbas Fahdel, quien estudió en su momento con Jean Rouch, permite asir la cotidianidad en Bagdad y la cultura iraquí a partir del punto de vista articulado por el director, que sigue la vida familiar de los suyos en yuxtaposición con la crónica de su país, desde que empieza a conocerse el deseo por parte de Estados Unidos de derrocar a Sadam Hussein. La hazaña humanista de Fahdel consiste en sintetizar una experiencia colectiva, demostrando el desorden estructural que siembran los estadounidenses con sus expediciones democráticas, sin apelar a la demonización del enemigo. Pero este filme tan amable como devastador no sería el mismo sin la presencia de Haidar, el sobrino de 12 años del director, cuya curiosidad y simpatía infinitas entrarán en una deletérea dialéctica sin resolución con la irracionalidad y caprichosa vileza que amparan empresas de esta índole. El penúltimo plano del film sobrevivirá en el recuerdo por años.
Roger Koza / Copyleft 2015
El Cinematógrafo: Olhar de cinema 2015: Homeland: Irak año cero, Koza, Battles

Homeland : Irak année zéro
AUX ORIGINES
Homeland : Irak année zéro est un documentaire irakien qui se concentre sur les origines de la guerre – de presque six heures les deux parties mises bout à bout. C’est cependant depuis une perspective très particulière et inattendue puisqu’il est le résultat de ce qui se présente d’abord comme un film de famille par Abbas Fahdel retraçant la fin du dictât de Saddam Hussein jusqu’au bombardement de Badgdad en mars 2003 par Georges W. Bush signant l’avènement de la seconde guerre du Golfe et sur laquelle s’achève la première partie intitulée « avant la chute ». La chute doit d’ailleurs ici être comprise aussi bien intimement que politiquement – l’intérêt de la démarche étant précisément dans cette corrélation- dans la mesure où elle détruit aussi bien des territoires sur lesquels vivait des nations et des familles que des êtres singuliers.
Le procédé tire d’ailleurs sa force de cet ancrage en politique par l’intime et en parvenant finalement à montrer que les deux sont inexorablement liés dans le vécu en introduisant le macrocosme par le microcosme. Ainsi, on voit à plusieurs reprises les enfants (notamment ce lumineux Haidar, le jeune neveu du réalisateur plein d’intelligence et de verve et qui participe beaucoup à la force de ce long documentaire – en le transformant en une tranche de vie à vif et des plus fascinantes- en tant qu’il incarne tragiquement et allégoriquement une jeunesse précaire mais néanmoins porteuse d’espérance dans cette urgence du présent) parler politique comme des adultes, dans une forme d’effervescence encore enfantine mais non moins lucide sur ce qui arrive : « le monde est en ébullition et on est au courant de rien » s’offusque Haidar du haut de ses douze ans alors qu’il se soucie de mettre des provisions d’eau et de nourriture de côté en vue de la guerre qu’il sait arriver et se plaint de devoir manquer les cours pour s’occuper du puits dans le jardin.
Au final, ce qui est surprenant par dessus tout, c’est cette envie de vivre malgré la fatalité de la guerre et cette volonté de dignité et d’honneur à tout prix, même « après la bataille » (le titre de la seconde partie), de ne pas baisser les bras face à l’adversité – qui n’est finalement pas présenté ici comme adversité politique mais bien comme celle du monde dans son essence fondamentalement agonistique qui prend d’abord corps dans le cœur des hommes avant de s’incarner sur les territoires dévastées d’un monde en fuite. En certains lieux, il se fait désert d’humanité et de sens mais depuis lequel un cri d’espoir ou de révolte – à la tonalité indistincte- peut encore et toujours surgir, même après la chute et ses désillusions. Ainsi, dans la seconde partie, même lorsque la maison d’une famille au toit en carton s’effondre sous les assauts de la pluie, comme une allégorie de la destruction radicale qui s’opère, les habitants continuent à tenir le siège et exiger réparation, entre déréliction et combativité malgré le décours attendu.
Le réalisateur, par une mise en abyme, montre ainsi que le cinéma de l’intime est pour lui une possibilité de crier pour se faire entendre dans un univers sclérosé, un moyen de faire reculer la fin d’un monde : le sien, le leur et le nôtre, par extension de la sphère privée à la sphère public, de l’intime au politique. Dans le livre X de la Poétique, Aristote affirme une supériorité de la poésie sur l’histoire dans la mesure où elle est capable d’anticiper l’avenir. Clairement,à la vision de ce documentaire, on pourrait en dire autant du cinéma et c’est finalement cette protention qui frappe en plein cœur avec les dernières images. En effet, inévitablement lorsqu’elles apparaissent, on pense à tout ce temps passé à filmer les ayant précéder pour montrer ce qui arrive, et en tant que spectateurs-témoins à contretemps, on se dit que cette réflexivité cinématographique était sans doute également, pour lui et ses proches, une manière de tenir le siège et de garder une maîtrise sur son destin en lui opposant le présent de la vie ; c’est-à-dire l’éternité.
https://imagemouvement.wordpress.com/2016/03/07/homeland-irak-annee-zero/
30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 2015 (14): HOMELAND: IRAQ YEAR ZERO: EL OTRO ES EL CINE
Por Roger Koza
¿Qué sabíamos de los iraquíes? Prácticamente nada. Lo último que habíamos visto sobre ellos era una película de un gran director estadounidense que los retrataba a la distancia y casi siempre por la mira de una sofisticada metralleta. Los iraquíes eran pura maldad o su correlativa inversión, personas dóciles, tal vez inocentes. Lo cierto es que en Francotiradorapenas tenían un rostro y la voz era inaudible. Por suerte existen películas extraordinarias como Homeland: Iraq Year Zero, de Abbas Fahdel, en la que todo lo que creíamos saber se cancela y la característica ignorancia occidental es conjurada por la gracia de una puesta en escena admirable y un punto de vista que no necesita injuriar al invasor pero sí entender las relaciones complejas que se establecen con él.
Fahdel arranca su country home movie filmando la cotidianidad de toda su familia, y en la medida en que lo hace va incorporando paulatinamente el barrio, la ciudad y las afueras de Bagdad. Sin darnos cuenta, en las primeras dos horas y media se aprende muchísimo sobre las costumbres y el orden doméstico, las formas de intercambio afectivo familiar y la cultura general de toda una región, que parece más secular que religiosa. El contexto histórico inicial es el previo a la invasión estadounidense, un poco antes de marzo de 2003, y no faltará algún comentario y una exposición precisa, incluyendo sus consecuencias, acerca de la Guerra del Golfo en 1991. La primera parte culmina ahí y el “guía turístico” es Haidar, el sobrino del director, a quien vemos crecer y cuyo vitalismo y curiosidad constituyen la ubicua dignidad de esta obra maestra de Fahdel.
La invasión quedará en fuera de campo, una elipsis conveniente, y toda la segunda parte se circunscribe a observar estructuralmente los efectos colaterales de la incursión de Bush hijo en esas tierras lejanas y supuestamente pletóricas de armas de destrucción masiva. Resulta revelador cómo desde la presencia estadounidense en adelante toda una forma de vida es arrasada mientras cunde la corrupción, la destrucción de la Historia y sus archivos (incluyendo un instituto de cine y todas sus películas) y la instauración de una especie de Lejano Oeste en el que todos los ciudadanos de un país se ven obligados a llevar armas por su seguridad.
En el desenlace, sucederá algo que sintetiza la abyección de las guerras y el absurdo de la racionalidad que pretende justificar estas empresas “civilizatorias” como un bien para la paz global; impugnación absoluta de un régimen, instante en que, como decía Serge Daney, la película nos mira de frente y por siempre.
Roger Koza / Copyleft 2015
CRITIKAT : ABBAS FAHDEL
|
Né en Irak, émigré en France à l’âge d’entrer à l’université et d’y recevoir les cours de Jean Rouch, Serge Daney et Éric Rohmer, Abbas Fahdel a vécu toute l’histoire contemporaine de son pays dans la douloureuse situation de l’exilé, faisant sa vie à Paris, ne revenant qu’irrégulièrement dans son pays d’origine, et souvent pour le filmer. Auteur coup sur coup de deux documentaires en forme de retour à Ithaque (Retour à Babylone, 2002 et Nous les Irakiens, 2004), il a accumulé durant l’invasion américaine de 2003 de nombreuses images quotidiennes, dans le cadre familial et dans l’effervescence des rues, enregistrant l’ordinaire d’un pays en temps de guerre, jusqu’à un funeste événement qui mit un terme à tout : le décès de son neveu Haidar, atteint par une balle perdue.
Rentré en France où il a, depuis, réalisé un long-métrage de fiction, Fahdel n’est que récemment revenu sur ces rushes que le deuil avait rendu intouchables. Le résultat est un suivi au long cours de la vie irakienne, qui fait le choix d’une longue durée (5h34), a déjà remporté deux prestigieux prix (le Sesterce d’or du festival Visions du réel à Nyon, et le prix Doc Alliance qui regroupe sept festivals documentaires) et dont une sortie est prévue dans les salles françaises en janvier prochain.
À Lussas où nous avons vu Homeland, Abbas Fahdel nous a accordé cet entretien qui déborde régulièrement du cinéma pour aborder plus directement les souvenirs du conflit. On ne saurait empêcher ce débordement tant tout va ensemble pour le cinéaste, qui reconnaît sans réserve un lien ombilical entre lui-même et le film, un film « comme il ne peut en faire qu’un seul puisqu’il n’a qu’une seule famille et qu’une seule vie ». Il faut beaucoup de pudeur pour s’interposer dans ce type de rapport fusionnel entre l’auteur et son œuvre, et décortiquer un processus de création qui s’appuie au moins en partie sur la blessure intime et le deuil. Mais Abbas Fahdel parle sans peine de ces points d’appui et c’est cette santé d’esprit qui rend sa conversation si agréable et vivace.
Homeland est resté dans les cartons pendant plus de dix ans. À la faveur de quoi êtes-vous revenus sur ces images ?
À l’occasion du dixième anniversaire de l’invasion américaine en 2013. Je savais que ces images existaient, mais pas ce qu’elles valaient. Je me doutais qu’elles avaient au moins un intérêt historique. En les regardant, le film a pris forme. La question était : est-ce que j’ai le droit de le faire ? Ma famille n’est pas américaine ou française, c’est une famille irakienne, dont le rapport à l’image est différent du nôtre. À l’époque, j’étais simplement un oncle, un frère, en train d’enregistrer un film de famille. Aujourd’hui, accepteraient-ils d’être montrés ainsi ? La situation politique fait qu’il y a désormais une interprétation politique paranoïaque des choses. Si un écrivain publie un roman dont le méchant s’appelle Abbas – prénom connoté chiite –, les gens penseront que c’est un roman contre les chiites, a fortiori si l’écrivain est sunnite, chrétien ou kurde. Les frontières entre les confessions sont telles qu’il ne faut rien prendre à la légère : qu’est-ce que ce film peut causer à ma famille en bien ou en mal ? Finalement mes proches m’ont autorisé à le faire, même si eux ne pourraient pas le voir à cause de Haidar.
Vous avez assisté à la projection en entier. Est-ce difficile de se détacher de ces images ?
C’est la deuxième fois que je le regarde. Il y a d’abord une raison toute bête : comme je n’ai pas les moyens et que je produis le film moi-même, je n’ai pas commandé le DCP à une grosse boîte, c’est quelqu’un qui l’a fait chez lui, et je voulais voir le résultat, repérer quelques défauts, d’éventuelles fautes dans les sous-titres. Mais dès que je le revois, l’émotion déferle. J’oublie la technique. Et c’est intéressant de voir la réaction des gens, notamment des rires, hier, auxquels je ne m’étais pas du tout préparé.
Vous parvenez à parler du film comme d’un objet, d’évoquer l’idée d’un « documentaire qui tire vers la fiction ». Vu la façon dont les événements vous concernent personnellement, comment se passe une telle déréalisation ?
C’est un transfert qui s’est fait progressivement, car j’ai passé un an et demi sur le montage, et le montage est avant tout un travail technique, rébarbatif même, sans parler du mixage et de l’étalonnage. Or cela m’a aidé, en fait. Me poser des questions de forme et de technique a été assez salutaire pour finir le film. Si j’étais resté dans l’émotion, je n’aurais pas pu le finir, j’aurais sans doute même abandonné dès le premier jour.
Pendant le tournage, quel résultat final imaginiez-vous ?
L’idée de départ était la suivante : la guerre va avoir lieu, c’est une certitude, il faut la filmer dans l’intimité d’une famille, et inévitablement de la mienne car c’est la seule que je peux filmer. Il fallait que le spectateur ait l’impression de vivre avec cette famille, que les « acteurs » ne prennent pas attention à la caméra. Même avec des amis, ou des cousins, je n’aurais pas pu mettre en place ce principe. Je n’imaginais rien de plus car j’ignorais quelle serait la tournure des événements.
Il y a un sentiment d’intimité qui se prolonge jusqu’aux gens que vous ne connaissez pas, aux Irakiens rencontrés dans les rues.
Pour une raison que j’ignore, peut-être une question de tempérament, ou d’éducation, j’inspire souvent la confiance aux gens, notamment aux enfants. C’est pratique pour un documentariste. Les Irakiens sont très nerveux. C’est normal, il faut s’imaginer ce que c’est de se retrouver dans des embouteillages infernaux, ayant à peine dormi à cause de la chaleur, manquer d’eau, faire la queue pendant une heure pour avoir de l’essence… Il y a beaucoup de tension. Moi, je suis d’un naturel nerveux en France, mais très détendu là-bas, et j’ai tendance à calmer les gens. J’ai beaucoup de sympathie pour eux, parce que je les ai connus avant la guerre. C’est le peuple le plus hospitalier du monde. Ma sœur, par exemple. Elle voit depuis sa terrasse un soldat dormir sur une place. Elle envoie Haidar lui demander ce qu’il fait là. Le soldat lui explique qu’il est de Bassora, au sud du pays, mais qu’il n’a pas d’argent pour rentrer chez lui – Saddam ne prenait pas soin de ses soldats, c’est pour ça qu’ils n’ont pas combattu pour lui. Ma sœur invite le soldat chez elle, le nourrit et lui donne de l’argent pour qu’il puisse rentrer chez lui. Ça, c’est un comportement normal en Irak. Il n’y a pas de sans-abris dans le pays. Maintenant, peut-être, mais à l’époque non. Je suis naturellement porté vers eux.
Que filme-t-on quand on filme un monde approchant de sa disparition ?
On filme tout, en fait. Mais par-dessus tout on filme des choses en apparence anodines. Lors du débat, hier, j’ai cité Yasujiro Ozu. Chez Ozu, il n’y a rien de spectaculaire, ce sont des histoires de famille. Mais ce qu’on y voit nous instruit infiniment sur le Japon, peut-être plus que Kurosawa, même si je l’aime beaucoup aussi. J’ai l’impression de connaître le Japon grâce à Ozu. Il m’introduit dans une famille : les chaussures rangées à l’entrée, la bouilloire de thé. J’aime Hou Hsiao-hsien pour des raisons similaires. Mon irakianité est plutôt asiatique…
Le film s’ouvre justement sur une scène de préparation de repas dont vous détaillez minutieusement les gestes.
Oui, je voulais commencer par cela. Une famille qui se réveille, qui allume la télévision où passe un discours de Saddam, fait la cuisine, quelques tâches ménagères. C’est un moment simple, mais je suis content de voir qu’il est très apprécié. Mon film est long et on me dit parfois d’y enlever ceci ou cela, mais cette scène d’introduction, personne ne m’a suggéré d’y toucher : elle nous montre ce qu’est un foyer, quelle en est la routine. Elle est très importante.
La partie dans les souks, notamment, semble là pour documenter une vie irakienne approchant de son terme d’une façon presque ethnographique : artisans, pratiques culturelles, etc.
Oui, et cela va jusqu’aux différentes techniques de préparation du pain… Le souk est un lieu d’échange et je voulais faire un film qui témoigne de l’Irak en détaillant notamment la façon dont différents « types » cohabitent. Les Irakiens sont très différents et savent immédiatement se reconnaître entre eux : celui-ci est kurde, celui-ci est yézidi, etc. Ce sont les vêtements qui permettent ces distinctions (qui s’habille à l’occidentale, etc.) ainsi que la couleur de peau parfois. Il fallait rendre de compte de cette variété.
Le sous-titre, Irak année zéro, c’est bien sûr Rossellini. Faites-vous un lien entre votre travail en Irak et celui de Rossellini à Berlin ?
Je fais effectivement un lien, qui m’est venu à l’esprit pendant le montage et a inspiré ce sous-titre, et mélange certainement plusieurs choses que vous devinez, autour de la figure d’un enfant, qui circule dans le pays en ruine… Mais la grande différence, je crois, c’est que Rossellini était un étranger là où il filmaitAllemagne année zéro. Il est italien et a vu à Berlin quelque chose de très noir, de très pessimiste. En ce qui me concerne, j’ai malgré tout vu la résilience d’un peuple, sans doute parce que c’était le mien, et peu à peu je me suis mis à me concentrer sur cette faculté des Irakiens à aller à l’école, au travail, à l’université, sans se décourager, car elle m’impressionne énormément.
Ce que vous construisez notamment avec Haidar, le choix d’en faire un compagnon de tournage, de l’emmener avec vous filmer dans les rues : qu’est-ce qui a motivé ce parti pris ?
Cela s’est fait naturellement. Je ne l’ai pas connu à sa naissance : je l’ai découvert en même temps que le début du tournage. Pour lui, j’étais une sorte d’oncle d’Amérique. J’ai bouleversé son quotidien, Les enfants ne peuvent pas sortir sans être accompagnés, et le père travaille : moi je l’emmenais avec moi. Je me suis énormément attaché à lui. Il s’est accaparé le personnage, le film, et je l’ai laissé faire. En regardant les images, je pleurais tout le temps… Mais en même temps je trouvais cet enfant tellement formidable que je voulais que les gens le voient. C’est une manière de le ressusciter.
Petit à petit, on a le sentiment que sa présence est indispensable, parce qu’il est pris à témoin.
Les réactions des enfants dans un contexte de guerre m’intéressent beaucoup. Il y a une scène qui vient directement de Rossellini, la seule fois où j’ai pensé à lui directement au moment du tournage. Mais ce n’est pas Allemagne année zéro : ce sont les enfants qui interpellent de loin un soldat posté sur un tank devant le Musée national. Ils essayent de lui parler en anglais, lui demandent du chocolat, du poisson, mais comme un jeu, pour s’amuser, et il se noue entre eux quelque chose de complice, même dans la distance ; l’un et l’autre ont l’air d’oublier leur différence, ou alors de faire semblant de le faire. J’ai eu à ce moment une pensée pour le segment napolitain de Païsa, avec le soldat noir et le petit garçon italien.
Les soldats américains restent très étrangers au film.
Oui, car je me suis mis dans la position des Irakiens, et je voulais que mes rapports avec eux soient ceux d’un Irakien, avec donc des contacts limités. Je n’éprouvais ni empathie, ni antipathie, mais les interroger, ç’aurait été un autre film. Il y a des scènes de fraternisation, comme au moment de la graduation des étudiants, qui fêtent leur diplôme et se prennent en photo avec les soldats. Pourquoi ? Parce que ce ne sont plus des soldats, ce sont des jeunes. Il y a même une connotation sexuelle, une étudiante dit : « une photo avec toi, mon mignon »… Mais au fil du temps, la situation s’est aggravée. Il y a eu des bavures, des incidents. J’évoque dans le film la mise à mort sans sommation d’un jeune garçon qui portait une batterie de voiture que les soldats ont pris pour une bombe. Les Américains se sont fait détester. La situation aurait été totalement différente s’ils avaient agi comme ils ont agi à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, sans se comporter en ennemi. Ils ont dissous l’ancienne armée irakienne et envoyé un million d’hommes au chômage, dans un pays où il n’y avait plus de travail. Une partie de ces anciens soldats sont devenus des résistants, des pillards. Aujourd’hui ils ont rejoint Daech.
Je ne les ai rencontrés qu’une seule fois. J’avais pris la « route de la mort », qui traverse le désert depuis Amman en Jordanie jusqu’à Bagdad. Les journalistes et les politiciens ne s’y engageaient que dans des convois protégés par l’armée, à cause des pillards qui prenaient d’assaut les véhicules pour tuer et voler. Pour les autres, dont moi, il y avait des taxis, des voitures rapides et puissantes au cas où il faudrait semer des assaillants, mais c’était très cher et très risqué. Nous avons passé la frontière jordano-irakienne : « vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir », me suis-je dit. Tout à coup, nous avons vu une voiture arriver à contresens. Nous nous sommes rangés sur le côté : le temps de faire demi-tour, nous n’aurions pas pu leur échapper. La voiture n’a pas ralenti mais son conducteur a simplement crié, en passant à notre niveau : « pillards ! » Elle était elle-même en fuite. Nous avons alors quitté la voie rapide pour nous cacher, et emprunté une voie de terre à travers le désert. Nous avons pris le chemin de Hit, plus proche que Bagdad. À l’entrée de la ville, un barrage américain nous arrête et fouille la voiture. Le trépied de la caméra était dans un sac noir allongé, ils ont pris peur. J’avais les mains sur la tête quand ils ont ouvert la sacoche et découvert la caméra, rassurés. Nous avons passé un moment à discuter ensemble… C’étaient des adolescents.
Vous filmez un éternel recommencement, une présence perpétuelle de la guerre, à travers des gestes qui se répètent d’un conflit à l’autre. Avez-vous accordé une attention particulière à ces gestes ?
Oui, et à leur banalité aussi. Mes nièces disent même « la guerre sans nom ». Il y a eu tellement de guerres qu’elles n’en connaissent plus les noms. La différence qu’il y a dans nos connaissances respectives du conflit est frappante : je leur apprends souvent les dates de bombardements qui les concernent pourtant plus que moi. C’est que je me suis documenté, pour moi, pour le film. Elles ? Elles n’ont pas besoin de se documenter. Elles n’ont pas besoin de savoir exactement quel jour elles ont été bombardées.
Quand vous avez évoqué l’éventualité de futurs films, après la séance, j’ai eu l’impression qu’elle était pour vous très incertaine. Est-ce parce que Homeland serait certainement pour vous le dernier ? Avez-vous d’autres projets ?
En réalité j’ai des projets, des films de fiction. L’histoire d’une journaliste française qui se fait accompagner en Irak par un guide avant de se faire prendre en otage. Libérée, rentrée en France, elle décide de repartir pour retrouver son guide. J’ai beaucoup en tête la figure de la journaliste Anne Nivat, qui est une amie, et qui a la particularité de travailler sur des enquêtes au très long cours auprès de la population locale, s’habillant comme une femme du pays et logeant chez l’habitant. L’histoire de Florence Aubenas, aussi, a bien sûr à voir avec le projet même si elle a voulu garder le secret sur la façon dont s’est déroulée sa captivité, ce que je respecte. Il n’y a pas d’argent en Irak donc je ne pourrai pas le faire là-bas : je dois le faire en France, et donc avec au moins la moitié des dialogues en français si je souhaite obtenir l’avance sur recettes. J’ignore si le film se fera. Homeland pourrait effectivement être le dernier. Que faire après ça ? En tout cas je suis certain que je ne ferai rien d’aussi important. C’est un film comme je ne peux en faire qu’un seul, parce que je n’ai qu’une seule famille, une seule vie. Il y a eu un moment historique, j’ai pris le temps, le risque, de le filmer. Rien ne pourrait être équivalent.
CRITIKAT
27es États généraux du film documentaire de Lussas
On ne sait trop que faire de la façon dont Homeland (lire notre interview) s’est imposé comme la pièce maîtresse de ces États généraux, tant il est clair que même si cela a bien sûr à voir avec sa qualité, cela n’est pas non plus étranger à son format (5h34 divisées en deux parties), à sa matière documentaire (un témoignage quasi unique de la vie en Irak avant et après l’invasion américaine), et surtout à la déférence que le film inspire. Déférence devant la valeur d’archive des images – Abbas Fahdel dira que bien avant de se convaincre que ses rushes renfermaient un film, il savait qu’ils renfermaient au moins une part d’Histoire –, déférence surtout devant la mise à nu, puisque le film s’attache à décrire tout à la fois la violence absurde de la guerre et l’environnement familial du cinéaste, jusqu’à ce que ces deux finissent inexorablement par se rejoindre.
On parle donc de Homeland comme d’un film aux conditions d’existence très singulièrement intimes, un film tout juste tombé du deuil et qui brûle les doigts. Le sous-titre, Irak année zéro, plus qu’un clin d’œil, nous semble indiquer que Fahdel fait le même pari que Rossellini : pour filmer la guerre (et plus exactement pour filmer l’après-guerre), il filme un enfant. L’enfant est à la fois le témoin, le martyr et l’héritier de la guerre ; c’est le sens à peine voilé de la complicité que noue Fahdel avec son neveu Haidar, qui s’invite devant la caméra d’abord par jeu, puis qui nouera au fil du temps un véritable compagnonnage avec son oncle qui sortira du cadre familial, sillonnant avec lui les rues du pays pour recueillir les histoires des Irakiens. C’est ensemble qu’ils déploient peu à peu ce très ample projet de recensement de l’Irak occupé.
Recueillir, recenser, c’est le geste essentiel de Fahdel qui filme parce qu’il sait d’avance que tout va disparaître. Homeland décrit donc une multitude de détails de la vie irakienne, ouvrant une à une des parenthèses qui s’apparentent à des films dans le film : il visite les souks boutique après boutique, détaillant jusqu’aux techniques de préparation du pain, mais aussi les vêtements, les rites sociaux (le repas, un mariage…) ; il s’embarque avec un acteur de théâtre dans une longue visite des archives du cinéma irakien, détruites par des pillards, où le vieux thème de la « mort du cinéma » se concrétise de façon déchirante. Une telle efflorescence brouille la frontière entre le sujet et le hors-sujet ; on pourrait peut-être enlever ceci ou cela, la longueur de l’ensemble implique nécessairement de passer par des phases de décrochage, orHomeland ne tourne jamais à perte, et chaque scène ajoute autant de durée que de substance à ce projet avec lequel la négociation au détail n’est bien sûr pas possible.
Locarno: Iraqi-French director Abbas Fahdel’s ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ Scoops Doc Alliance Selection Award

Fahdel’s monumental more than 5-hour-long work is composed of two parts. The first shot before the U.S. army’s arrival in Iraq, while the second captures post-war events. Besides the nod’s important recognition, he received Euros 5,000 in cash.
“The norms and values in my country have been turned upside down,” said Fahdel, who is currently living in French exile, describing his feelings about his homeland.
“What would have become of me, if I had stayed in Iraq? These were the questions I asked myself, with a bit of frantic and insatiable curiosity.”
Fahdel’s “Homeland” first emerged on the fest circuit when it won the international competition at the Swiss Visions du Reel fest.
The Doc Alliance Award is given by an alliance of the following seven docuy film festivals: CPH:DOX, Docs Against Gravity FF, Doclisboa, DOK Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF and Visions du Reel.
Télérama
“Homeland”, Sesterce d’or au festival Visions du réel
En attribuant le Sesterce d’or du meilleur long métrage à Homeland (Irak année zéro), d’Abbas Fahdel, le jury du 46e festival Visions du réel, qui s’est déroulé à Nyon, en Suisse, du 17 au 25 avril, a choisi de distinguer l’œuvre d’un homme seul et celle d’une vie. « La chose la plus importante que j’aie pu faire et ferai jamais », assure le cinéaste franco-irakien, auteur de L’Aube du monde en 2009, qui aura mis plus de dix ans à mener à terme ce projet dont il a assuré la production, la réalisation, la prise de vues, la prise de son et le montage. Une chronique familiale bagdadienne, à la veille et au lendemain de l’invasion américaine de 2003.
« Quand s’est précisée la menace d’une guerre, j’ai compris que l’Irak de ma jeunesse, celui que j’avais quitté pour venir étudier le cinéma à Paris, que cet Irak-là était en passe de disparaître. J’ai décidé d’y retourner avec une caméra, de filmer toutes les petites choses du quotidien pour les sauver de l’anéantissement. Pour rejoindre les miens aussi, et peut-être mourir avec eux. Comme le dit l’un des protagonistes du film : à quoi bon rester en vie, si tout le reste de notre famille mourrait ? Peut-être me sentais-je aussi coupable d’être parti. Et puis, j’étais également animé par une sorte de superstition : tant que je les filmais, rien ne pouvait leur arriver. Cela s’est d’ailleurs confirmé. Un mois après que j’ai eu arrêté de tourner, mon neveu Haidar, très présent dans le film, a été assassiné. Quelques mois plus tard, deux de ses cousins ont été tués à leur tour… »
Si la démarche d’Abbas Fahdel s’apparente à celle du film de famille jusque dans son souci d’arracher au temps qui passe quelques bribes de vie, le poids de l’Histoire insuffle au film, également distingué par une mention spéciale du jury interreligieux, une force toute particulière, et lui confère la valeur d’un précieux document. Quant à la proximité qu’il instaure entre le spectateur et les siens, à travers une grande diversité de scènes, elle rend d’autant plus sensible la réalité humaine du peuple irakien, qu’on n’avait sans doute jamais vue d’aussi près. Et pour cause : « Sous Saddam, aucun Irakien ne filmait sa famille. Personne n’avait de caméra, Internet n’existait pas – même les photocopieuses étaient interdites. Lorsque j’ai fait entrer mon matériel en prétextant tourner de simples images familiales, on m’a rappelé qu’il me faudrait, avant de partir, les soumettre au Bureau de la censure de l’Office du cinéma. J’ai donc spécialement tourné des images inoffensives. Quant à celles qui ne l’étaient pas, j’ai dû ruser pour les faire sortir. »
Il faut avoir une idée de la paranoïa à l’œuvre dans le régime de Saddam Hussein pour saisir la dimension subversive de certaines scènes de Homeland. « Si l’on vous entendait dire “le Président Saddam” plutôt que “le Président camarade leader Saddam et Dieu le garde”, vous pouviez être emprisonné. Quand, à la fin d’un de ses discours télévisés, mon beau-frère dit en rigolant : “Changez de chaîne !”, il est conscient du fait que cette phrase peut coûter la vie à toute la famille. Pareil, quand mon neveu craque une allumette et chante “Joyeux anniversaire, Saddam !”, moquerie pareillement passible de la peine de mort.»
Pour déjouer les soupçons lorsqu’il tournait à l’extérieur de la maison, Abbas Fahdel s’est adjoint les services d’un ami, acteur dont il compare la popularité à celle de Gérard Depardieu chez nous. « En le voyant devant ma caméra, tout le monde pensait que je tournais pour la télévision officielle, et je n’avais aucun problème. ».
Des quatre périodes de tournage organisées avant et après la chute du régime, il a rapporté 120 heures de rushes, qu’il a montées dix ans plus tard. « La mort de plusieurs membres de ma famille et de proches m’a rendu impossible de regarder ces images. Il m’a fallu passer par une période de deuil pour être capable d’y revenir. Le dixième anniversaire de l’invasion américaine a été le déclic. J’ai téléphoné à ma sœur, qui m’a dit : “Si tu veux faire ton film, fais-le. Mais on ne le regardera pas.” Voir Haidar, son fils cadet, bouillant de vie, lui est toujours impossible. »
Sans autre source de financement que ses propres économies, Abbas Fahdel a dû apprendre les techniques de post-production pour terminer ce film fort, qu’une durée exceptionnelle (cinq heures et demie) pourrait priver de la diffusion qu’il mérite. Qu’on propose à son auteur d’en monter une version raccourcie pour toucher le public de la télévision, il y réfléchira. Pour l’heure, c’est une juste récompense qui couronne un travail porté par le courage, l’endurance et le cœur.
When Film Is a Festival
By Jeffrey Ruoff, film historian and professor of Film and Media Studies:
“If you’re interested in seeing how people live in other countries, turn off CNN and Fox News, and head down to your local film festival. If you’re lucky, you’ll catch Abbas Fahdel‘s 2015 documentary Homeland : Iraq Year Zero, a five-and-a-half hour exploration of his family’s day-to-day life in Baghdad before and after the 2003 U.S. invasion, a vanished world heartbreakingly preserved on digital video. Homeland will have its North American premiere at the upcoming 2015 New York Film Festival, another jewel in the festival galaxy.”
When Film Is a Festival _ Jeffrey Ruoff
CachoeiraDoc
Terra Natal: Iraque Ano Zero
É das coisas mais incríveis e potentes a experiência de assistir a Terra Natal: Iraque Ano Zero na sala de cinema, sessão mais que especial programada no CachoeiraDoc. É um filme de cinco horas e meia que nos coloca no epicentro da vida no Iraque, divididoem dois momentos: antes e depois da invasão bélica americana no país.
Mas Abbas Fahdel não só abre as portas da realidade do seu país, captada pelo seu olhar, como nos apresenta esse microcosmo a partir da sua própria casa e família, acompanhando a vida dos que lhe estão perto. Talvez por essa proximidade o cineasta tenha demorado tanto para nos apresentar esse filme pronto, bem distante do ano de 2003 quando fez as últimas imagens, logo após a invasão americana.
Há a dimensão volumosa do próprio material filmado, mas também a dimensão emocional, certamente um abalo forte para o cineasta e um ato de coragem por em cena a tragédia que é ter sua vida atravessada pela guerra, algo que bate no público de uma forma muito intensa, mas em outra medida, é claro.
A primeira parte do filme é um riquíssimo panorama da vida cotidiana em Bagdá. Evolui da rotina familiar do cineasta, os pequenos afazeres e encontros dentro de casa, e depois ganha as ruas, o rosto do povo, seu trabalho, sua inscrição numa paisagem que não será a mesma. O filme também cresce em tensão a partir de uma invasão que se torna iminente e ganha aos poucos o conhecimento do povo. Para os não iraquianos é também um momento de aproximação com cultura e costumes tão diversos e filtrados por olhares exóticos, turísticos e limitadores que encontramos em muitos discursos por aí – e isso é inerente a qualquer país ou cultura.
É muito forte ver essas imagens nos dias de hoje quando já sabemos o que espera aquele país, a barbárie que virá. Há desde imagens na televisão de Saddam Hussein afirmando estar pronto para a batalha e certo da vitória, até garotas brincando e rindo colocando fraldas na cara como uma possível solução em caso de explosões de bombas de gás.
A montagem exemplar dessa parte do filme avança da vida comum àquela que começa a sondar a possibilidade de guerra, muitas vezes desacreditada, até tornar-se um assunto de preocupação geral e então emana como algo palpável. É como se soubéssemos desde sempre aonde tudo isso chega, mas sem querer encará-lo – e talvez a duração alongada seja um alívio momentâneo nesse sentido. Há também a presença do sobrinho de Fahdel, o garoto Haidar, mas falarei dele posteriormente.
A segunda parte do filme nos coloca numa perspectiva dupla: mostra a destruição que já esperamos ver, mas também surpreende um tanto. Isso porque a vida segue em Bagdá, a cidade resiste, as pessoas continuam a trabalhar, frequentar a universidade, sair nas ruas. Claro que tudo isso acontece na medida do possível, daquilo que restou de pé, da vontade que ainda emana de alguns. A cidade não foi dizimada, mas a dor é constante. Os que ficaram e sobreviveram lidam com a perda e o sentimento de ausência constante.
Daí que uma das maiores forças de Terra Natal é nunca filmar a barbárie em si – na verdade os conflitos bélicos mais intensos já acabaram e os americanos já dominam o país. O diretor não mostra o caos, mas o caos está lá, presentificado a todo instante, aonde quer que ele vá, pelas histórias das pessoas na rua, pelos escombros e os restos do que sobrou e resistiu ao fogo, pelas perdas e dores dos quais o filme não deixa de revelar.
Terra Natal não está preocupado em soar piegas e urgente, denuncista e choroso, porque seu tempo é outro, de mais maturação e penetração numa realidade difícil de mensurar e adentrar quando não se passou por aquela situação – talvez deslize no espetaculoso quando explora as cicatrizes de uma criança encontrada na rua. Mas ao mesmo tempo o filme não deixa de comover por aquilo que aquelas imagens representam e evocam, pela força que elas encerram. Um dos momentos mais dolorosos, pela sua significação, é quando o diretor visita um antigo estúdio de cinema e se depara com uma série de rolos fílmicos queimados, destruídos, irrecuperáveis; as imagens feitas por um povo, registro de sua cultura e de um tempo, fagulha de vida e criação, destroçados pela guerra. É triste ver o cinema documentar a morte do cinema. Porém, as memórias e as marcas do homem não são mais importantes do que os próprios homens, forçados a viver nesse contexto de dor e ausência.
E então chegamos a Haidar, o sobrinho de Fahdel, que atravessa toda a narrativa do filme e marca presença como personagem que cresce cada vez mais como homem político, testemunha obrigado a ressignificar as novas imagens e situações que lhe são confrontadas, que lhe atravessam a vida de forma cruel. Numa decisão duríssima, tão sincera e dolorosa por parte do diretor, o filme prenuncia, lá na metade do primeiro segmento, o destino trágico que o garoto vai encontrar, colocando o espectador num estado de inquietação maior.
Esse movimento representa a essência de uma história que a todo instante trabalha com as imagens e percepções que já trazemos de antemão, mesmo que elas não deixem de nos surpreender em muitos momentos, prefigurada na História, mas intensificada pelo trabalho insistente de Fahdel. É como a apuração de um olhar carregado de dor e determinação.
Haidar visita um lugar bombardeado onde pessoas morreram, então transformado numa espécie de galeria a ser visitada e lembrada como lugar de horror. Ele aponta para fotos de corpos mortos de crianças que ali estavam, e a cena dói como prenúncio fatídico de um futuro interrompido para Haidar. É o prenúncio do horror que temos de olhar, não acreditar, torcer para ser diferente, mas no fim enfrentar, de alguma maneira, com toda sua crueza. É no mínimo uma experiência emocional devastadora.
Por Rafael Carvalho
Iraque Ano Zero: Como destruir um país
O filme mostra as consequências dessa invasão americana no dia-a-dia. Foi o silêncio mais denso que experimentei na vida ao sair de uma sala de cinema.
A penúltima imagem seguida da noite da tela negra e de um tiro seco, no filme do monumental documentário de quase seis horas (dividido em duas partes), Terra Natal/Iraque ano Zero: Antes da Queda e Depois da Batalha, do cineasta franco-iraquiano Abbas Fahdel, é um soco no rosto do espectador. Tão violenta a situação filmada, que o diretor, depois daquele instante trágico, durante dez anos não conseguiu tocar no material com o qual filmou a sua própria família, em Bagdá, a partir de fevereiro de 2000.

Agora, depois de recusado por exibidores e produtores europeus pela sua duração fora dos padrões comerciais, o filme de Fahdel inicia, enfim, um circuito de apresentações em festivais. Em Tribeca, em Nyon, na Suiça, Locarno e em três sessões, na Mostra Fronteiras, no Festival do Rio, este mês. Homeland está sendo mostrado também no New York Film Festival. Na primavera de 2016 estreia na França com distribuição da produtora árabe Nour.
No Festival de Tribeca foi recebido como “documentário fundamental para se compreender o Oriente Médio do passado e do presente.%u20B Não é preciso mostrar uma vez mais o que a gigantesca máquina de guerra norte-americana é capaz de fazer. Para isso existe o jornalismo, as séries de televisão e os filmes de Brian de Palma, Kathryn Bigelow e Clint Eastwood que parecem frívolos diante de Terra Natal,” escreveu o crítico Victor Guimarães, durante o Festival de Nyon.
Sem narração em off nem comentários de qualquer espécie, até para preservar a segurança familiar, a primeira parte, Antes da Queda, antecede a invasão americana. Foi realizada durante a censura feroz da ditadura de Saddam Hussein. As imagens dessas crônicas familiares de Fahdel têm uma força tal que levam o espectador a acompanhar, escorregando para ela até desapercebido, a vida cotidiana sem maquilagem e quase nada conhecida, de uma família – a do diretor – de classe média, da capital do Iraque, culta, educada, bem posta, de intelectuais, profissionais liberais, moças e rapazes estudantes universitários, originada da cidade de Hit, cerca de 150 quilômetros de Bagdá, à beira do Eufrates – ocupada atualmente pelo exército do Estado Islâmico.
Abbas Fahdel aposta na alegria de viver, nessa primeira parte, apesar da vida difícil, e rejeita o sentimentalismo. Não há uma nota musical na trilha sonora que seja externa à cena. Tudo é aparentemente tranquilizador na confortável casa com chão forrado de tapetes. As mulheres trabalham na cozinha, o fogareiro no meio da sala aquece, a televisão ligada (e censurada) nos seguidos discursos ridículos de Saddam. O terraço árabe, o pomar do vizinho, a sombra das macieiras, a placidez. Mas os takes insistentes no relógio de mesa parecem lembrar que o tempo está se esgotando para mais uma guerra começar, depois das guerras do Irã e do Golfo – é fevereiro de 2002.
Um dos sobrinhos de Fahdel assume o protagonismo. Menino de 12 anos, carismático, perspicaz e inteligente, amadurecido antes do tempo, Haydar será um fio condutor, no filme, de várias situações apresentadas: na feira, no mercado, no sebo de livros antigos, nas férias com os colegas em Hit. A nova guerra que está por vir não assusta. ”Guerra é o nosso destino,” diz um professor cujo parco salário de 15 dólares em escolas na capital o faz retornar para trabalhar na propriedade da família, em Hit.
Lá, galos cantam nos jardins e os meninos brincam no Tigre. Judeus convertidos ao islamismo na década dos anos 80 são entrevistados. Outros, comunistas declarados, também. “A vida era melhor antes do petróleo”, diz um. “O embargo (N.R. econômico) já uma guerra,” diz outro, comentando a falta de medicamentos, o racionamento de alimentos e os estoques de pão e cestas básicas distribuídas pelo governo que começam a serem providenciados (mais uma vez) pelas famílias.
Um comunista, na segunda parte, lembra: Saddam converteu o povo iraquiano em uma multidão de esquizofrênicos. A censura fazia com que a pessoa fosse uma no trabalho e outra em casa; uma pessoa por fora e outra por dentro, diz ele.
Antes da queda, no entanto, as crianças falam, com naturalidade, sobre guerras, bombas e mísseis.
Em Depois da Batalha (que não houve) da capital e da invasão americana não há mais, é claro, militantes do partido Baath, nos bairros, percorrendo regularmente as residências para fiscalizar o retrato de Sadam pendurado na sala. As ruínas estão por toda parte. Vê-se prédios públicos incendiados depois de bombardeados; um deles, os estúdios do antes avançado cinema iraquiano, com todos os seus arquivos. “Pode-se vingar de um regime político, mas não de uma cultura; e transformar a memória de um povo em pó,” diz, desolado, um parente de Abbas.
Os americanos chegaram, e o filme mostra as consequências dessa invasão no dia-a-dia dos personagens. A poderosa crônica do cotidiano do Iraque mostra a tragédia do povo e ganha momentos mais intensos.
Um grupo de garotos mostra um companheiro com as pernas atrofiadas, que seria alvo do deboche de soldados americanos. O irmão do cineasta explica que a guerra criou um exército de saqueadores, sempre dispostos a agir no imenso caos da violência cotidiana da cidade dos ladrões e da dilapidação sem trégua. Todos devem se armar e guardar munição em casa para tentar garantir a segurança familiar. Não há polícia nem ao menos guardas para ordenar o salve-se quem puder do trânsito. As moças não saem de casa, sozinhas, porque correm o risco permanente de estupro. Se tudo mudou é apenas para continuar igual. A ameaça que antes se dirigia aos adversários do governo anterior, baathista, persiste agora sobre os acusados (muitos, injustamente) de terem pertencido ao partido de Saddam, e estão condenados ao desemprego permanente e ao desespero.
Um homem muito pobre, revoltado, recolhendo lixo em uma carreta, se pergunta por que os soldados sempre apontam suas armas, gratuitamente, contra ele. E se antes eram as valas comuns da ditadura, depois da invasão, é a bala que mata um jovem carregando a peça sobressalente de um automóvel para ajudar o vizinho. Um crime que nunca será investigado porque não há ninguém para investigar.
“Um documentário meu, Back to Babylon, foi exibido em um canal de TV francês. Uma indagação perturbadora, no artigo publicado em jornal, sobre o filme, me deixou abalado,” diz Abbas Fahdel. ”Seremos os últimos a ver aquelas pessoas vivas?” perguntava o autor do texto. A pergunta me chocou. A idéia de que os membros da minha família, meus amigos e as pessoas desconhecidas que eu filmei poderiam não sobreviver à próxima guerra era quase insuportável para mim. Sob a pressão de certa superstição não admitida, decidi voltar ao Iraque e continuar a filmar a parte dois. Fui levado pela esperança, também supersticiosa, de que poderia salvá-los do perigo iminente. Infelizmente, a espiral de violência que tomou o país, em breve mergulharia a minha família no luto.”
O sobrinho de Fahdel, o menino Haydar, de 12 anos, foi alvejado e morto por uma bala perdida, dentro do carro que atravessava uma avenida de Bagdá. Em sua companhia estavam o tio e o próprio Fahdel com a sua câmera na mão. Terra natal/Depois da Batalha termina com o grito de Haydar. Em seguida, a tela negra.
“Foi o silêncio mais denso que experimentei na vida ao sair de uma sala de cinema,” escreveu um crítico suíço. Mesma sensação nós experimentamos, deixando o cinema do Instituto Moreira Salles, na Gávea, no Rio de Janeiro.
(Abbas Fahdel é autor dos docs Back to Babylon e We Iraquis. Nasceu na região da antiga Babilônia e vive na França desde os 18 anos. Estudou cinema em Paris com Jean Rouch e mora na cidade com a mulher e a filha. Com o seu passaporte europeu conseguiu entrar e sair do Iraque com o material filmado de Homeland/Iraq Year Zero – e com a ajuda de amigos da capital iraquiana e de um diplomata francês. Atualmente filma Bagdah.)
*Jornalista.
Revista Desistfilm
Terra natal : Iraque ano zero
Medir a resiliência de um povo
Texto de Victor Guimarães, publicado originalmente (em espanhol) na cobertura do IV Festival Olhar de Cinema para a revista Desistfilm.
É extremamente difícil se referir a Homeland como um filme. Nomeá-lo assim é afirmar que essa existência pertenceria à mesma espécie ou categoria ontológica de um Jurassic World ou um filme como Soft in the Head de Nathan Silver (visto aqui no Olhar de Cinema). Certamente não é o caso. A obra monumental de Abbas Fahdel – e a experiência absolutamente inesquecível que é estar na frente da tela por pouco mais de cinco horas e meia – pertence a um conjunto muito limitado e preciso de obras da humanidade, entre as quais eu citaria Os Desastres da Guerra de Goya, Guernica de Picasso, Noite e Neblina de Resnais e A Oeste dos Trilhos de Wang Bing. O que une estas materialidades tão distintas não é apenas o dado de que sejam obras-primas ou até mesmo o fato de que todas tenham levado anos para se completar. Isso também conta, mas o que realmente conecta essas obras é o fato de que todas são figurações tão potentes, formalmente íntegras e irrepetíveis da aniquilação do homem pelo homem, que não é possível olhar para uma pintura, um filme ou um homem da mesma maneira depois de entrar em contato com elas.
Homeland é dividido em duas partes: antes e depois da invasão do Iraque pelos EUA em 2003 (o intervalo equivale ao momento dos bombardeios em Bagdá, que não vemos). Na primeira parte, o diretor filma de forma muito próxima sua numerosa família de classe média, enquanto seus entes queridos se preparam para o que está por vir. Os adultos compram lanternas e armazenam alimentos, enquanto as crianças se esmeram em cuidar do poço (faltará água e é necessário escavar o solo do jardim). Há apreensão e, especialmente, resiliência: ninguém se desespera, todos reagem com uma força inominável à guerra que se aproxima.
A imagem de Saddam Hussein é onipresente na televisão: em videoclipes dignos dos karaokês de Jia Zhangke, o ditador aparece como líder, herói, pai, divindade, estrela pop, imagem de proteção de tela. A família assiste TV e se cala, mas já é possível sentir a densidade do silêncio e imaginar o que se esconde por detrás dos olhares. O papel da televisão nos diários de Perlov ressoa nessas sequências, mas apontar uma referência cinematográfica é algo demasiado fútil aqui.
O homem com a câmera quase não faz perguntas, mas o olhar não é observacional: ele provoca as pessoas, prepara a cena com a mesma atenção que o torna pronto a se posicionar frente aos devires do real. Seu sobrinho Haidar – um menino de doze anos que se tornará protagonista e permanecerá para sempre em nossa memória – atira frutas do terraço para os seus colegas na rua e afirma: “assim não haverá mais frutas, tio”, como se rejeitasse o jogo proposto. Apesar do horror da situação, a mise en scène é divertida, não se deixa capturar pela tristeza. Há diálogos apreensivos, mas há também as bonitas luzes do aniversário no terraço e as cores de cada prato no almoço dominical. Abbas Fahdel aposta na alegria com o mesmo ímpeto com que rejeita o sentimentalismo: com uma coerência formal impecável, que atravessa todas as escolhas (não há sequer uma nota musical na trilha sonora que seja externa à cena).
Não há desespero porque a guerra de 1991 não terminou para o povo iraquiano. O embargo econômico faz o seu trabalho lento de destruição há duas décadas e todo o país é um amontoado de ruínas, como aquelas na belíssima cidade de Hit, onde as crianças brincam com armas de plástico. Sobre as ruínas tudo se torna alegoria e talvez não haja um momento tão forte como aquele em que o menino começa a trocar a fita isolante da janela (para evitar que se parta e os pedaços de vidro voem pela casa). A da última guerra ainda está lá e a fita torna-se uma metáfora de um país que nunca se recuperou da última catástrofe e já tem de enfrentar a próxima.
A convivência da família e os jogos infantis são cálidos e cheios de paixão, mas a encenação e a montagem são duras, secas, implacáveis. Em toda a primeira parte, o trabalho da câmera parece ser o de um instrumento que tem a ver com a física: medir a resiliência das janelas, das paredes, das mulheres, dos homens e das crianças. A dureza é refletida em uma escolha surpreendente e assombrosa: num dado momento, ainda antes do intervalo, um letreiro informa que o protagonista morrerá em poucos anos, antes de completar os quinze.
É então que percebemos que tudo o que vemos se trata de uma melancólica elegia. O ritmo da montagem torna-se mais lento, como se fosse necessário demorar-se na cor de cada refeição, em cada canto da casa, em cada rosto, antes que tudo desapareça para sempre. A vida pulsa e acompanhamos sua respiração na tela, mas o documentário se aproxima do seu limite mais extremo: filmar a morte já é possível em grande medida porque os personagens já estão mortos, já se tornaram fantasmas. A sombra da morte é invisível, mas se projeta inevitavelmente sobre o rosto do menino que sorri e zomba da irmã.
Mesmo o que não se mostra é extraordinário. O tempo sem imagens do intervalo entre uma parte e a outra não poderia ser mais afirmativo. As imagens da guerra já vimos na TV e sabemos que elas são um acúmulo de clichês e que se assemelham ao videogame. Imaginar o horror não é difícil. Já foi filmado inúmeras vezes e sempre tem gosto de sangue e cheiro de queimado. Não é preciso mostrar uma vez mais o que a gigantesca máquina de guerra norte-americana é capaz de fazer: para isso existe o jornalismo e as séries de televisão no pior dos casos, e no melhor, os filmes de Brian de Palma, Kathryn Bigelow e Clint Eastwood. Mas mesmoThe Hurt Locker e American Sniper parecem frívolos diante de Homeland.
A segunda parte começa e tudo muda depois dessa elipse, uma das mais fortes da história do cinema. Os ocupantes norte-americanos estão em toda parte e o que era uma ponte que levava à casa do avô se tornou “território militar”. O estado de exceção é o novo reino. Os soldados podem tudo e nada acontece: assediam, perseguem, matam e o direito e a lei são uma piada. O que era uma estação de rádio popular tornou-se um monte de ferro e concreto e a convenção internacional que proíbe o ataque contra as rádios é mais uma nota de rodapé esquecida pela história.
O menino que sorria e brincava contente com seus primos tornou-se um adulto precoce. Seu olhar é agora sério e cheio de uma revolta profunda. Os bate-papos alegres com seus irmãos deram lugar a uma inimaginável discussão acalorada com um traficante de armas fiel a Saddam. Atirar frutas na rua faz parte de um passado distante; o garoto agora se rebela contra os pais porque não pode disparar a metralhadora para comemorar a morte dos filhos do ditador com seus vizinhos. O que era ternura agora é ódio e sangue nos olhos.
A forma também muda radicalmente. O que era registro do cotidiano da família torna-se reportagem e peregrinação pelas ruas, bairros, novas ruínas que substituem as antigas. A observação dá lugar à entrevista e à reivindicação inflamada. A câmera que era paciente e delicada se converte em megafone multitudinário: mal chega a um bairro, as pessoas se aglomeram em torno do cineasta, prontas a disparar mais um testemunho sombrio sobre as ações dos militares. Há desaparecidos, vizinhanças inteiras destruídas por mísseis, mulheres e homens que choram e gritam por alguma ajuda. O inferno é cinza, sujo e tem a cor da poeira do deserto. Mas há também aqueles inúmeros retratos de crianças, adultos e velhos iraquianos que nos olham com um sorriso e preenchem toda a duração do Homeland. O povo é o que continua a surgir em cada olhar.
“A vida era melhor antes do petróleo”, diz um deles. Um comunista lembra-se que Saddam converteu o povo iraquiano em uma multidão de esquizofrênicos: a censura fazia com que a pessoa fosse uma no trabalho e outra em casa; uma pessoa por fora e outra por dentro. O irmão do cineasta explica que a guerra criou um enorme exército de saqueadores, sempre dispostos a agir nesse enorme caos que dá lugar à violência cotidiana. E se tudo mudou é apenas para continuar igual: a ameaça aos adversários do governo anterior persiste na revolta desse homem pobre que recolhe lixo em uma carreta e se pergunta por que os soldados sempre lhe apontam as armas gratuitamente; as valas comuns da ditadura perduram no tiro anônimo na rua, matando um jovem que levava uma peça sobressalente para ajudar o vizinho e nunca será investigado.
A desesperança é brutal, mas as piadas ainda estão presentes: todos se burlam da professora integrante do partido Baath que pediu aos alunos para rasgarem “com respeito” a foto de Saddam contida no livro didático. Esses homens e mulheres (os que ficaram) encontram energia onde há apenas destruição e a resiliência desse povo parece eterna. Mas a vida do menino, a vida única e irrepetível desse menino, não é. Nós já sabíamos, mas nem mesmo a integridade estética inesgotável de Abbas Fahdel tinha nos preparado para esse momento da noite em que se escuta um disparo, um grito e um corte seco nos leva a uma fotografia mortuária na parede. A essa fotografia e ao silêncio mais denso que experimentei na vida ao sair de uma sala de cinema. Depois das cinco horas e meia de Homeland, os mortos-vivos somos nós.
Iraque/França, 2015 334 min.
De Abbas Fahdel
Crônicas do cotidiano no Iraque antes e depois da invasão Norte-americana.
Parte I: Antes da queda (160 min.)
Durante vários meses o diretor filmou um grupo de iraquianos, na sua maioria membros de sua própria família, em suas expectativas sobre a guerra. Essa primeira parte do filme se encerra com o início dos ataques norte-americanos à Bagdá.
Parte II: Após a batalha (174 min.)
Os americanos invadem o Iraque, e o filme mostra as consequências dessa invasão no cotidiano dos personagens.
 Homeland_ Iraq Year Zero _ Terra natal _ Iraque ano zero _ CachoeiraDoc
Homeland_ Iraq Year Zero _ Terra natal _ Iraque ano zero _ CachoeiraDoc
Homeland (Iraq Year Zero) remporte le Sesterce d’Or du meilleur long métrage au festival Visions du Réel. Le jury composé notamment de Jean-Stéphane Bron (réalisateur de Cleveland contre Wall Street) et Nicolas Philibert (réalisateur d’Être et avoir) explique :
« Abbas Fahdel dessine le portrait sensible et généreux d’un pays et d’un peuple sur lesquels nous n’avions jusqu’ici qu’une vision simpliste, forgée par 25 ans d’images d’actualités et de propagande. Peu à peu, les clichés s’estompent pour laisser place à des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, qui deviennent nos proches. Mêlant le roman familial au roman épique, le quotidien et la guerre, la petite et la grande Histoire, le film nous entraîne de Bagdad aux rives du Tigre, berceau de l’humanité. Un grand film. »

Homeland : Iraq Year Zero remporte le Sesterce d’Or du meilleur long métrage au festival Visions du Réel.
Le Blog documentaire
« Homeland (Iraq Year Zero) »
Un documentaire hors normes primé à Nyon
Nous vous en avions parlé dès le dévoilement de la programmation du festival «Visions du Réel». Le film monumental d’Abbas Fahdel, Homeland (Iraq Year Zero), s’est imposé à Nyon comme le grand vainqueur de la compétition, Sesterce d’or du meilleur long métrage et mention spéciale du Jury Interreligieux. Un documentaire courageux, et salutaire, venu illuminer la 46ème édition de la manifestation…

« Il s’agit d’une œuvre de référence pour comprendre l’histoire et le présent du Moyen-Orient. Plus qu’un film beau, c’est un film nécessaire. Il devait être réalisé, il doit être vu ». Telle est l’opinion du directeur de « Visions du Réel », Luciano Barisone, après que le jury de la compétition internationale a accordé le Sesterce d’or àHomeland (Iraq Year Zero), du réalisateur franco-irakien Abbas Fahdel.
Cette fresque de 334 minutes nous emmène en Irak pour nous plonger pendant deux ans dans la vie d’une famille – celle du réalisateur, avant et après l’intervention américaine. Un roman collectif avec « le souffle d’une saga », qui expose « la tragédie et la dignité du peuple irakien dans des moments d’une grande intensité ». Le jury composé de Jean-Stéphane Bron, Nicolas Philibert et Ann Carolin Renninger explique :« Abbas Fahdel dessine le portrait sensible et généreux d’un pays et d’un peuple sur lesquels nous n’avions jusqu’ici qu’une vision simpliste, forgée par 25 ans d’images d’actualités et de propagande. Peu à peu, les clichés s’estompent pour laisser place à des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, qui deviennent nos proches. Mêlant le roman familial au roman épique, le quotidien et la guerre, la petite et la grande Histoire, le film nous entraîne de Bagdad aux rives du Tigre, berceau de l’humanité. Un grand film. »
Le jury du Prix Interreligueux (Aida Schläpfer Al Hassani, Mirela Vasadi Blasius, Marc Wehrlin et Daniel Wildmann) ajoute : « Le film pénètre la conscience des spectateurs et nous rapproche des protagonistes de Homeland. Visuellement, nous parvenons à faire partie de leur vie. Le cinéaste a couru de grands risques en faisant ce film et s’est vu également confronté à une tragédie personnelle ».
Avant l’ouverture du festival, Luciano Barisone précisait déjà : « Alors que nous avons visionné 3.700 films au fil de l’année, un documentaire exceptionnel a immédiatement retenu notre attention pour l’édition 2015 il y a quelques mois déjà. Il s’agit d’ailleurs du premier film dont la sélection a été confirmée en vue de sa projection en première mondiale durant le Festival ».
Le Blog documentaire, Cédric Mal, le 26 avril 2015

LE TEMPS
L’autre visage de la guerre en Irak
Le festival du film documentaire récompense «Homeland (Iraq Year Zero)», une œuvre bouleversante
Les films fleuve semblent avoir la cote dans les festivals. Après Winter Sleep (3h16) de Nuri Bige Ceylan, palmé d’or à Cannes, Mula sa kung ano ang noon (5h38) de Lav Diaz, pardisé d’or à Locarno, c’est au tour de Homeland (Iraq Year Zero) (5h34) d’Abbas Fahdel de toucher le Sesterce d’or à Nyon. Ces prix ne sont pas un indice d’élitisme cinéphile, car ils distinguent de grandes œuvres dont la longueur se justifie par l’intensité et la richesse du propos.
Homeland a «passé sous les radars de tous les festivals», s’étonnait – et se réjouissait Luciano Barisone. Parmi les 3700 films visionnés au cours de l’année écoulée, celui-ci a immédiatement retenu son attention. Il a été le premier sélectionné pour être projeté en première mondiale à Visions du Réel». Le directeur artistique parle d’un «film de deuil travaillant des blessures terribles, d’une œuvre de référence pour comprendre l’histoire et le présent du Moyen-Orient. Plus qu’un film beau, c’est un film nécessaire. Il devait être réalisé, il doit être vu».
La vie en temps de guerre
Dans Homeland (Iraq Year Zero), home movie à résonance universelle, Abbas Fahdel, relate deux ans de vie familiale en Irak, avant et après l’intervention américaine de 2003. On assiste au spectacle banal et toujours merveilleux de la vie quotidienne. Des frères et sœurs qui se chamaillent, qui rigolent en regardant Mr. Bean à la télé. Des oncles, des amis, des voisins qui prennent le thé, qui racontent des histoires, souvenir d’un incident cocasse à la mosquée ou d’une chèvre qu’une femme médecin trayait tous les matins pour nourrir ses enfants.
L’humeur est détendue, pourtant l’avenir s’assombrit. Entre Tigre et Euphrate, des oiseaux passent comme des menaces. Un bruit d’avion fait lever la tête. On prévoit des matelas contre les fenêtres. On carotte longuement le jardin pour atteindre la nappe phréatique et disposer d’un puits si l’eau courante venait à manquer. Un gosse à cette expression, «J’espère que les Américains ne se serviront pas d’armes de destruction massive», qui en dit beaucoup sur l’air du temps, sur l’humour et la peur.
De la guerre en Irak, les spectateurs occidentaux ont vu des images abstraites de nuits vertes zébrées d’éclairs. Puis des blindés roulant dans le désert, et d’éventuelles silhouettes lointaines, menaçantes. Homeland filme le contrechamp de la propagande américaines: des cieux profonds comme les 1001 nuits, des jardins touffus, des gens qui sont nos frères humains et que l’on quitte le cœur brisés quand le film prend brutalement fin. Comme disait un membre du jury, «Homeland ne peut que gagner».
Visions du Réel enregistre un nouveau record de fréquentation avec plus 35 000 spectateurs. Cette affluence confirme la qualité supérieure des 166 films présentés.
Samedi 25 avril 2015 , par Antoine Duplan
ARTICLE COMPLET – FULL ARTICLE


Commentaire du réalisateur Américain Jonathan Nossiter
تعليق المخرج الأميركي العالمي جوناثان نوسيتر
24 heures
Homeland (Iraq Year Zero) remporte le prix du
Meilleur Long Métrage au festival Visions Du Reel 2015
La 46e édition de Visions du Réel arrive à son terme, mais il est encore temps de cueillir les fines fleurs de la manifestation puisque les films primés par les jurys des différentes catégories sont projetés aujourd’hui à la salle communale de Nyon.
L’occasion, pour ceux qui ne craignent pas les marathons filmiques, de se plonger (à 20h) dans le grand lauréat de la cuvée 2015, Homeland (Iraq Year Zero), distingué du Sesterce d’or du meilleur long-métrage de la Compétition internationale.
Pressenti comme l’un des événements de la sélection, le film d’Abbas Fahdel, diptyque d’une durée de plus de 5 h 30, témoigne de la vie en Irak avant l’intervention américaine de 2003 pour sa première partie et après pour la seconde. Immersion totale dans l’un des pays les plus déstabilisés de la planète.
24 heures, le 24.04.2015
ARTICLE COMPLET – FULL ARTICLE
TRIBUNE DE GENEVE
Visions du réel: l’Irak et la Syrie à l’honneur
«Homeland (Iraqi Year Zero), émouvant film-fleuve sur une famille irakienne, remporte le Sesterce d’or, tandis que le Sesterce d’argent va à «Coma», une coproduction syrienne et libanaise.
Visions du Réel a attribué son Sesterce d’or à «Homeland (Iraqi Year Zero), une chronique émouvante de cinq heures et demie qui suit une famille irakienne avant et après l’intervention américaine de 2003. Le festival nyonnais bat son record de fréquentation avec plus de 35’000 spectateurs.
«Visions du réel confirme son rôle de festival leader en Suisse, avec Locarno et Soleure», a dit vendredi 24 avril à la presse Claude Ruey, président du festival. Avec 136 réalisateurs présents, plus de 1100 professionnels accrédités et 166 films projetés, dont 113 premières mondiales ou internationales, Nyon est un rendez-vous important de la création documentaire et sert de tremplin vers d’autres festivals.
Film hors normes
Cette année, le jury a distingué un film hors normes, de 334 minutes: «Homeland», de l’Irakien Abbas Fahdel. Le réalisateur, qui a étudié le cinéma en France, est rentré en Irak pour filmer la vie de sa famille avant et après l’intervention américaine.
Il livre un témoignage fort sur des gens «qui n’aspiraient qu’à vivre en paix» et qui vont voir mourir plusieurs de leurs proches de balles perdues, dont le propre neveu du réalisateur, un enfant de onze ans, a expliqué Luciano Barisone, directeur du festival.
Plus de 150 heures
Abbas Fahdel a tourné plus de 150 heures de film. Une première version durera neuf heures, puis, au prix de coupes difficiles, cinq heures et demie. Son travail donne un autre regard sur la réalité irakienne, loin des reportages rapides de l’actualité. Il sera diffusé samedi à Nyon de 20h00 à 02h00, en deux parties.
TRIBUNE DE GENEVE, le 24.04.2015
ARTICLE COMPLET – FULL ARTICLE
هوملاند عباس فاضل: بابل قبل الطوفان

باريس | الدخول إلى فيلم العراقي عباس فاضل «هوملاند» (2015) ليس كما الخروج منه. هو من طينة الأفلام التي تخترق جدار «الشاشة»، فيصير الشخوص أجزاء من واقع المشاهد لساعات. يسيرون إلى جانبه في الصالة المعتمة، يمزحون معه، يمسكون به، ينبضون حياة، يسخرون من العدو وطائراته التي لن تحلق في سماء بغداد الهادئة، كما يعتقدون… وينتظرون المعركة كالذاهب إلى نزهة جانب النهر يوم الأحد.
يرسم هذا الشريط التسجيلي جدارية لهذه المأساة التي لم يتوقع أحد أثرها على خريطة المنطقة، لكنه ينتصر أيضاً على الموت. يحكي لنا هذه الوجوه السعيدة التي تسير بثقة وعدم اكتراث إلى إحدى أكثر الحروب كارثية في تاريخ البلاد العربية. ربما هذه العودة الدائمة إلى المعارك في تاريخ العراق المعاصر والحصار والعدوان الأميركي المتكرر، جعلت الشعب العراقي لا يلقي بالاً لإرهاصات الحرب وتهديدات إدارة بوش التي سبقت الغزو الأميركي لبغداد عام 2003. داخل البيت العائلي، أو في الشارع، حول مائدة الطعام، أو في ألعاب الصبية وأحاديثهم، تنسج سينما فاضل قصة هؤلاء الذين يقفون على خطوات من حافة البركان.
يمسك فاضل بكل إمكانات «كتابة» السينما التسجيلية ليعيد ترتيب الحكاية في «هوملاند» الذي يتكون من جزءين «قبل السقوط» و«بعد المعركة» اللذين يعرضان حالياً في الصالات الفرنسية. تدق طبول الحرب في عام 2003 بينما يقرر المخرج توجيه كاميراه إلى أفراد العائلة والجيران والأصدقاء. يرصد بدقة التفاصيل التي تحدث داخل البيت العائلي. يختار إذاً الواقع في بعده الحميم، بدل اللجوء إلى صورة المعارك أو التحضيرات العسكرية المنتمية إلى لغة صور الأخبار، بينما الألفة والقرابة مع شخصياته تدفعها إلى التحرر من كل المقاومات التي قد تظهرها الشخصيات عادة خلال تصوير هذا النوع من الأفلام. إنّها من أهم رهانات السينما التسجيلية الراهنة. تجارب كثيرة تقدم في السنوات التي تلت انتفاضات «الربيع العربي»، تخرج التاريخ من بعده «الماكرو» وتكتبه فيلمياً من خلال قصص الأفراد وانخراط تام للمخرج في فيلمه كتجربة حياتية. نظرته الخاصة إلى التاريخ الذي يكتب أمامه، يصير أفقاً يدفع بالأفلام إلى أفق أكثر أصالة وإبداعاً. إنّها كتابة جديدة في السينما التسجيلية العربية تعيد مساءلة حوادث التاريخ الكبرى ونتائجها في حياة الأفراد عبر الأثر لا الذاكرة (التاريخية الصرفة). نقصد بكتابة الأثر هنا، تشييد بنية سردية، تعيش داخل التاريخ، لكنها تبني نظامها الخاص، المبني على ذاتية المخرج، وشخوصه (من أفراد العائلة والأصدقاء)، وترصد التفاصيل الهشة المعرضة للاختفاء.
يدفع عباس فاضل إذاً بهذه الفرصة إلى أقصى إمكانياتها. ويبدو أنّه من السباقين لهذا التوجه في السينما التسجيلية، فمنذ أكثر من عقد، قارب عبر أفلامه قصصاً مرتبطة بتاريخه الشخصي ليجعلها مادته السينمائية كما في «العودة إلى بابل» (2002). يسلط كاميراه على الأحاديث اليومية، والاستعدادات للحرب، ويرسم عبر الأحاديث المتحررة والبريئة قريبه الصبي حيدر، مخيال الحرب، التي ستأتي وتحصد أرواح كثيرين من الأبرياء، منهم حيدر. هذا الطفل الذي يشكل شخصية مركزية في الجزء الأول من الفيلم، قتل برصاصة في الرأس بعد الغزو الأميركي، ما أوقف المشروع برمته. ولم يعد عباس فاضل إلى مادته الفيلمية إلا أكثر من عشر سنوات بعد الحرب، بموافقة من عائلته.
في عيوننا نحن الذين نشاهد الفيلم، نرى ما لا يبدو على الشاشة. نرى خلف هذه الشوارع والمنازل التي تنبض بالحياة مستقبلها: الحيطان المتداعية، والنوافذ المكسرة، والأجساد المسجاة. إننا هنا أمام آثار الأشياء، التي لن تعود… وكما تحفر العائلة بئراً في المنزل للتزود بالماء في حال انقطاعه خلال القصف، وتعد بناتها الخبز المجفف استعداداً لانقطاع المواد الأساسية، تحفر الكاميرا في أصول هذا الشر. نرى مراراً عودة آلة التلفزيون، ومعها القناة الرسمية العراقية التي تروّج لبروباغندا نظام البعث. صدام حسين في وضعية أب الأمة، الذي تنطفئ الشمس من دونه كما تقول إحدى الأغاني، وسأم أفراد العائلة من هذه الخطابات الرنانة والأغاني الحماسية. إنها إيديولوجيا الدولة التي شرّعت أبواب بلاد الرافدين على الموت.
لكن خصوصية «هوملاند»، هي أنّ خطابه، يَنْفُذ عبر سرديته وصوره، لا عبر تقنيات تقليدية اعتادها بعض المخرجين من قبيل التعليق. «هوملاند» فيلم بلا تعليق… بل يحمل حكاية، وكتابة دراماتورجية تنتمي إلى السينما التسجيلية لا تخطئها العين. نرى الأطفال يلعبون لعبة الحرب، بينما المراهقات يتحدثن عن الزواج، في حين يطمح المسرحي إلى بناء مسرحه الشخصي، ويزوّج ابنته، والقرى تحفظ المعمار القديم لمهد الحضارات. كل هذه القصص تصير مسرح الاستعداد لحرب اعتقدها كثيرون مجرد وعيد لن يتحقق.
كتابة «هوملاند» تحترم شخصياتها. يمارس المخرج نوعاً من «الحياء» والاحترام لهؤلاء الذين يصوّرهم. يحفظ لحظات السعادة والضحك التي تجعل شخصياته أبطالاً حقيقيين للواقع. هم ينقادون إلى المأساة بشجاعة ونوع من القدرية، وفي هذا نوع من البطولة. إنه فيلم يراوح بين مشاهد تسرق الابتسامة وأخرى تعصر القلب.
تقنياً، اعتمد المخرج على إعادة منتجة بعض أرشيف أفلامه السابقة، وأكثر من 120 ساعة من الصور الخام، ويمتد الفيلم بجزءيه على مدة تقارب ست ساعات. لم يخرج فاضل الفيلم فقط، بل عمد إلى منتجته، ما يعدّ مغامرة غير سهلة بتاتاً. إنه توقيع مضاعف للفيلم، الذي يجد دون شك، مكانه بين أهم الإنتاجات في السينما التسجيلية العالمية لهذا العام. وهذا ما دفع إلى ترشيحه للعديد من الجوائز في مهرجانات مرموقة.
خارج مجال الرؤية
إكرام إبن الشريف
.الزمان : سنة صفر
.المكان : العراق
.القصة : 334 دقيقة من حياة أسرة قبل و بعد الغزو الامريكي
.الجزء الاول : مشهد انتظار لا ينتهي لهجوم حتمي
.الجزء الثاني : ما نجا و ما لم ينجو من وطن جريح
حين عاد عباس فاضل للعراق، قبيل اندلاع حرب 2003، أراد اكثر من اي شيء اخر ان يكون بجانب أسرته. هو خوف على ذويه من صراع دموي جديد قبل ان يكون إرادة توثيق لحظة فارقة، أنتجت سنوات لاحقا، شريطا وثائقيا استثنائيا عنوانه “وطن…العراق سنة صفر”.
يحكي المخرج قصة أسرته. ترصد الكاميرا بيئة معقدة ببساطة و عمق. مشاهد حياة يومية، دردشات الإخوة ، جلسات الشاي ، قهقهات امام التلفاز.. يحكي عباس فاضل تفاصيل الانتظار، انتظار حرب بعد حصار طويل. ينتهي الجزء الاول بمشاهد القصف الاولى. في قاعة العرض بسيول لم يعرف الجمهور من القصة تلك سوى هذا المشهد على الأرجح. انقضت اكثر من ساعتين لكن القصة لم تنتهي بعد.
نخرج شيئا فشيئا من المشهد الصغير للمشهد الأكبر، بغداد بعد الغزو، صور الفوضى، غضب العراقيين يلتقطها عباس فاضل الذي ترك بلده في سن 18، يلتقطها بشعرية وجمالية عالية. ابتسامة حيدر، شخصية الفيلم الرئيسية، لا تفارق مخيلة المشاهد حتى وان فارق حيدر الحياة في ربيعه الحادي عشر. 5 ساعات تنتصر خلالها الحياة على الحرب والموت و تتبدد معها 30 سنة من صور البروبغندا.
لم يستطع المخرج العراقي اخراج صور قريبه الصغير وتوضيبها الا عشر سنوات فيما بعد. في كوريا الجنوبية و اليابان و نيويورك و أمريكا اللاتينية وعشرات المهرجانات التي عرض فيها”وطن.. العراق سنة صفر” ترك الشريط وقعا عميقا. كتب عنه الكثير، فيلم مواساة، رواية جماعية، قصة يجب ان تحكى وتشاهد.. احسسته اكبر من محاولة كتابة فصل من فصول تاريخ العراق، ابداع اكبر من مجهود توثيق صرف. كأنه محاولة استعادة لحظات انقضت ولن تعود، عراق ما قبل الغزو، صوت حيدر، وكل تلك الأشياء التي افتقدها عباس فاضل في إقامته الفرنسية وأشياء اخرى استعادها خلال إنجاز هذا الوثائقي. حين سئل المخرج عن ما يمثله الشريط له قال ان “وطن…العراق سنة صفر” هو حياته.
اجل كل شيء ذاتي في تصوري، لا شيء موضوعي في الفيلم الوثائقي. أفضل استعارة وصف فريديريك وايزمان مخرج الأفلام الوثائقية الامريكي الشهير الذي استبدل مصطلح “موضوعي” “بعادل”. شريط عباس فاضل لا يعطي دروسا حول حرب 2003 بل يدع المشاهد يكتشف ما يريد من أفكار ومشاعر وصور. في ذلك قدر من العدالة و في ذاتية القصة قدر من العالمية تذوب معها الخلفية المحلية بتعقيداتها لتصبح إبداعا جماليا محضا.
Excerpts – مقاطع من الفيلم – Extraits
.
.
.
.
.
.
.
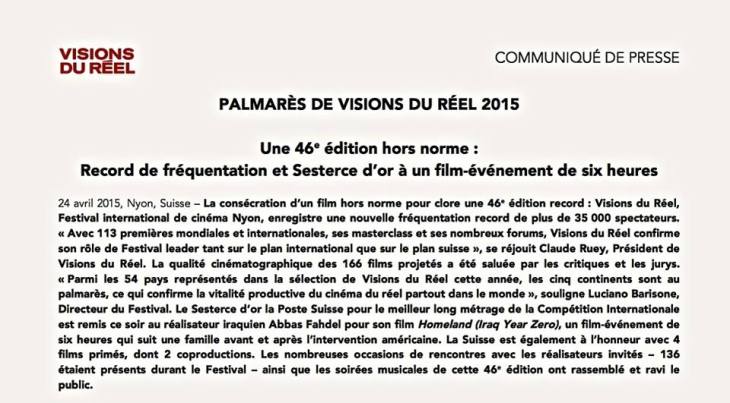

_________________________________________________________________________
 Homeland (Iraq Year Zero) at the 4º Olhar de Cinema – Curitiba International Film Festival | June 2015
Homeland (Iraq Year Zero) at the 4º Olhar de Cinema – Curitiba International Film Festival | June 2015
_________________________________________________________________________
Homeland (Iraq Year Zero) at the 5º Lima Independiente International Film Festival | June 2015
___________________________________________________________________
Cobertura 4º “Olhar de Cinema”, dia 8.
Por Alexander Aguiar.
Depois de uma semana movimentada, as atrações cinematográficas do Olhar de Cinema enfim conheciam seu último dia de exibição. Mais de 90 filmes de diversos países ao redor do mundo tiveram sua premiere na capital paranaense entre os dias 10 e 18 de junho de 2015.
Há mais de uma semana me preparava para assistir um dos filmes mais comentados do festival: “Homeland – Iraq Year Zero“, dirigido por Abbas Fahdel. O longa (longuíssima!), com mais de 5 horas e meia de duração documenta dois importantes momentos históricos do Iraque: a tensão pré-guerra, que acabou com a queda do ditador Saddam Hussein; e os resultados imediatos da ocupação norte-americana no país.
Fahdel, protegido por sua câmera, busca interferir o mínimo possível na história que sua lente registra, mas o fato de ele documentar diretamente a sua família, faz com que ele sempre seja trazido de volta para dentro da narrativa. Por mais contraditório que tal afirmação possa soar, suas filmagens encontram um limiar entre a obra de Frederick Wiseman, que através de sua câmera observa o mundo, junto das reflexões cotidianas e certeiras da câmera-olho de David Perlov em seus diários. As próprias palavras de Perlov podem descrever muito do trabalho de Fahdel: “Quando você filma um diário, o filme substitui a vida. (…) Você pode recriar a vida ou fragmentá-la.”
É através dessa fragmentação que Abbas Fahdel constrói um discurso harmônico onde há somente a tensão. A retratação de um lado humano em tempos de conflito faz com que o espectador se submerja em meio a história, onde qualquer momento de tensão é vivido à flor da pele, como se fossemos tão presentes na narrativa como a própria família do realizador. É um choque de realidade tentar compreender a visão de um país que vive à sua maneira uma espécie de “Guerra Fria”, sob o espectro da paranoia constante, onde famílias tentam transformar suas casas em fortalezas e toda a noção de existência se dá através da expectativa do ataque iminente. Ao adotar seu sobrinho Haidar, de apenas 11 anos como protagonista, Fahdel estabelece um ponto de vista que está sempre no limiar entre o abandono da inocência e a consciência de uma realidade dolorosa – se por um lado o vemos trabalhando horas a fio em um poço cavado em seu próprio quintal, também notamos que ele encara a guerra como possibilidade de não ter de frequentar aulas das quais ele não gosta. Com o passar das horas, notamos que Haidar talvez seja a pessoa mais madura de toda aquela família, justamente por emergir de uma geração que questiona as tradições e busca alternativas para esse mundo em crise que o permeia.
Já diria o velho ditado, por vezes o real é ainda mais estranho que a ficção. As propagandas televisivas pró-regime de Saddam são fantásticas, surreais, e mostram como um plano nacional de doutrinação pode perpetuar – e o pior, convencer a muita gente – a manutenção de um sistema que não beneficia ninguém, exceto a cúpula dos “amigos do rei”.
Em momento algum o longa se preocupa em dar conta do conflito, o corte que separa as suas duas partes ignora os bombardeios e ocupação norte-americana em si. O foco são as pessoas, e a forma como esses momentos as afetam direta ou indiretamente, e não a política nacional como um todo. Um segundo momento nos revelará que essa expectativa em prol de uma mudança positiva por conta da queda de Hussein se mostrará infundada, ao menos enquanto a barbárie de um for substituída pela barbárie de outros. Os escombros de Bagdá dividem, em clima de guerra civil, os soldados norte-americanos que muitas vezes atiram antes de perguntar, de saqueadores e gangues violentas que encontram na violência uma das únicas formas de sobrevivência, por conta da crise com o sistema de distribuição de cestas básicas que não necessariamente atendem a todos os necessitados, mesmo que por motivos completamente absurdos (por exemplo, habitantes de algumas cidades em específico não tem tal direito pois outrora não apoiaram o governo de Saddam, herança que se perpetua mesmo após a queda do antigo chefe de Estado).
Ao mostrar o cidadão médio, Abbas Fahdel acaba por revelar diversos contrastes entre os defensores de Saddam e aqueles que o condenam, revelando que alguns de seus familiares foram perseguidos e assassinados sem motivo aparente (um deles tinha apenas 13 anos quando foi abordado na escola e executado por forças oficiais). De qualquer forma, a suposta democracia americana jamais se revela como uma alternativa possível, e os locais compreendem que antes de tudo, a ocupação é uma decisão econômica: “A vida no Iraque era melhor antes do petróleo”, um deles afirma, em meio aos escombros do que um dia a cidade já foi. Estações de rádio, agências, ministérios, a memória cinematográfica de um país, todas amontoadas em meio à poeira, concreto e ferro retorcido, que servem de palco para brincadeiras infantis com cápsulas de projéteis e morteiros facilmente encontrados pelo chão.
O sentimento final é o de desolação, de desesperança, de saber que aquela população toda está fadada a conviver durante muito tempo com a presença de uma força hostil que os rege, qualquer seja sua origem, já que não há necessariamente um alinhamento ideológico em prol do benefício coletivo, pois os interesses individuais e econômicos prevalecem às necessidades básicas da população. Um dos planos finais do filme, chocante pela forma que se revela, me deixou anestesiado na cadeira, imóvel, sem palavras, e demorei a voltar ao mundo externo após o final da sessão. Quando finalmente retomei a consciência, a sala, já esvaziada, abrigava poucos incrédulos que como eu, acabaram de presenciar uma experiência que transcende o próprio cinema, que diz respeito à própria vida, que é arte por si só.
Após quase 6 horas na sala de cinema, ainda encontrei forças para assistir a um dos filmes que encerrava a programação, “Jauja“, do já conceituado diretor argentino Lisandro Alonso. O filme, uma busca hermética em planos distintos – de forasteiros pelo Eldorado e de um pai pela sua filha adolescente que não suporta mais a vida de exploradora – encontra caminhos distintos, aliados a uma poderosa fotografia que remete à Pintura Renascentista e a figura icônica do ator Viggo Mortensen, imortalizado como Aragorn na trilogia “O Senhor dos Anéis”.
O filme, construído sobre silêncios e grandes planos gerais em um cenário épico, consegue nos enclausurar mesmo diante das infinitas paisagens que o compõem. A busca do pai, explorador, por sua filha, o fará encontrar aquilo que ele não sabia que procurava, o próprio Eldorado, aqui chamado de Jauja. Esse novo mundo só é possível em um nível pessoal, um encontro com o seu próprio interior, e no filme isso se desdobra através de planos de tirar o fôlego. O primeiro mostra a imersão de Mortensen em um mundo de sonhos, onde o céu estrelado dá lugar a um horizonte nublado e iluminado pela aurora, com a primeira utilização de trilha sonora não-diegética do filme. Posteriormente, uma cena dentro de uma caverna nos fará questionar a concepção de espaço-tempo definidas até então na película, e remete à premissa básica de filmes clássicos do Western ou mesmo dos Road Movies, onde o resultado quase nunca é mais importante do que a própria busca, onde as mudanças se dão sobretudo num plano interno dos personagens que encontram respostas para anseios que até então não nos foram exatamente apresentados, e o resultado não pode ser outro senão a de uma empatia e engrandecimento mútuo. O final do filme escancara a questão principal que envolve o espaço-tempo fílmico, onde nos dá a sensação de que esse cenário épico foi transposto para a atualidade, e a atriz que passa o filme foragida encontra-se em casa, já chamada por seu nome próprio e não pelo nome do seu personagem, levantando questões sobre o limite entre a arte e a vida real.
Jauja é um filme que dialoga muito mais com o nosso interior do que possivelmente apresenta na tela uma narrativa que se encerra em si mesma, é algo que merece novas revisões, em especial se o filme de fato entrar em cartaz nas próximas semanas, como boatos relataram durante os dias do festival.
Com o fim do filme, vinha junto um sentimento de nostalgia por saber que no dia seguinte a rotina seria longe das salas de exibição.
De toda forma, agora só nos resta aguardar pela edição de 2016.
2015/06/24
OLHAR DE CINEMA 2015:
HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) DE ABBAS FAHDEL
Medir la resiliencia de un pueblo
Es extremamente difícil referirse a Homeland como “un film”. Nombrarlo así es afirmar que esa existencia pertenecería a la misma especie o categoría ontológica de un Jurassic World o de una película como Soft in the Head de Nathan Silver (vista acá en Olhar de Cinema). Seguramente no es el caso. El trabajo monumental de Abbas Fahdel – y la experiencia absolutamente inolvidable que es estar delante de aquella pantalla por poco más de cinco horas y media – participa de un conjunto muy acotado y preciso de obras del género humano, entre las cuales yo citaría Los Desastres de la Guerra de Goya, Guernica de Picasso, Noche y Niebla de Resnais y West of the Tracks de Wang Bing. Lo que une a esas materialidades tan distintas no es solamente el hecho de que sean obras maestras, ni siquiera el dato de que todas hayan llevado años para concretarse. Eso también cuenta, pero lo que realmente conecta a esas obras es el hecho de que todas son figuraciones tan potentes, formalmente íntegras e irrepetibles de la aniquilación del hombre por el hombre, que no es posible mirar a una pintura, a una película o a un hombre de la misma manera.
Homeland se divide en dos partes: antes y después de la invasión estadounidense a Iraq en el año 2003 (el intervalo equivale al momento de los bombardeos a Bagdad, que no vemos). En la primera parte, el director filma de forma muy cercana a su numerosa familia de clase media, mientras sus seres queridos se preparan para lo que vendrá. Los adultos compran linternas y almacenan comida mientras los niños se esmeran en el cuidado del pozo (faltará agua y es necesario excavar la tierra del jardín). Hay aprensión y hay sobretodo resiliencia: nadie se desespera, todos reaccionan con una fuerza innombrable a la guerra que se aproxima.
La imagen de Saddan Hussein es omnipresente en la televisión: en videoclips dignos de los karaokes de Jia Zhangke, el dictador aparece como líder, héroe, padre, divinidad, estrella pop, imagen de salvapantallas. La familia mira la tele y se calla, pero ya es posible sentir la densidad del silencio e imaginar lo que se esconde por debajo de las miradas. El rol de la tele en los diarios de Perlov resuena en esas secuencias, pero apuntar a una referencia cinematográfica es algo demasiado fútil acá.
El hombre de la cámara casi no hace preguntas, pero la mirada no es observacional: provoca a la gente, prepara la escena con la misma atención que lo hace estar presto a posicionarse frente a los devenires de lo real. Su sobrino Haidar – un chico de doce años que se convertirá en protagonista y permanecerá para siempre en nuestra memoria – tira frutas desde la terraza a sus compañeros en la calle, y reclama: “¡así no habrá más frutas, tío!”, como si rechazara el juego propuesto. A pesar de lo terrible de la situación, la mise-en-scène es lúdica, no se deja atrapar por la tristeza. Están los diálogos aprehensivos pero están también las hermosas luces del cumpleaños en la terraza y los colores de cada plato en el almuerzo dominical. Abbas Fahdel apuesta por la alegría con el mismo ímpetu con el cual rechaza el sentimentalismo, con una coherencia formal impecable, que atraviesa todas las elecciones (no hay siquiera una nota musical en la banda sonora que sea externa a la escena).
No hay desesperación porque la guerra de 1991 nunca ha terminado para el pueblo iraquí. El embargo económico hace su trabajo lento de destrucción hace dos décadas, y todo el país es un montón de ruinas, como aquellas en la bellísima ciudad de Hit por donde los chicos juegan con armas de plástico. Sobre las ruinas todo deviene en alegoría, y quizás no haya un momento tan fuerte como aquel en que el niño se pone a cambiar la cinta aislante en la ventana (para evitar que se parta y los pedazos de vidrio vuelen por la casa). La de la última guerra sigue aún ahí, y la cinta se convierte en metáfora de un país que nunca se recuperó de la catástrofe y que tiene que enfrentar la siguiente.
La convivencia de la familia y los juegos infantiles son cálidos y llenos de pasión, pero al mismo tiempo la escenificación y el montaje son duros, secos, implacables. En toda la primera parte, el trabajo de la cámara parece ser el de un instrumento que tiene que ver con la física: medir la resiliencia de las ventanas, de las paredes, de las mujeres, de los hombres y de los niños. La dureza se refleja en una elección sorprendente y asombrosa: en un dado momento, aún antes del intervalo, un letrero informa que el protagonista morirá en algunos años, antes de completar los quince.
Entonces nos damos cuenta de que todo lo que vemos se trata de una melancólica elegía. El ritmo del montaje deviene más lento, como si fuera necesario demorarse en el color de cada comida, en cada rincón de la casa, en cada rostro, antes que todo desaparezca para siempre. La vida pulsa y acompañamos su respiración en la pantalla, pero el documental se acerca a su límite más extremo: filmar la muerte ya es posible porque en grande medida los personajes ya están muertos, ya se han transformado en fantasmas. La sombra de la muerte es invisible pero se proyecta inevitablemente sobre el rostro del niño que sonríe y se burla de la hermana.
Incluso lo que no se muestra es extraordinario. El tiempo sin imágenes del intervalo entre una parte y otra no podría ser más afirmativo. Las imágenes de la guerra ya las vimos por la tele, y sabemos que son un cúmulo de clichés y que se asemejan al videogame. Imaginar el horror no es difícil. Ya se ha filmado innumerables veces y sabemos que siempre tiene sabor a sangre y olor a quemado. No hace falta mostrar una vez más lo que la gigantesca máquina de guerra estadounidense es capaz de hacer: para eso están el periodismo, y las series en el peor caso, y las películas de Brian de Palma, Kathryn Bigelow y Clint Eastwood en el mejor. Pero incluso The Hurt Locker y American Sniper parecen frívolas frente a Homeland.
La segunda parte empieza y todo ha cambiado después de esa elipsis, una de las más fuertes de la historia del cine. Los ocupantes norteamericanos están por todos lados y lo que era un puente que llevaba a la casa del abuelo se ha convertido en “territorio militar”. El estado de excepción es el nuevo reino. Los soldados pueden todo y no pasa nada: acosan, persiguen, matan, y el derecho y la ley son un chiste. Lo que era una estación de radio popular se ha convertido en pedazos de hierro y hormigón, y la convención internacional que prohíbe el ataque a las radios es más una nota de pie de página olvidada por la historia.
El niño que sonreía y jugaba contento con sus primos se ha vuelto un adulto precoz. Su mirada ahora es grave y llena de una revuelta profunda. Las charlas alegres con sus hermanos dieron lugar a una inimaginable discusión acalorada con un traficante de armas fiel a Saddam. Tirar frutas a la calle forma parte de un pasado remoto; el chico ahora se rebela contra los padres porque no puede disparar la ametralladora para celebrar la muerte de los hijos del dictador con sus vecinos. Lo que era ternura ahora es odio y sangre en los ojos.
La forma también cambia radicalmente. Lo que era registro del cotidiano de la familia se vuelve reportaje y peregrinación por las calles, los barrios, las nuevas ruinas que sustituyen las antiguas. La observación cede lugar a la entrevista y a la denuncia encendida. La cámara que era paciente y delicada se convierte en parlante multitudinario: apenas llega a un barrio, la gente se aglomera alrededor del cineasta, pronta a disparar más un testimonio desolador sobre la actuación de los militares. Hay desaparecidos, vecindades enteras destruidas por mísiles, mujeres y hombres que lloran y gritan por alguna ayuda. El infierno es gris, sucio y tiene el color del polvo del desierto. Pero también hay esos innumerables retratos de niños, adultos y viejos iraquís que nos miran con una sonrisa y rellenan toda la duración deHomeland. El pueblo es lo que no cesa de surgir en cada mirada.
“La vida era mejor antes del petróleo”, dice uno. Un comunista recuerda que el gobierno de Saddam ha convertido al pueblo iraquí en una multitud de esquizofrénicos: la censura hacía que uno fuera una persona en el trabajo y otra en casa; una persona por fuera y otra por dentro. El hermano del cineasta explica que la guerra ha creado un enorme ejército de saqueadores, siempre dispuestos a actuar en ese enorme caos que abre paso a la violencia cotidiana. Y si todo ha cambiado no es sino para continuar igual: la amenaza a los opositores del gobierno anterior persiste en la revuelta de ese hombre pobre, que recolecta la basura en una carreta y se pregunta porque los soldados siempre le apuntan las armas gratuitamente; las fosas comunes de la dictadura perduran en el disparo anónimo en la calle, que mata a un joven que llevaba una pieza de repuesto para ayudar a un vecino y nunca será investigado.
La desesperanza es brutal, pero los chistes siguen presentes: todos se burlan de la profesora integrante del partido Baath que ha pedido a los alumnos que rasgasen “con respeto” a la foto de Saddam que figuraba en el libro didáctico. Esos hombres y esas mujeres (los que quedan) encuentran energías donde solamente hay destrucción, y la resiliencia de ese pueblo parece eterna. Pero la vida del niño, la vida singular e irrepetible de ese niño, no lo es. Ya lo sabíamos, pero ni siquiera la inagotable integridad estética de Abbas Fahdel nos había preparado para ese momento de la noche en que se escucha un disparo, un grito, y un corte seco nos lleva a una fotografía mortuoria en la pared. A esa fotografía y al silencio más denso que he experimentado en la salida de una sala de cine en mi vida. Después de las cinco horas y media de Homeland, los muertos vivos somos nosotros.
Dirección, Guión, Producción, Dirección de Fotografía, Montaje, Sonido: Abbas Fahdel
País: Irak, Francia
Año: 2015
“(وطن ( العراق سنة صفر”
المخرج عباس فاضل يقدم فيلمه الوثائقي الطويل (خمسة ساعات ونصف) على جزئين يتناول فيه الحياة اليومية في العراق قبل وبعد
.الإحتلال الأميريكي سنة 2003
الجزء الاول بعنوان : قبل السقوط
الجزء الثاني بعنوان : بعد المعركة
___________________________________________________________________
Swissinfo (Arabic)
الحياة زمن الحروب
بمنحه جائزة سيستيرس الذهبية في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة للفيلم العراقي “وطن… العراق سنة صفر” للمخرج عبّاس فاضل، أسدل مهرجان السينما الواقعية بنيون يوم السبت 25 أبريل 2015 الستار على فعاليات دورته السادسة والأربعين التي كانت استثنائية على كل المستويات، وسجّلت خلالها السينما العربية حضورا لافتا وقويا
جائزة سيستيرس الذهبية للمسابقة الدولية للأفلام الطويلة والتي تموّلها مؤسسة البريد السويسري كانت هذا العام من نصيب المخرج العراقي عبّاس فاضل لفيلمه “وطن… العراق سنة صفر“، وهو عمل قلّ نظيره يمتدّ عرضه على مدى ستّ ساعات كاملة، ويرصد حياة عائلة عراقية قبل الغزو الامريكي للعراق سنة 2003 وبعده
أبريل 2015 سويس إنقو
لقرائة المقال بأكمله الرجاء الضغط هنا
وطن (العراق سنة صفر)” يحصد الجائزة الذهبية لمهرجان رؤى الواقع بسويسرا”

حصد فيلم “وطن.. العراق سنة صفر” للمخرج العراقي عباس فاضل الجائزة الذهبية للدورة 46 لمهرجان “رؤى الواقع” للسينما الوثائقية وذلك بمدينة نيون السويسرية.
فيلم “وطن.. العراق سنة صفر” من النوع الوثائقي يدوم خمس ساعات ونصف ويتناول الحياة اليومية في العراق قبل وبعد الإحتلال الأميريكي سنة 2003.